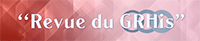|
|
Dir. Yannick MAREC et Daniel RÉGUIER, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 566p., 2013.

« Près de trois siècles de vieillesse observée, analysée, située. Trois siècles qui ont vu émerger les grands parents, au XVIIIe avec Greuze qui les peint, et au XIXe, avec Hugo qui les magnifie, pour, de nos jours, les faire osciller entre ceux qui aident et ceux qui sont aidés. Trois siècles qui ont regardé la pauvreté des vieux devenus incapables de travailler et tombés à charge de leurs proches et, à défaut, de la charité publique puis de l’assistance et en fin de la solidarité. Trois siècles qui ont vu la naissance des seniors, retraités actifs et, dit l’année 2012, solidaires des autres générations : l’entraide équitable et symétrique va-t-elle supplanter la relation nécessaire mais asymétrique de l’aide ? [. . .]
Le très grand intérêt et l’originalité [de ce volume] consistent à savoir osciller harmonieusement entre le local et le global, entre l’enracinement régional et la vision nationale, voire internationale. Ces travaux viennent de disciplines, de spécialités diverses, comme est diverse la société elle-même. L’accent est mis sur l’apport de la société à l’accompagnement de la vieillesse, grâce à des politiques sociales qui traversent les républiques et les gouvernements. De la généralisation des pensions de retraite qui fait reculer la pauvreté des vieillards, au développement de la gériatrie qui apprend à les soigner, à la modernisation de la gérontologie qui permet de mieux accueillir et accompagner, l’ouvrage met en valeur ce que la société fait pour ses anciens, même si, encore et toujours il y a plus et mieux à faire. »
Extrait de la préface de Geneviève Laroque (†), présidente de la Fondation nationale de gérontologie.
Notice sur le site de l’éditeur.
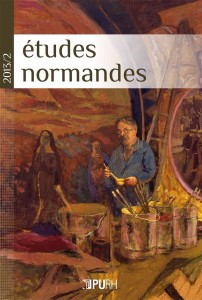 Disons-le franchement, le régionalisme n’a pas bonne presse aujourd’hui. Il est taxé, dans le domaine de l’architecture et de l’art urbain notamment, de passéisme et de désuétude. Avec raison peut-être, la défense du régionalisme est vaine. Qui oserait parier que l’on puisse à la fois construire dans le « style normand » et être novateur et audacieux? Que reste-t-il, d’ailleurs, de l’inspiration normande dans les grands projets urbains qui ont marqué la Normandie ces dernières années… et pourquoi est-il illusoire de poser ainsi le problème? Esthétiquement tout autant qu’idéologiquement, le régionalisme est suspect. N’est-il pas l’apanage des esprits conservateurs, voire obtus ? Disons-le franchement, le régionalisme n’a pas bonne presse aujourd’hui. Il est taxé, dans le domaine de l’architecture et de l’art urbain notamment, de passéisme et de désuétude. Avec raison peut-être, la défense du régionalisme est vaine. Qui oserait parier que l’on puisse à la fois construire dans le « style normand » et être novateur et audacieux? Que reste-t-il, d’ailleurs, de l’inspiration normande dans les grands projets urbains qui ont marqué la Normandie ces dernières années… et pourquoi est-il illusoire de poser ainsi le problème? Esthétiquement tout autant qu’idéologiquement, le régionalisme est suspect. N’est-il pas l’apanage des esprits conservateurs, voire obtus ?
Objet de récupération politique, le régionalisme normand souffre d’un enfermement caricatural. Historiquement, un bon exemple du rétrécissement de son potentiel nous est donné en 1904 par Étienne Frère, avocat et directeur de La Source normande, dans un plaidoyer patriotique provincial demandant la restauration du pouvoir aux provinces.
« Il devrait y avoir un art Normand et une littérature Normande reconnaissables à la saveur du cru et au goût du terroir », écrit-il. L’auteur assimile uniquement le régionalisme à la conservation des traditions et coutumes. Cette vision ne laisse guère de place à l’originalité, un concept qui différencie pourtant la création artistique de sa reproduction mécanique et sérielle.
Voir : le site des Presses Universitaires Rouen Le Havre
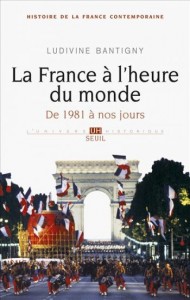 Ludivine Bantigny, Seuil, 528p., Paris, 2013 Ludivine Bantigny, Seuil, 528p., Paris, 2013
En quinze chapitres nourris des travaux les plus neufs en histoire, sociologie, géographie, sciences politiques, Ludivine Bantigny dresse un bilan éclairant des évolutions survenues ces trente dernières années. Une histoire très contemporaine dont l’horizon est marqué par la mondialisation, le libéralisme économique, le sentiment de crise. Quel regard porter sur la France, quand le monde semble devenu le meilleur critère pour comprendre cette nouvelle ère ? Quelle pertinence à réfléchir encore en termes nationaux au temps de l’apparent effacement des frontières ? De l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981 au sarkozysme, de la crise du creuset républicain à la scène du travail, des genres de vie aux réflexions sur « l’omniprésent », ce volume fait la part égale au politique, aux transformations sociales et aux imaginaires, dans un monde devenu multipolaire. Une époque nouvelle est née, elle n’est pas encore close. Le volume qu’on va lire ici affronte de plein fouet les défis de la contemporanéité, avec un ton personnel et engagé.
Fiche sur le site de l’éditeur.
Laura Casella, Anna Bellavitis, Dorit Raines (dir.)
Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines 125/1, École française de Rome, 2013
Le dossier des MEFRIM présente les résultats du deuxième atelier du programme de recherche “Modèles familiaux et cultures politiques dans l’Europe moderne” (École Française de Rome, Université de Rouen, Université de Udine, Université Ca’ Foscari de Venise et Université Paris Ouest-Nanterre) sur Famiglie al confine. Reti economiche alleanze familiari e forme di trasmissione (Università di Udine, octobre 2009). Les articles s’interrogent sur les effets de la frontière – géographique, politique, confessionnelle – sur les comportements familiaux, à partir de l’étude de cas, individuels, ou de groupes de familles, et d’échelles d’analyse différentes, du village alpin aux grandes villes marchandes, et en insistant tout particulièrement sur la frontière entre la République de Venise et l’Empire des Habsbourg.
Numéro disponible sur le site de la revue.
Jean-François Chauvard, Anna Bellavitis, Paola Lanaro (dir.)
Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines 124/2, École française de Rome, 2012, 408 p.
Le dossier des MEFRIM présente les résultats d’un programme de recherche de l’École Française de Rome, en collaboration avec l’Université Ca’ Foscari de Venise et l’Université Paris Ouest-Nanterre sur les normes et les pratiques des substitutions fidéicommissaires dans l’Europe moderne (France, Italie, Angleterre, Empire), et met en évidence une grande diversité des formes et des usages du fidéicommis qui conduit à repenser, à nouveaux frais, un certain nombre de questions : l’articulation avec d’autres pratiques d’exclusion (notamment la primogéniture, bien moins systématique qu’on ne l’a longtemps prétendu), les diverses significations qui présidaient à sa fondation, les manipulations dont il était l’objet et la conflictualité intrafamiliale qu’il engendrait, l’ampleur de sa diffusion sociale et la variété des biens sur lesquels il était instauré, ses effets sur le système dotal, le recouvrement des crédits et le marché foncier, le rôle d’arbitre et de contrôle de l’autorité souveraine. À l’aune de ces questions, le fidéicommis apparaît comme un phénomène social total au croisement de la parenté, du politique et de l’économie.
Numéro disponible sur le site de la revue.
Au cœur des querelles politiques et religieuses sous Louis XIV
Michèle Virol, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, 286 p.
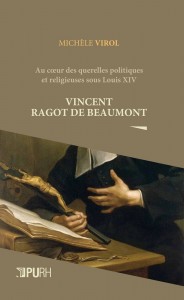
Vincent Ragot, abbé de Beaumont (1624-1715), eut une vie agitée. Défenseur d’une stricte morale au début de sa vie religieuse, il connaît la notoriété dans la défense d’un prélat de la Contre-Réforme, Nicolas Pavillon, qui refuse de signer le formulaire et combat la prévarication et la violence en Languedoc. Changeant de diocèse, Ragot devient chanoine et chantre de la riche cathédrale de Tournai, dans une province nouvellement annexée, la Flandre. Proche de l’intendant, il combat les abus de l’évêque et du gouverneur, défend les intérêts du chapitre, mais, soupçonné par le marquis de Louvois de protéger Antoine Arnauld, exilé à Bruxelles, il est arrêté et emprisonné. Confessant avoir succombé au péché de chair, il ne peut plus exercer comme prêtre, est déchu de ses titres et fonctions et condamné à la relégation. Connu de Louis XIV et redouté de ses ministres, il continue, dans l’ombre de personnes influentes comme Boisguilbert et Vauban, de débattre et d’écrire, notamment sur la réforme de la fiscalité. «Nègre » de Vauban, il rédige avec lui le Projet d’une dîme royale et corrige ses textes. Acteur des querelles politiques et religieuses du siècle, il est influent dans tous les lieux où il séjourne, Paris, le Languedoc, la Flandre, Rodez et la Normandie. Ce livre, écrit à partir des informations trouvées dans les archives et notamment des correspondances, fait renaître un contemporain de Louis XIV et mieux connaître l’histoire de son règne, appréhendée en suivant un destin singulier.
Continuer la lecture de Vincent Ragot de Beaumont
Sous la direction de Pascal Dupuy, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, 164 p.

La fête de la Fédération du 14 juillet 1790 ne semble pas révéler de mystère ou d’incertitude, tant les récits qui lui ont été consacrés nous en ont donné une image convenue et répétitive. Depuis plus de deux siècles, publicistes et historiens ont en effet retracé ses origines et son déroulement. On sait qu’elle fut le résultat de « fêtes fédératives » qui ont réuni, depuis l’automne 1789, les gardes nationales de villages et de bourgs souhaitant assurer la sauvegarde des réformes engagées depuis les premiers moments de la Révolution. Devant ces manifestations d’enthousiasme qui touchent une grande partie du territoire national français et afin de mieux les contrôler, les autorités décident d’en prendre la tête en proposant d’organiser le 14 juillet 1790, date anniversaire de la « Prise de la Bastille », une fête de rassemblement des délégués des « fédérations » venus des nouveaux « départements ». C’est-à-dire une cérémonie nationale officielle, à Paris, la nouvelle capitale révolutionnaire du royaume. L’histoire retiendra de cette journée son atmosphère d’union et de fraternité qui lui valut de devenir ultérieurement la fête nationale de la République française.
Continuer la lecture de La fête de la fédération
Sous la direction de Anna Bellavitis, Laura Casella et Dorit Raines, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, 216 p.
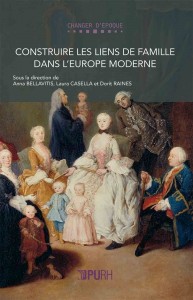
Dans le cadre de deux séminaires du programme de recherche « Modèles familiaux et cultures politiques » de l’École Française de Rome (2008-2011), organisés aux Universités de Nanterre et de Rouen, des historiens européens se sont confrontés sur la construction et l’utilisation des liens de famille dans l’Europe moderne. Le résultat est un volume qui s’insère dans les débats historiographiques actuels en interrogeant la pertinence des concepts de stratégie familiale, de transmission, de réseau et montre l’importance des choix des acteurs ainsi que le poids de la famille élargie à tous les niveaux de la société.
Continuer la lecture de Construire les liens de famille dans l'europe moderne
Michel BIARD et Jean-Numa DUCANGE (dir.), Passeurs de révolution, Paris, Société des études robespierristes, 2013, 136 p.
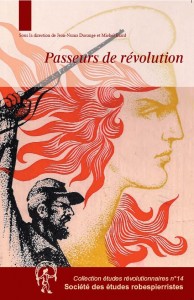
C’est peu dire que la Révolution française a suscité de multiples débats aux XIXe et XXe siècles. Souvent ceux-ci ont été présentés principalement à travers quelques idées forces ou quelques figures d’historiens ou de politiques. Le présent volume regroupe une série de contributions qui entend s’intéresser davantage aux “passeurs” concrets de la culture révolutionnaire sous diverses formes : militants, traducteurs, éditeurs, journalistes, enseignants et universitaires peu connus… “Seconds couteaux” en quelque sorte, mais sans lesquels pourtant la transmission de l’histoire de la Révolution française jusqu’à nos jours aurait été impossible.
Continuer la lecture de Passeurs de révolution
Rémi DALISSON
Rémi DALISSON, Paris, Paris, Armand Colin, 2013, 312 p.
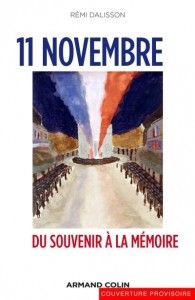 Commémorer la guerre. Une habitude que la France, depuis Sedan, n’a cessé d’entretenir pour célébrer ses glorieuses défaites ou ses retentissantes victoires. Il est peu de pays qui honore avec tant de soin, de persévérance et de moyens la mémoire des événements et des hommes, semant ici et là les monuments du souvenir. Commémorer la guerre. Une habitude que la France, depuis Sedan, n’a cessé d’entretenir pour célébrer ses glorieuses défaites ou ses retentissantes victoires. Il est peu de pays qui honore avec tant de soin, de persévérance et de moyens la mémoire des événements et des hommes, semant ici et là les monuments du souvenir.
Inventées après la déroute de 1870, ces fêtes nationales, parfois appelées « journées de guerre », se structurent tout au long de la IIIe République. Après la Grande Guerre, qui en fixe les rituels, ces célébrations deviennent le réceptacle de toutes les passions nationales. Même Vichy n’osera pas remettre en cause cet instrument d’assignation identitaire et de communion mémorielle dédié à l’écriture du roman national. La victoire des Alliés, puis les guerres coloniales, ne feront qu’enrichir et compliquer ces questions d’identité.
Menée à l’échelle du pays, mariant archives nationales et locales, l’étude de Rémi Dalisson raconte plus d’un siècle de « guerre des mémoires », mémoires toujours incandescentes, comme en témoigne la célébration polémique de la fin de la guerre d’Algérie. Il montre que les fêtes de guerre, à la différence d’autres commémorations nationales et en dépit de la disparition des acteurs, restent l’un des espaces centraux du débat politique national, l’un des lieux de mémoire primordiaux de la République.
|
Publications des doctorants |



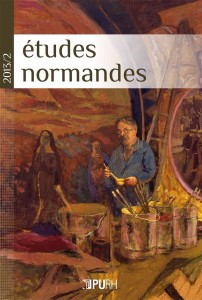
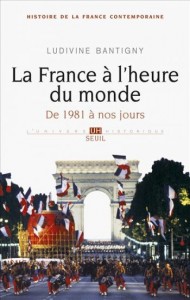
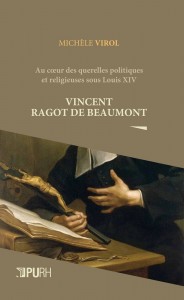

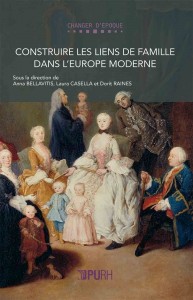
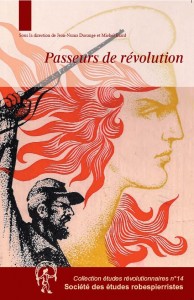
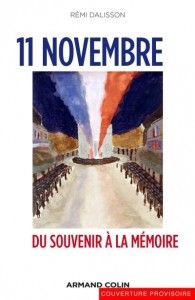 Commémorer la guerre. Une habitude que la France, depuis Sedan, n’a cessé d’entretenir pour célébrer ses glorieuses défaites ou ses retentissantes victoires. Il est peu de pays qui honore avec tant de soin, de persévérance et de moyens la mémoire des événements et des hommes, semant ici et là les monuments du souvenir.
Commémorer la guerre. Une habitude que la France, depuis Sedan, n’a cessé d’entretenir pour célébrer ses glorieuses défaites ou ses retentissantes victoires. Il est peu de pays qui honore avec tant de soin, de persévérance et de moyens la mémoire des événements et des hommes, semant ici et là les monuments du souvenir.