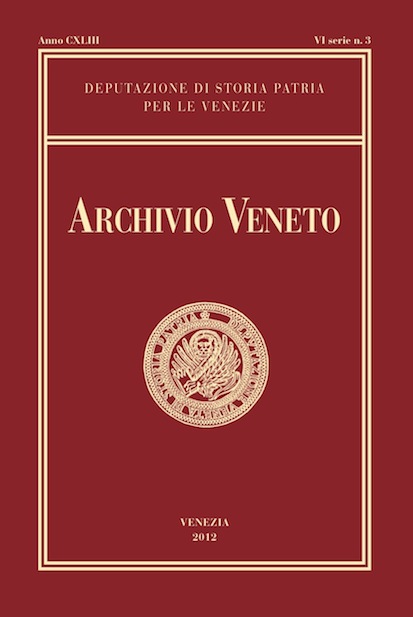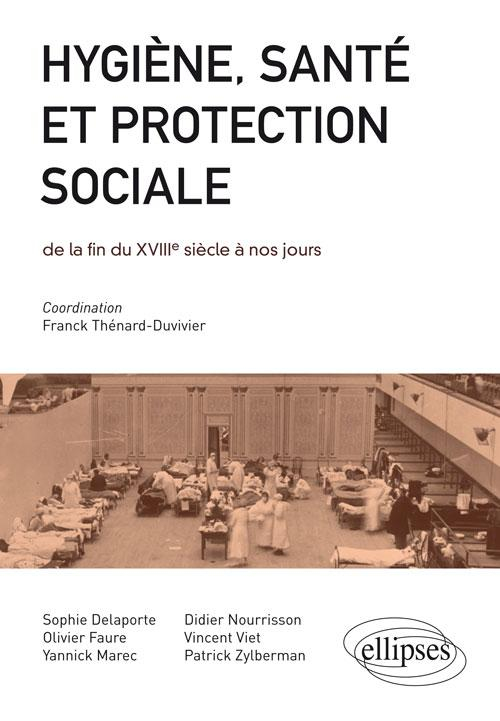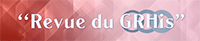|
|
Rémi DALISSON
Rémi DALISSON, Paris, CNRS Éditions, 2013, 334 p.
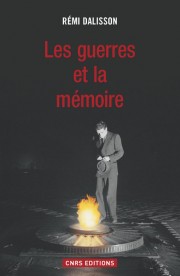
Commémorer la guerre. Une habitude que la France, depuis Sedan, n’a cessé d’entretenir pour célébrer ses glorieuses défaites ou ses retentissantes victoires. Il est peu de pays qui honore avec tant de soin, de persévérance et de moyens la mémoire des événements et des hommes, semant ici et là les monuments du souvenir.
Inventées après la déroute de 1870, ces fêtes nationales, parfois appelées « journées de guerre », se structurent tout au long de la IIIe République. Après la Grande Guerre, qui en fixe les rituels, ces célébrations deviennent le réceptacle de toutes les passions nationales. Même Vichy n’osera pas remettre en cause cet instrument d’assignation identitaire et de communion mémorielle dédié à l’écriture du roman national. La victoire des Alliés, puis les guerres coloniales, ne feront qu’enrichir et compliquer ces questions d’identité.
Menée à l’échelle du pays, mariant archives nationales et locales, l’étude de Rémi Dalisson raconte plus d’un siècle de « guerre des mémoires », mémoires toujours incandescentes, comme en témoigne la célébration polémique de la fin de la guerre d’Algérie. Il montre que les fêtes de guerre, à la différence d’autres commémorations nationales et en dépit de la disparition des acteurs, restent l’un des espaces centraux du débat politique national, l’un des lieux de mémoire primordiaux de la République.
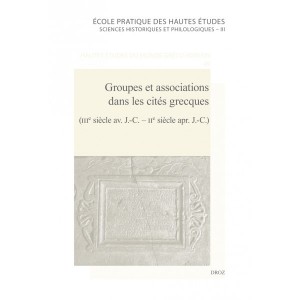 Groupes et associations dans les cités grecques (IIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle ap. J.-C.). Actes de la table ronde de Paris, INHA, 19-20 juin 2009. Groupes et associations dans les cités grecques (IIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle ap. J.-C.). Actes de la table ronde de Paris, INHA, 19-20 juin 2009.
Edités par Pierre Fröhlich et Patrice Hamon
Ecole pratique des Hautes Etudes, Sciences historiques et philologiques.
Coll. “Hautes études du monde gréco-romain”, 49
Librairie DROZ, Genève, 2013
Les cités grecques de l’époque hellénistique et impériale sont des communautés politiques vivantes, comme le reconnaissent aujourd’hui la plupart des historiens. Chacune d’entre elles constitue aussi une petite société, avec ses clivages statutaires, ses pratiques collectives, ses réseaux et ses tensions internes. Depuis une vingtaine d’années, la recherche a profondément renouvelé les perspectives sur ce monde des poleis, en faisant toutefois la part belle aux institutions politiques plutôt qu’à l’histoire sociale. Le présent ouvrage, issu d’une table ronde, se concentre sur un phénomène apparemment caractéristique de la période considérée : la floraison des divers groupes et associations qui composent, découpent et structurent les sociétés civiques. Il s’efforce de multiplier les angles de vue sur le fait associatif en mettant en parallèle les groupes du gymnase et les associations cultuelles ou professionnelles, dans les grandes cités aussi bien que dans les petites ou moyennes cités de Vieille Grèce et d’Asie Mineure. Les différents auteurs tentent en particulier d’analyser comment l’identité de chaque individu, quel que soit son statut, se construit ou s’enrichit par l’appartenance à un ou plusieurs groupes. L’enjeu est également de mieux comprendre les mutations lentes qui s’opèrent dans les communautés civiques du monde grec entre la basse époque hellénistique et le Haut Empire
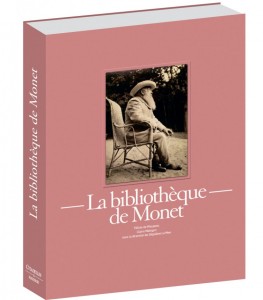 Cette anthologie abondamment illustrée propose de redécouvrir le maître impressionniste à travers les livres qu’il possédait, aujourd’hui toujours conservés en grande partie dans la bibliothèque de sa maison de Giverny. À travers cent extraits d’essais, de romans, de poésies, d’ouvrages critiques ou de guides pratiques se laissent apprécier sa culture, ses centres d’intérêts, ses goûts esthétiques et littéraires. Ces ouvrages témoignent aussi de ses amitiés dans le monde des Lettres (Mirbeau, Guitry, Mallarmé…) ainsi que du culte dont il fut l’objet de son vivant. Cette anthologie abondamment illustrée propose de redécouvrir le maître impressionniste à travers les livres qu’il possédait, aujourd’hui toujours conservés en grande partie dans la bibliothèque de sa maison de Giverny. À travers cent extraits d’essais, de romans, de poésies, d’ouvrages critiques ou de guides pratiques se laissent apprécier sa culture, ses centres d’intérêts, ses goûts esthétiques et littéraires. Ces ouvrages témoignent aussi de ses amitiés dans le monde des Lettres (Mirbeau, Guitry, Mallarmé…) ainsi que du culte dont il fut l’objet de son vivant.
Ainsi, contre les idées reçues à propos de cet artiste qui n’est souvent perçu que comme un « œil » remarquable, cette recherche inédite le replace dans un horizon de culture lettrée.
Ordonnés de manière thématique, les textes sont accompagnés d’œuvres de Monet et de ses contemporains ou de ses prédécesseurs, mais également de photographies des ouvrages, certains portant des dédicaces d’auteur ou des annotations de la main de Monet.
En collaboration avec Ségolène Le Men et Félicie de Maupeou
Editions Citadelles et Mazenod http://www.citadelles-mazenod.com
Michel BIARD
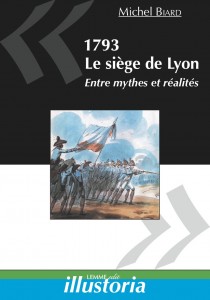 Dans l’été 1793, la seconde ville française a été déclarée en état de « rébellion » par la Convention nationale, assiégée et bombardée, avant de céder en octobre. L’histoire du siège a suscité une historiographie souvent partisane, mais aussi un martyrologe entretenu deux siècles durant. Les raisons et le déroulement de la révolte lyonnaise ont également fait naître des controverses durables. 220 ans après les faits, ce livre entend proposer une synthèse claire et dépassionnée d’un moment tragique de la Révolution. Dans l’été 1793, la seconde ville française a été déclarée en état de « rébellion » par la Convention nationale, assiégée et bombardée, avant de céder en octobre. L’histoire du siège a suscité une historiographie souvent partisane, mais aussi un martyrologe entretenu deux siècles durant. Les raisons et le déroulement de la révolte lyonnaise ont également fait naître des controverses durables. 220 ans après les faits, ce livre entend proposer une synthèse claire et dépassionnée d’un moment tragique de la Révolution.
Table des matières
Introduction
I – Un double jeu de miroirs déformants
II – Un siège en bonne et due forme ?
III – « Lyon fit la guerre à la Liberté, Lyon n’est plus »
Conclusion
Chronologie
Tableaux
Lieux à visiter
Clermont-Ferrand, Lemme Edit, 2013, 120 p.
17,90 €
Les portails de Rouen, Lyon et Avignon (XIIIe-XIVe siècles)
Franck THÉNARD-DUVIVIER
Préface de Peter KURMANN (université de Fribourg, Suisse).
 Tandis que la restauration récente des portails de la cathédrale de Rouen nous invite à redécouvrir un exceptionnel décor sculpté, cette étude propose une approche renouvelée et des clés de compréhension pour en faciliter le « décryptage ». Pourquoi le portail des Libraires se couvre-t-il, à la fin du XIIIe siècle, de près de 200 bas-reliefs figurant des animaux fabuleux et des créatures hybrides aux côtés de la Création du monde ou encore d’Adam et Ève ? Comment ce premier « modèle » rouennais a-t-il été repris au cours du XIVe siècle au portail méridional, celui de la Calende, mais aussi à la primatiale Saint-Jean de Lyon, à l’abbaye Saint-Ouen de Rouen et même au palais des papes en Avignon ? Quels enjeux artistiques, religieux voire politiques expliquent ce succès à la fois imposant (plus de 860 bas-reliefs) et limité dans le temps (fin XIIIe-mi XIVe siècle) ? Ouvrant des perspectives nouvelles dans le domaine de l’analyse iconographique, l’auteur conduit une véritable étude historique : la politique de prestige des grands prélats ; la « mise en récit » des images sculptées au seuil des cathédrales ; la culture des métamorphoses et l’incroyable inventivité des sculpteurs du Moyen Âge ; le culte des saints au cœur des rivalités entre les sanctuaires… Tandis que la restauration récente des portails de la cathédrale de Rouen nous invite à redécouvrir un exceptionnel décor sculpté, cette étude propose une approche renouvelée et des clés de compréhension pour en faciliter le « décryptage ». Pourquoi le portail des Libraires se couvre-t-il, à la fin du XIIIe siècle, de près de 200 bas-reliefs figurant des animaux fabuleux et des créatures hybrides aux côtés de la Création du monde ou encore d’Adam et Ève ? Comment ce premier « modèle » rouennais a-t-il été repris au cours du XIVe siècle au portail méridional, celui de la Calende, mais aussi à la primatiale Saint-Jean de Lyon, à l’abbaye Saint-Ouen de Rouen et même au palais des papes en Avignon ? Quels enjeux artistiques, religieux voire politiques expliquent ce succès à la fois imposant (plus de 860 bas-reliefs) et limité dans le temps (fin XIIIe-mi XIVe siècle) ? Ouvrant des perspectives nouvelles dans le domaine de l’analyse iconographique, l’auteur conduit une véritable étude historique : la politique de prestige des grands prélats ; la « mise en récit » des images sculptées au seuil des cathédrales ; la culture des métamorphoses et l’incroyable inventivité des sculpteurs du Moyen Âge ; le culte des saints au cœur des rivalités entre les sanctuaires…
> Prix Dumanoir de l’Académie des Sciences, Belles-Lettre et Arts de Rouen, 15 décembre 2012
Rouen, PURH, 2012, 340 p.
25 €
Anna BELLAVITIS, Nadia Maria FILIPPINI, Tiziana PLEBANI (dir.)
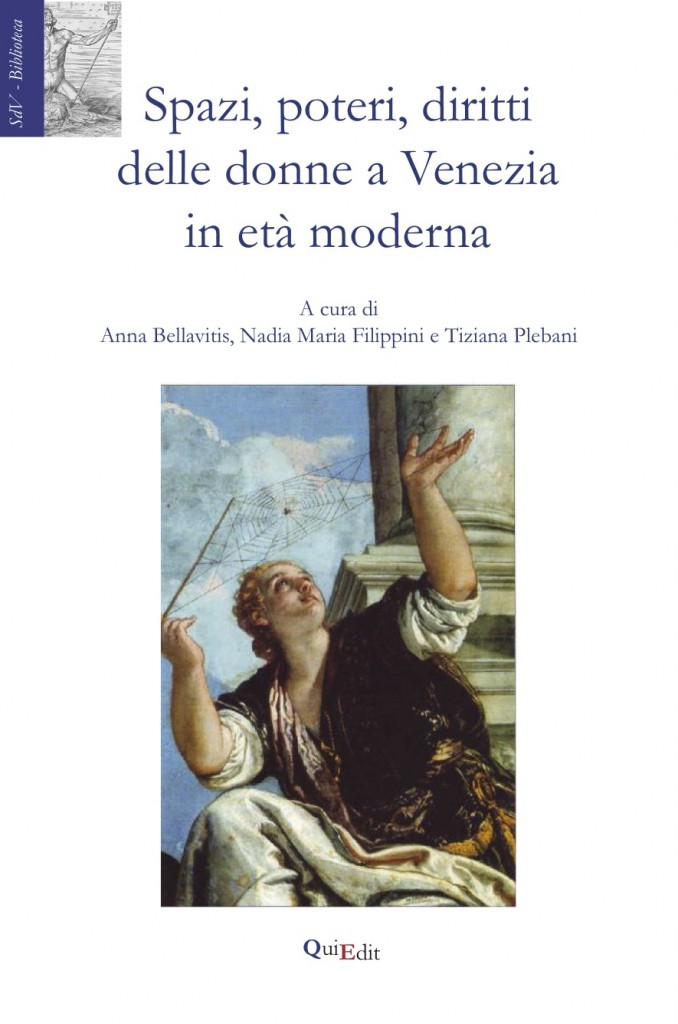 Comment vivaient les femmes à Venise à l’époque moderne ? Quels étaient leurs espaces de liberté, leurs droits et leurs pouvoirs ? Parmi les mythes qui entourent l’histoire de la Sérénissime à l’époque moderne, il y aussi celui de la liberté des femmes. Certaines parmi les plus importantes femmes de lettres de la Renaissance italienne étaient Vénitiennes, la première femme diplômée d’Université dans le monde l’était aussi. Ce volume, qui reprend une partie des interventions au colloque international Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (secc. XVI-XVIII), Venise, 8-10 mai 2008, présente les recherches les plus récentes et novatrices en la matière, en donnant ainsi une image nouvelle et différente de l’histoire de la République de Venise à l’époque moderne. Les articles, d’auteur-e-s venant d’Allemagne, Angleterre, Canada, Croatie, Etats-Unis, France, Grèce, Italie, Suisse, sont publiés en Italien, Français, Anglais. Comment vivaient les femmes à Venise à l’époque moderne ? Quels étaient leurs espaces de liberté, leurs droits et leurs pouvoirs ? Parmi les mythes qui entourent l’histoire de la Sérénissime à l’époque moderne, il y aussi celui de la liberté des femmes. Certaines parmi les plus importantes femmes de lettres de la Renaissance italienne étaient Vénitiennes, la première femme diplômée d’Université dans le monde l’était aussi. Ce volume, qui reprend une partie des interventions au colloque international Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (secc. XVI-XVIII), Venise, 8-10 mai 2008, présente les recherches les plus récentes et novatrices en la matière, en donnant ainsi une image nouvelle et différente de l’histoire de la République de Venise à l’époque moderne. Les articles, d’auteur-e-s venant d’Allemagne, Angleterre, Canada, Croatie, Etats-Unis, France, Grèce, Italie, Suisse, sont publiés en Italien, Français, Anglais.
Table des matières
Introduzione
Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani,
Parte prima : Stato, leggi e famiglie
Anna Bellavitis, La dote a Venezia tra medioevo e prima età moderna
Marija Mogorovic Crljenko, The position of woman in Istrian marriage pattern (15th-16th century)
Sabine Engel, Disciplinare le donne attraverso la pittura : Cristo e l’Adultera di Nicolo’ de Barbari (c. 1506)
Alison Smith, Strategies of political sociability : the wife of the Venetian governor (Verona, XVI sec.) p. 43
Lucien Faggion, L’inganno : amicizia e potere a Venezia (1570-1580 ca.)
Alexander Cowan, Women, gossip and marriage in early modern Venice
Kostas Lambrinos, La condizione giuridica e sociale della donna patrizia nella Creta veneziana (sec. XVI-XVII)
Claudia Andreato, Figure e voci di donne nel processo a Paolo Orgiano (1605-1607)
Fabiana Veronese, Politica e potere nella corrispondenza di Margherita Pio di Savoia (1670-1725)
Tiziana Plebani, Ragione di Stato e sentimenti nel Settecento
Francesca Cavazzana Romanelli, Storie di soggezione e di coraggio : i processi matrimoniali delle fanciulle della Pietà
Vania Santon, Maria Marcello : un divorzio di fine Settecento
Adolfo Bernardello, Un amore aristocratico sullo sfondo del tramonto della Repubblica (1790-1799)
Parte seconda : Società, cultura e religioni
Federica Ambrosini, « El cervel intrigà nelle cose della fede ». La donna veneziana dei secoli XVI-XVII a confronto con le novità religiose
Jean-François Chauvard, Madrine, commari e levatrici. Donne e parentela spirituale a Venezia nella seconda metà del Cinquecento
Isabella Palumbo Fossati Casa, Figure femminili attraverso un gruppo di inventari veneziani di fine Cinquecento
Laura Lazzari, Forme di libertà nelle opere di Lucrezia Marinelli
Carla Boccato, Aspetti patrimoniali e beneficiari nei testamenti delle donne ebree veneziane del Seicento
Francesca Medioli, Tarabotti fra omissioni e femminismo : il mistero della sua formazione
Lynn Westwater, Literary Culture and Women Writers in Seventeenth-Century Venice
Eleni Tsourapà, Nobili monache greche-veneziane tra Creta e Venezia (1645-1716)
Alexandra Melita, Female Practitioners of Magical Healing and their Networks (17th-18th centuries)
Adelisa Malena, Fra conversione, penitenza e possessione. La vita di Alvisa Zambelli, ebrea convertita (1734)
Caroline Giron-Panel, Gli ospedali : luoghi e reti di socialità femminili nel XVIII secolo
Ilaria Crotti, La locandiera : una figura della realtà sociale nella rappresentazione di Goldoni
Marcello Della Valentina, Il setificio salvato dalle donne. Le tessitrici veneziane nel Settecento
Valeria Palumbo, Bellino, Casanova e i finti cavalieri. Ovvero il paradosso delle cantatrice
Eve Marie Lampron, Sociabilité et réseautage entre les femmes de lettres vénitiennes (1770-1830)
Quiedit, 2012, 394 p.
25 €
Présentés et édités par Michel BIARD
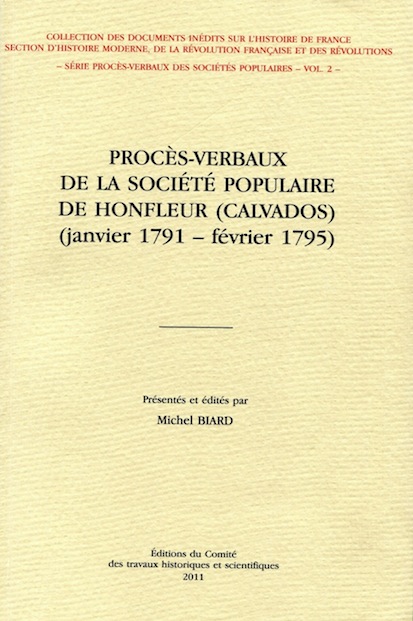 Ce volume s’inscrit dans une collection lancée par les Éditions du CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), fruit d’une enquête nationale sur les sociétés politiques (clubs) de la Révolution française. Il est également le premier d’une série de trois volumes consacrés à des sociétés normandes dans le cadre du projet GRR Sorev (dirigé par Michel Biard). En 2013 suivront un volume sur Bernay (Bernard Bodinier et André Goudeau, membres du GRHIS) puis un sur Montivilliers (Éric Saunier et Éric Wauters, membres du CIRTAI). Ce travail sur Honfleur comprend l’intégralité des procès-verbaux de la société politique de cette petite ville du Calvados de 1791 à 1795, ainsi qu’un appareil critique (introduction, notes, annexes, etc.) qui permettra à chacun(e) de se plonger dans la vie politique au quotidien pendant ces années décisives de la Révolution. Ce volume s’inscrit dans une collection lancée par les Éditions du CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), fruit d’une enquête nationale sur les sociétés politiques (clubs) de la Révolution française. Il est également le premier d’une série de trois volumes consacrés à des sociétés normandes dans le cadre du projet GRR Sorev (dirigé par Michel Biard). En 2013 suivront un volume sur Bernay (Bernard Bodinier et André Goudeau, membres du GRHIS) puis un sur Montivilliers (Éric Saunier et Éric Wauters, membres du CIRTAI). Ce travail sur Honfleur comprend l’intégralité des procès-verbaux de la société politique de cette petite ville du Calvados de 1791 à 1795, ainsi qu’un appareil critique (introduction, notes, annexes, etc.) qui permettra à chacun(e) de se plonger dans la vie politique au quotidien pendant ces années décisives de la Révolution.
Éditions du CTHS (Documents inédits sur l’histoire de France), 2011, 820 p.
60 €
Philippe BOURDIN et Michel BIARD (dir.), Paris, Armand Colin, 2012, 288 p.
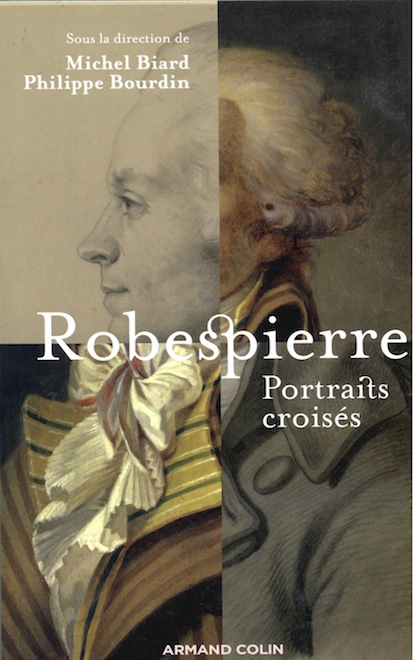 Personnage froid et calculateur, monstre dénué de tout sentiment allant jusqu’à sacrifier ses amis, dictateur, voire précurseur « des totalitarismes » du XXe siècle… ou l’un des plus grands hommes d’État français, protagoniste majeur de la Révolution, « Incorruptible », héros maltraité par deux siècles d’une légende noire tenace ? Maximilien Robespierre ne laisse point indifférent, loin s’en faut, et les querelles historiographiques sont si prégnantes que l’historien Marc Bloch eut ce mot : « Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce ; par pitié, dites-nous simplement : quel fut Robespierre ? » Mais comment dire simplement ce qui, par nature, se compose d’évolutions, de contradictions, de combats ? Comment autrement qu’en réinterrogeant en permanence l’homme et l’œuvre pour mieux les appréhender, à la lumière tant des archives que de l’historiographie ? Loin du panégyrique tout autant que du rejet brutal, le présent ouvrage propose des réflexions synthétiques, consacrées à quinze thèmes essentiels, qui aideront le lecteur à construire, enrichir ou nuancer son opinion. Personnage froid et calculateur, monstre dénué de tout sentiment allant jusqu’à sacrifier ses amis, dictateur, voire précurseur « des totalitarismes » du XXe siècle… ou l’un des plus grands hommes d’État français, protagoniste majeur de la Révolution, « Incorruptible », héros maltraité par deux siècles d’une légende noire tenace ? Maximilien Robespierre ne laisse point indifférent, loin s’en faut, et les querelles historiographiques sont si prégnantes que l’historien Marc Bloch eut ce mot : « Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce ; par pitié, dites-nous simplement : quel fut Robespierre ? » Mais comment dire simplement ce qui, par nature, se compose d’évolutions, de contradictions, de combats ? Comment autrement qu’en réinterrogeant en permanence l’homme et l’œuvre pour mieux les appréhender, à la lumière tant des archives que de l’historiographie ? Loin du panégyrique tout autant que du rejet brutal, le présent ouvrage propose des réflexions synthétiques, consacrées à quinze thèmes essentiels, qui aideront le lecteur à construire, enrichir ou nuancer son opinion.
Table des matières
Michel Biard (Professeur à l’université de Rouen, GRHIS) et Philippe Bourdin (Professeur à l’université Clermont II, CHEC), Robespierre en questions
Hervé Leuwers (Professeur à l’université Lille 3, IRHIS), Un avocat entre le Palais et l’espace public
Claude Mazauric (Professeur émérite à l’université de Rouen, GHRIS), Maximilien Robespierre dans l’ombre vivante de Jean-Jacques Rousseau
Peter McPhee (Professeur à l’université de Melbourne), La jeunesse de Maximilien Robespierre et ses attitudes envers la famille pendant la Révolution
Jean-Pierre Gross (Docteur en histoire), Robespierre, militant des droits de l’homme et du citoyen
Jean Bart (Professeur émérite à l’université de Bourgogne), Robespierre et l’abolition du “ meurtre juridique ”Bernard Gainot (Maître de conférences à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, IHRF), Robespierre et la question coloniale
Marc Belissa (Maître de conférences à l’université Paris Ouest, CHISCO), Robespierre et la guerre
Philippe Bourdin (Professeur à l’université de Clermont-Ferrand, CHEC), L’éducation selon Robespierre
Paul Chopelin (Maître de conférences à l’université Lyon 3, LARHRA), Le mythe du « grand prêtre » de la Révolution. Robespierre, la religion et l’Être Suprême
Jean-Pierre Jessenne (Professeur émérite à l’université Lille 3, IRHIS), Robespierre, au défi de l’égalité et des politiques sociales
Pierre Serna (Professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, IHRF), Robespierre fait la Polis (janvier 1793-avril 1794)
Guillaume Mazeau (Maître de conférences à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, IHRF), Robespierre dictateur ?
Michel Biard, (Professeur à l’université de Rouen, GRHIS), La double mort de Robespierre
Annie Duprat (Professeur à l’université de Versailles-Saint-Quentin) et Laurent Bihl, Incarner la Révolution : les figures de Robespierre
Jean-Numa Ducange et Pascal Dupuy (Maîtres de conférences à l’université de Rouen, GRHIS), Historiographie et postérité : « Par pitié, dites-nous simplement : quel fut Robespierre » (Marc Bloch)
Chronologie
Bibliographie
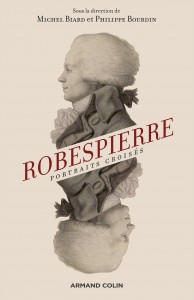 Seconde édition 2014. Seconde édition 2014.
Anna BELLAVITIS et Linda GUZETTI (dir.)
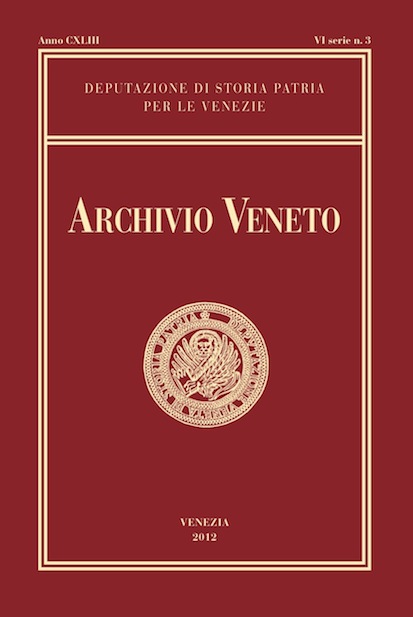 Ce numéro spécial de la revue Archivio veneto, dirigé par Anna Bellavitis (GRHIS, Université de Rouen) et Linda Guzzetti (Technische Universität, Berlin), est consacré au travail et aux activités économiques des femmes à Venise et dans la Terre Ferme vénitienne, au Moyen Âge et à l’Époque Moderne. Une partie des articles est issue des communications au congrès de la Renaissance Society of America, qui s’est tenu à Venise en avril 2010. Les articles présentent, pour les derniers siècles du Moyen Âge, les droits économiques des femmes selon les Statuts vénitiens (Fernanda Sorelli) ; leurs investissements dans l’économie maritime et dans les activités de prêt (Linda Guzzetti) et leur rôle dans la production et dans le commerce de tissus en soie et or (Paula Clarke). Les articles sur l’époque moderne étudient les entreprises de production de la soie gérées par des femmes de la noblesse à Vicence (Edoardo Demo) et, à Venise, la production de livres sur la dentelle à l’usage des femmes (Tiziana Plebani) ; les activités de couture dans les couvents féminins (Isabella Campagnol) ; les modalités de l’apprentissage féminin (Anna Bellavitis) et les activités des maîtresses tisserandes en soie (Marcello Della Valentina). Ce numéro spécial de la revue Archivio veneto, dirigé par Anna Bellavitis (GRHIS, Université de Rouen) et Linda Guzzetti (Technische Universität, Berlin), est consacré au travail et aux activités économiques des femmes à Venise et dans la Terre Ferme vénitienne, au Moyen Âge et à l’Époque Moderne. Une partie des articles est issue des communications au congrès de la Renaissance Society of America, qui s’est tenu à Venise en avril 2010. Les articles présentent, pour les derniers siècles du Moyen Âge, les droits économiques des femmes selon les Statuts vénitiens (Fernanda Sorelli) ; leurs investissements dans l’économie maritime et dans les activités de prêt (Linda Guzzetti) et leur rôle dans la production et dans le commerce de tissus en soie et or (Paula Clarke). Les articles sur l’époque moderne étudient les entreprises de production de la soie gérées par des femmes de la noblesse à Vicence (Edoardo Demo) et, à Venise, la production de livres sur la dentelle à l’usage des femmes (Tiziana Plebani) ; les activités de couture dans les couvents féminins (Isabella Campagnol) ; les modalités de l’apprentissage féminin (Anna Bellavitis) et les activités des maîtresses tisserandes en soie (Marcello Della Valentina).
Archivio Veneto, VI serie, n° 3, 2012
Venise, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 2012
Franck THÉNARD-DUVIVIER (coord.)
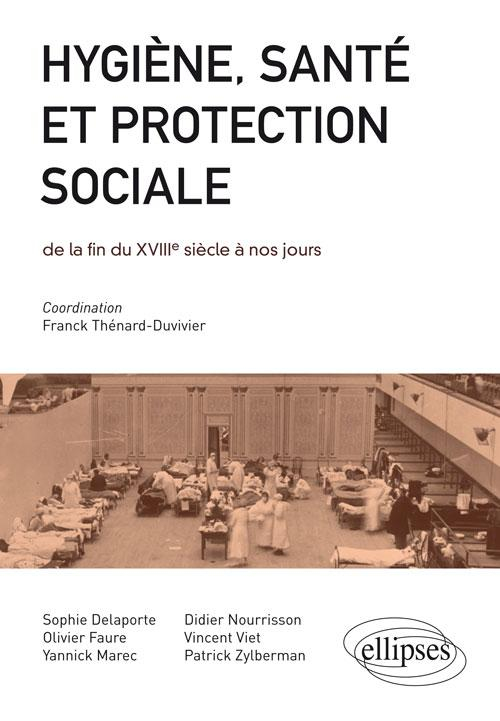
Conçu dans la perspective du concours des Écoles normales supérieures et de l’École des chartes — dont le programme porte sur « Hygiène et santé en Europe de la fin du XVIIIe siècle aux lendemains de la Première Guerre mondiale » —, cet ouvrage propose à la fois un état de la recherche historique et un outil complet pour une préparation efficace. Il réunit quinze contributeurs spécialistes de la santé et de la protection sociale (université, CNRS, EHESP, EN3S, etc.) ou professeurs en lettres supérieures. Il est organisé en quatre parties : 1) Le point sur la recherche offre les synthèses inédites de chercheurs et d’universitaires, tous spécialistes reconnus de la question au programme ; 2) Les contrepoints élargissent la réflexion au système de santé français et à la gestion des risques sanitaires aux États-Unis et en Europe ; 3) Les sujets corrigés, proposés par des professeurs en première supérieure, sont l’occasion de faire le point sur la méthode de la dissertation tout en apportant des compléments aux études des chercheurs ; 4) Les outils permettent de comprendre et d’approfondir les thèmes du programme : comptes rendus d’ouvrages, chronologie, glossaire, bibliographie et sitographie. [Extrait]
Table des matières
I – LE POINT SUR LA RECHERCHE
Hygiène, santé et protection sociale de la fin du XVIIIe siècle aux années 1920
Didier Nourrisson (Lyon1), La santé, un savoir-vivre en société. Intentions et pratiques de l’hygiénisme au XIXe siècle
Olivier Faure (Lyon 3), Les patients face à la maladie et à la médecine en France : un rôle actif ? Fin XVIIIe siècle-début XXe siècle
Sophie Delaporte (Amiens), Soigner les corps entre 1914 et 1918
Vincent Viet (CNRS-Cermes 3), La santé publique pendant la Grande Guerre
Patrick Zylberman (EHESP), Destruction massive, désorganisation massive : la grippe « espagnole » (1918-1920)
Yannick Marec (Rouen), La protection sociale en France : la construction d’une République sociale ? De la Révolution à la veille de la Seconde Guerre mondiale
II – CONTREPOINTS
Les enjeux actuels des politiques de santé
Pierre Ramon-Baldié (EN3S), Jean-Christophe Baudin (MGEN) et Norbert Deville (CETAF), Les enjeux actuels du système de santé français
Patrick Zylberman (EHESP), Un souffle d’apathie. L’Union européenne et la sécurité sanitaire (1997-2006)
III – SUJETS ET CORRIGÉS
Franck Thénard-Duvivier, Mise au point : la dissertation d’histoire au concours de l’ENS
Cédric Grimoult, Hygiénisme et hygiénistes en Europe de la fin du XVIIIe siècle aux lendemains de la Première Guerre mondiale
Marie-Odile Bonardi, Vivre et mourir à Paris au XIXe siècle
Vincent Hérail, Être bien portant dans l’Europe de la fin du XVIIIe siècle aux lendemains de la Première Guerre mondiale
Michel Fauquier, Le travail c’est la santé ? La question de l’état sanitaire des populations ouvrières en Europe de la fin du XVIIIe siècle à la veille de la Première Guerre mondiale
IV – OUTILS
Les ouvrages indispensables
Glossaire
Les grandes figures de l’hygiène et de la santé en Europe
Les grandes dates de la santé et de la protection sociale en Europe
Bibliographie et sitographie
Paris, Ellipses, 2012, 288 p. (schémas, graphiques, ill. NB).
23 €
|
Publications des doctorants |
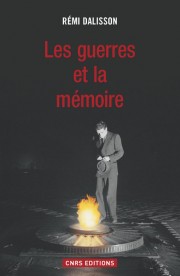


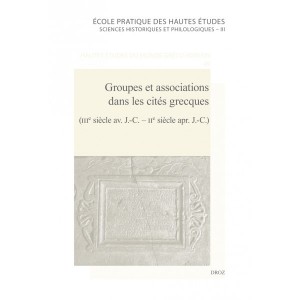
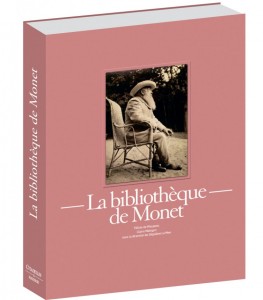
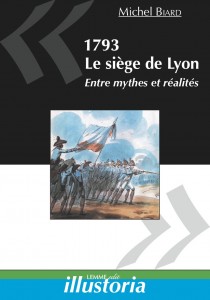 Dans l’été 1793, la seconde ville française a été déclarée en état de « rébellion » par la Convention nationale, assiégée et bombardée, avant de céder en octobre. L’histoire du siège a suscité une historiographie souvent partisane, mais aussi un martyrologe entretenu deux siècles durant. Les raisons et le déroulement de la révolte lyonnaise ont également fait naître des controverses durables. 220 ans après les faits, ce livre entend proposer une synthèse claire et dépassionnée d’un moment tragique de la Révolution.
Dans l’été 1793, la seconde ville française a été déclarée en état de « rébellion » par la Convention nationale, assiégée et bombardée, avant de céder en octobre. L’histoire du siège a suscité une historiographie souvent partisane, mais aussi un martyrologe entretenu deux siècles durant. Les raisons et le déroulement de la révolte lyonnaise ont également fait naître des controverses durables. 220 ans après les faits, ce livre entend proposer une synthèse claire et dépassionnée d’un moment tragique de la Révolution.  Tandis que la restauration récente des portails de la cathédrale de Rouen nous invite à redécouvrir un exceptionnel décor sculpté, cette étude propose une approche renouvelée et des clés de compréhension pour en faciliter le « décryptage ». Pourquoi le portail des Libraires se couvre-t-il, à la fin du XIIIe siècle, de près de 200 bas-reliefs figurant des animaux fabuleux et des créatures hybrides aux côtés de la Création du monde ou encore d’Adam et Ève ? Comment ce premier « modèle » rouennais a-t-il été repris au cours du XIVe siècle au portail méridional, celui de la Calende, mais aussi à la primatiale Saint-Jean de Lyon, à l’abbaye Saint-Ouen de Rouen et même au palais des papes en Avignon ? Quels enjeux artistiques, religieux voire politiques expliquent ce succès à la fois imposant (plus de 860 bas-reliefs) et limité dans le temps (fin XIIIe-mi XIVe siècle) ? Ouvrant des perspectives nouvelles dans le domaine de l’analyse iconographique, l’auteur conduit une véritable étude historique : la politique de prestige des grands prélats ; la « mise en récit » des images sculptées au seuil des cathédrales ; la culture des métamorphoses et l’incroyable inventivité des sculpteurs du Moyen Âge ; le culte des saints au cœur des rivalités entre les sanctuaires…
Tandis que la restauration récente des portails de la cathédrale de Rouen nous invite à redécouvrir un exceptionnel décor sculpté, cette étude propose une approche renouvelée et des clés de compréhension pour en faciliter le « décryptage ». Pourquoi le portail des Libraires se couvre-t-il, à la fin du XIIIe siècle, de près de 200 bas-reliefs figurant des animaux fabuleux et des créatures hybrides aux côtés de la Création du monde ou encore d’Adam et Ève ? Comment ce premier « modèle » rouennais a-t-il été repris au cours du XIVe siècle au portail méridional, celui de la Calende, mais aussi à la primatiale Saint-Jean de Lyon, à l’abbaye Saint-Ouen de Rouen et même au palais des papes en Avignon ? Quels enjeux artistiques, religieux voire politiques expliquent ce succès à la fois imposant (plus de 860 bas-reliefs) et limité dans le temps (fin XIIIe-mi XIVe siècle) ? Ouvrant des perspectives nouvelles dans le domaine de l’analyse iconographique, l’auteur conduit une véritable étude historique : la politique de prestige des grands prélats ; la « mise en récit » des images sculptées au seuil des cathédrales ; la culture des métamorphoses et l’incroyable inventivité des sculpteurs du Moyen Âge ; le culte des saints au cœur des rivalités entre les sanctuaires…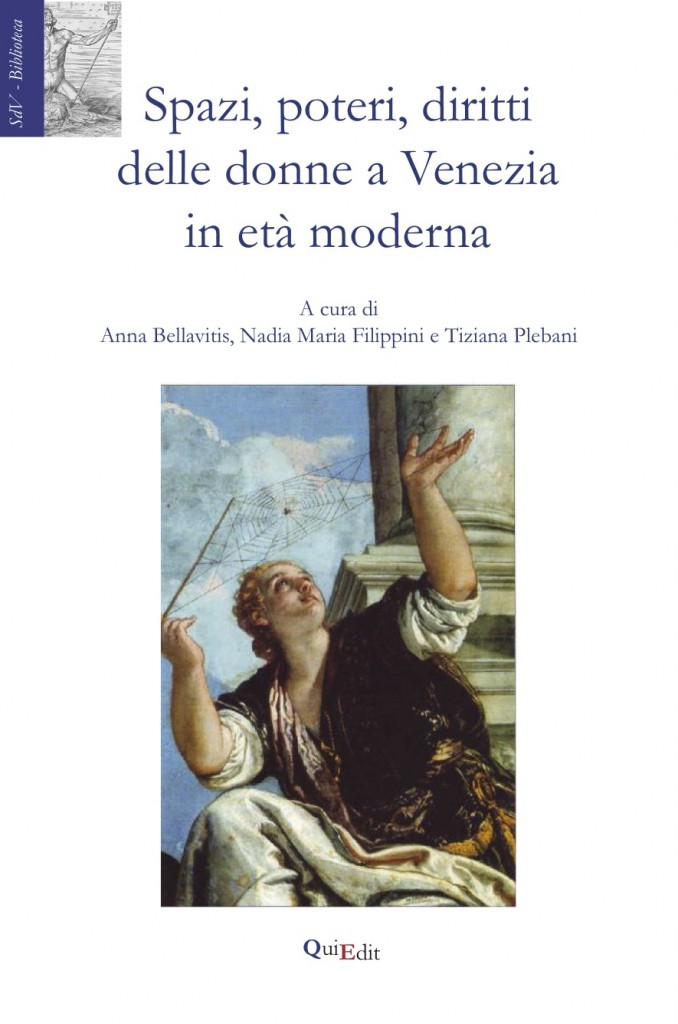 Comment vivaient les femmes à Venise à l’époque moderne ? Quels étaient leurs espaces de liberté, leurs droits et leurs pouvoirs ? Parmi les mythes qui entourent l’histoire de la Sérénissime à l’époque moderne, il y aussi celui de la liberté des femmes. Certaines parmi les plus importantes femmes de lettres de la Renaissance italienne étaient Vénitiennes, la première femme diplômée d’Université dans le monde l’était aussi. Ce volume, qui reprend une partie des interventions au colloque international Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (secc. XVI-XVIII), Venise, 8-10 mai 2008, présente les recherches les plus récentes et novatrices en la matière, en donnant ainsi une image nouvelle et différente de l’histoire de la République de Venise à l’époque moderne. Les articles, d’auteur-e-s venant d’Allemagne, Angleterre, Canada, Croatie, Etats-Unis, France, Grèce, Italie, Suisse, sont publiés en Italien, Français, Anglais.
Comment vivaient les femmes à Venise à l’époque moderne ? Quels étaient leurs espaces de liberté, leurs droits et leurs pouvoirs ? Parmi les mythes qui entourent l’histoire de la Sérénissime à l’époque moderne, il y aussi celui de la liberté des femmes. Certaines parmi les plus importantes femmes de lettres de la Renaissance italienne étaient Vénitiennes, la première femme diplômée d’Université dans le monde l’était aussi. Ce volume, qui reprend une partie des interventions au colloque international Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (secc. XVI-XVIII), Venise, 8-10 mai 2008, présente les recherches les plus récentes et novatrices en la matière, en donnant ainsi une image nouvelle et différente de l’histoire de la République de Venise à l’époque moderne. Les articles, d’auteur-e-s venant d’Allemagne, Angleterre, Canada, Croatie, Etats-Unis, France, Grèce, Italie, Suisse, sont publiés en Italien, Français, Anglais.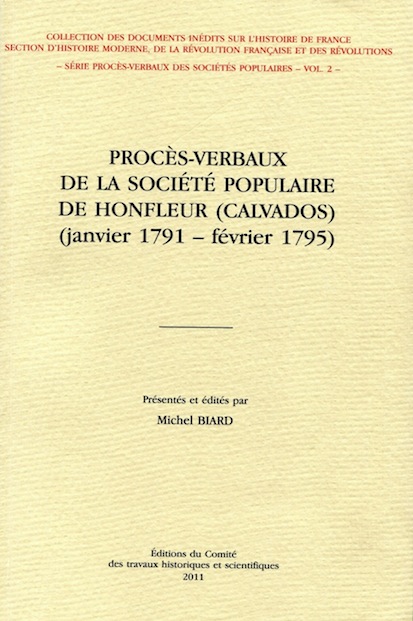 Ce volume s’inscrit dans une collection lancée par les Éditions du CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), fruit d’une enquête nationale sur les sociétés politiques (clubs) de la Révolution française. Il est également le premier d’une série de trois volumes consacrés à des sociétés normandes dans le cadre du projet GRR Sorev (dirigé par Michel Biard). En 2013 suivront un volume sur Bernay (Bernard Bodinier et André Goudeau, membres du GRHIS) puis un sur Montivilliers (Éric Saunier et Éric Wauters, membres du CIRTAI). Ce travail sur Honfleur comprend l’intégralité des procès-verbaux de la société politique de cette petite ville du Calvados de 1791 à 1795, ainsi qu’un appareil critique (introduction, notes, annexes, etc.) qui permettra à chacun(e) de se plonger dans la vie politique au quotidien pendant ces années décisives de la Révolution.
Ce volume s’inscrit dans une collection lancée par les Éditions du CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), fruit d’une enquête nationale sur les sociétés politiques (clubs) de la Révolution française. Il est également le premier d’une série de trois volumes consacrés à des sociétés normandes dans le cadre du projet GRR Sorev (dirigé par Michel Biard). En 2013 suivront un volume sur Bernay (Bernard Bodinier et André Goudeau, membres du GRHIS) puis un sur Montivilliers (Éric Saunier et Éric Wauters, membres du CIRTAI). Ce travail sur Honfleur comprend l’intégralité des procès-verbaux de la société politique de cette petite ville du Calvados de 1791 à 1795, ainsi qu’un appareil critique (introduction, notes, annexes, etc.) qui permettra à chacun(e) de se plonger dans la vie politique au quotidien pendant ces années décisives de la Révolution.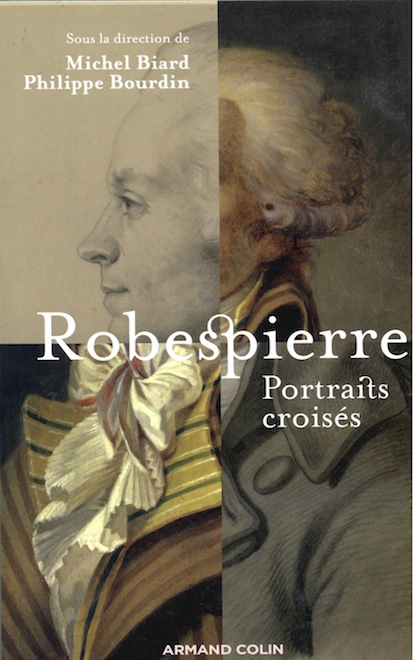 Personnage froid et calculateur, monstre dénué de tout sentiment allant jusqu’à sacrifier ses amis, dictateur, voire précurseur « des totalitarismes » du XXe siècle… ou l’un des plus grands hommes d’État français, protagoniste majeur de la Révolution, « Incorruptible », héros maltraité par deux siècles d’une légende noire tenace ? Maximilien Robespierre ne laisse point indifférent, loin s’en faut, et les querelles historiographiques sont si prégnantes que l’historien Marc Bloch eut ce mot : « Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce ; par pitié, dites-nous simplement : quel fut Robespierre ? » Mais comment dire simplement ce qui, par nature, se compose d’évolutions, de contradictions, de combats ? Comment autrement qu’en réinterrogeant en permanence l’homme et l’œuvre pour mieux les appréhender, à la lumière tant des archives que de l’historiographie ? Loin du panégyrique tout autant que du rejet brutal, le présent ouvrage propose des réflexions synthétiques, consacrées à quinze thèmes essentiels, qui aideront le lecteur à construire, enrichir ou nuancer son opinion.
Personnage froid et calculateur, monstre dénué de tout sentiment allant jusqu’à sacrifier ses amis, dictateur, voire précurseur « des totalitarismes » du XXe siècle… ou l’un des plus grands hommes d’État français, protagoniste majeur de la Révolution, « Incorruptible », héros maltraité par deux siècles d’une légende noire tenace ? Maximilien Robespierre ne laisse point indifférent, loin s’en faut, et les querelles historiographiques sont si prégnantes que l’historien Marc Bloch eut ce mot : « Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce ; par pitié, dites-nous simplement : quel fut Robespierre ? » Mais comment dire simplement ce qui, par nature, se compose d’évolutions, de contradictions, de combats ? Comment autrement qu’en réinterrogeant en permanence l’homme et l’œuvre pour mieux les appréhender, à la lumière tant des archives que de l’historiographie ? Loin du panégyrique tout autant que du rejet brutal, le présent ouvrage propose des réflexions synthétiques, consacrées à quinze thèmes essentiels, qui aideront le lecteur à construire, enrichir ou nuancer son opinion.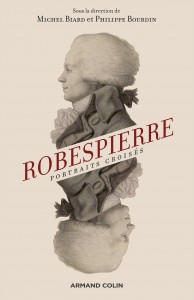 Seconde édition 2014.
Seconde édition 2014.