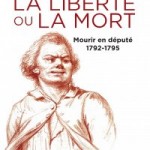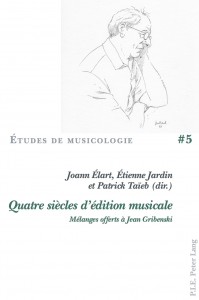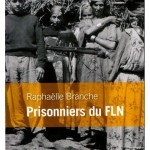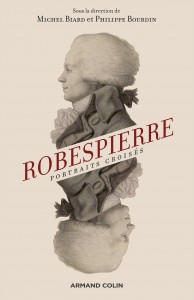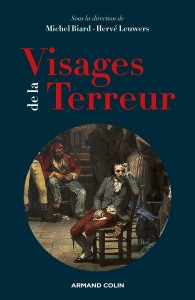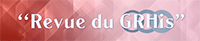|
|
Michel Biard, La Liberté ou la mort. Mourir en député 1792-1795, Paris, Tallandier, 2015.
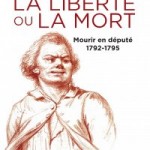 Michel Biard, La Liberté ou la mort. Mourir en député, 1792-1795, Paris, Tallandier, 2015 Entre 1792 et 1795, 86 membres de la Convention nationale ont eu une mort non naturelle. Comment sont décédés ces hommes dont la devise était « La Liberté ou la mort » ? Sous le couperet de la guillotine ? Assassinés ? Suicidés ? En prison, en mission ou en déportation ? Pendant deux siècles, l’historiographie s’est emparée de cette question politiquement sensible, avec des visions partisanes : ici favorables aux Girondins, là aux Montagnards, parfois hostiles aux deux. Fondé sur des archives inédites, l’ouvrage présente les rouages juridiques qui ont permis ces éliminations politiques. Le Peletier et Marat sont aussi deux cas célèbres, assassinés en 1793, puis entrés au Panthéon. Mais qui connaît tous les autres itinéraires particuliers ? Plus complexes, ils sont révélés par les sources policières, judiciaires et médicales, et donnent chair au récit. Au fil des chapitres, Michel Biard s’interroge sur les origines et les conséquences de ces morts brutales. Il offre une vision neuve des luttes politiques et des épurations successives de la Convention au temps de la « Terreur »
Informations sur le site de l’éditeur
1♦ La Convention nationale, une assemblée meurtrie.
Une décimation de fait. Rythmes et géographie de la mort.
Une mort qui ne frappe pas à l’aveuglette.
2♦ Des Girondins aux « martyrs de prairial » : une historiographie partisane.
Le magasin aux accessoires de la légende dorée.
Un exemple de légende dorée : Le « dernier banquet » des Girondins.
3♦ Arrêter et accuser un représentant du peuple.
Quelle immunité pour un membre de l’Assemblée ?
Décrets d’arrestation, d’accusation ou de mise hors de la loi ?
Des captifs plus ou moins bien gardés.
4♦ Le « rasoir national » ou la mort ignominieuse.
Le temps de l’interrogatoire, ou le champ des possibles restreint.
Des condamnations à mort au terme de quels procès ?
Le « théâtre de la guillotine ».
5♦« Mourir en Romain », le choix du suicide.
Un contexte propice et un profil particulier ?
De la mise en scène aux doutes, quelles traces de l’ultime geste politique ?
6♦ Assassiner un représentant du peuple, un parricide ?
Assassinat, crime de lèse-nation, parricide.
Le Peletier et Marat, deux assassinats lourds de sens politique.
Exécution sommaire et meurtre collectif, deux autres visages de l’assassinat.
7♦ La mort du héros et la mort du proscrit.
Risquer sa vie et périr les armes à la main.
La déportation au service de l’élimination politique, la Guyane et l’invention de la « guillotine sèche ».
8♦ Du récit exemplaire de la mort à la panthéonisation.
Deux représentants assassinés et inhumés au Panthéon.
Les représentants restés aux portes du Panthéon.
Joann Élart, Étienne Jardin et Patrick Taïeb (dir.)
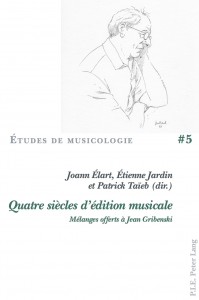
Le présent ouvrage ne prétend pas proposer une histoire de l’édition de musique de 1550 à nos jours. Il consiste en une collection d’études explorant un versant foisonnant de l’histoire de la musique, l’édition musicale, depuis les premiers imprimés et l’insertion de portées dans les périodiques anciens jusqu’à la restitution critique des musiques du passé. Les approches retenues portent sur l’objet lui-même et ses techniques autant que sur des critères purement musicaux ; sur les relations entre l’activité des éditeurs avec le concert et la scène ; ou encore sur les questions de choix de sources et les partis pris de restitution dans le domaine de l’édition musicologique contemporaine. Il est aussi un recueil de textes conçus en hommage à Jean Gribenski, dont l’enseignement à la Sorbonne, puis à l’Université de Poitiers, a reposé sur une méthode historique accordant au document une attention méticuleuse. Chaque texte s’appuie donc, comme l’enseignement du maître, sur un document dont l’analyse vise à éclairer des pratiques artistiques, sociales, commerciales ou scientifiques. Conçus par des collègues et d’anciens étudiants, il profite des avancées spectaculaires de la recherche dans le domaine de l’histoire de l’édition musicale française au cours des quarante dernières années.
Informations sur le site de l’éditeur
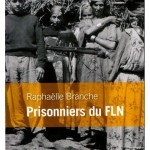
Raphaëlle Branche était l’invitée d’Au miroir de Clio ce dimanche, 23 novembre 2014. On y a notamment parlé de son dernier livre, Prisonniers du FLN, Paris, Payot, 2014.
L’émission est disponible à l’écoute ici :
 Direction de la collection : Anna Bellavitis et Sophie Devineau Direction de la collection : Anna Bellavitis et Sophie Devineau
Le concept de genre ou de construction historique et culturelle des rapports sociaux de sexes, des hiérarchies entre les hommes et les femmes et des identités sexuées structure les codes sociaux qui sont à lire, décrypter, comprendre et à réinventer à chaque époque pour les deux sexes. Les publications universitaires de Rouen et du Havre contribuent à l’entreprise intellectuelle par la collection “Genre à lire … et à penser” qui propose une série de volumes issus de travaux individuels ou collectifs dont la pluridisciplinarité est un gage de richesse en connaissances à constituer par la communauté des chercheur(e)s. Tous les publics sont concernés, avec au premier chef les étudiant(e)s, les enseignant(e)s, les formateurs-trices et plus généralement tous les acteurs-trices des politiques publiques.
Catalogue de la collection sur le site de l’éditeur.
 En 1917, le ministère français des Beaux-Arts et de l’Instruction publique envoie plus de 90 artistes au front pour témoigner plastiquement de la guerre. Ces artistes, souvent postés dans une zone située entre l’arrière et le front, dépeindront non pas la guerre mais leur guerre. D’autres artistes, ceux de la génération du feu, comme l’allemand Otto Dix, livrent un témoignage sur le vif d’artiste-soldat. Autant d’œuvres qui inscrivent une rupture dans l’évolution plastique de ces artistes. En 1917, le ministère français des Beaux-Arts et de l’Instruction publique envoie plus de 90 artistes au front pour témoigner plastiquement de la guerre. Ces artistes, souvent postés dans une zone située entre l’arrière et le front, dépeindront non pas la guerre mais leur guerre. D’autres artistes, ceux de la génération du feu, comme l’allemand Otto Dix, livrent un témoignage sur le vif d’artiste-soldat. Autant d’œuvres qui inscrivent une rupture dans l’évolution plastique de ces artistes.
Interview / Claire Maingon
Date : 2013
Lien vers la vidéo.
Philippe BOURDIN et Michel BIARD (dir.)
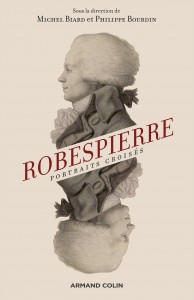 Personnage froid et calculateur, monstre dénué de tout sentiment allant jusqu’à sacrifier ses amis d’hier, dictateur aux pleins pouvoirs, voire précurseur « des totalitarismes » du XXe siècle… où bien l’un des plus grands hommes d’État de l’histoire de France, protagoniste majeur de la Révolution, « Incorruptible », héros maltraité par deux siècles d’une légende noire tenace ? Personnage froid et calculateur, monstre dénué de tout sentiment allant jusqu’à sacrifier ses amis d’hier, dictateur aux pleins pouvoirs, voire précurseur « des totalitarismes » du XXe siècle… où bien l’un des plus grands hommes d’État de l’histoire de France, protagoniste majeur de la Révolution, « Incorruptible », héros maltraité par deux siècles d’une légende noire tenace ?
Maximilien Robespierre ne laisse point indifférent, loin s’en faut, et les querelles historiographiques sont légion à son propos, si prégnantes que l’historien Marc Bloch eut ce mot : « Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce ; par pitié, dites-nous simplement : quel fut Robespierre ? ».
Mais comment dire simplement ce qui, par nature, se compose d’évolutions, de contradictions, de tensions, de combats ? Comment autrement qu’en réinterrogeant en permanence l’homme et l’œuvre pour mieux les appréhender, à la lumière tant des archives que de l’historiographie ?
Loin du panégyrique tout autant que du rejet brutal, le présent ouvrage propose aux lecteurs des réflexions synthétiques, consacrées à quinze thèmes essentiels, qui aideront chacune et chacun à construire, enrichir ou nuancer son opinion.
Agrégé d’histoire, Michel Biard est professeur d’histoire du monde moderne et de la Révolution française à l’université de Rouen. Président de la Société des études robespierristes depuis 2011, il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire politique et culturelle de la période révolutionnaire.
Professeur d’histoire moderne à l’Université Blaise-Pascal (Clermont 2) et ancien président de la Société des études robespierristes, Philippe Bourdin est spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la Révolution française, sur laquelle il a écrit ou dirigé une vingtaine d’ouvrages et de numéros de revues.
Table des matières :
Introduction.
Robespierre en questions. Un avocat entre le Palais et l’espace public (Hervé Leuwers).
Maximilien Robespierre dans l’ombre vivante de Jean-Jacques Rousseau (Claude Mazauric).
La jeunesse de Maximilien Robespierre et ses attitudes envers la famille pendant la Révolution (Peter McPhee).
Robespierre, militant des droits de l’homme et du citoyen (Jean-Pierre Gross).
Robespierre et l’abolition du « meurtre juridique » (Jean Bart).
Robespierre et la question coloniale (Bernard Gainot).
Robespierre et la guerre (Marc Belissa).
L’éducation selon Robespierre (Philippe Bourdin).
Le mythe du « grand prêtre » de la Révolution. Robespierre, la religion et l’Être Suprême (Paul Chopelin).
Robespierre, au défi de l’égalité et des politiques sociales (Jean-Pierre Jessenne).
Robespierre fait la polis – janvier 1793-avril 1794 (Pierre Serna).
Robespierre dictateur ? (Guillaume Mazeau).
La double mort de Robespierre (Michel Biard).
Incarner la Révolution : les figures de Robespierre (Laurent Bihl et Annie Duprat).
Historiographie et postérité : « Par pitié, dites-nous simplement : quel fut Robespierre » Marc Bloch (Jean-Numa Ducange et Pascal Dupuy).
Notice sur le site de l’éditeur.
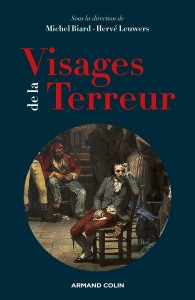 Michel Biard, Hervé Leuwers (dir), Armand Colin, 2014, 272p. Michel Biard, Hervé Leuwers (dir), Armand Colin, 2014, 272p.
De toutes les années de la Révolution française, celles de la Terreur sont sans doute les plus complexes, tant la jeune république de l’an II doit se construire dans une période de divisions politiques, de tensions extrêmes, de guerre intérieure et extérieure.
Paradoxalement, les années 1793-1794 se cristallisent pourtant en des images brutales et univoques : la Vendée militaire, la guillotine, les suspects, Robespierre… Le décalage dit son impact mémoriel, son actualité toujours vive.
Pour comprendre les enjeux, les tensions et les contradictions de l’an II, une quinzaine de spécialistes livrent leurs analyses. Ensemble, ils brossent un tableau contrasté d’une Terreur qui ne ressemble pas toujours à celle que l’on imagine.
Table des matières
Michel Biard et Hervé Leuwers. Introduction
Malcolm Crook. Les révoltes « fédéralistes » et les origines de la Terreur en 1793.
Haim Burstin. Terreur d’en haut, Terreur d’en bas.
Annie Jourdan. La journée du 5 septembre 1793. La terreur a-t-elle été à l’ordre du jour ?
Serge Aberdam et Danièle Pingué. Les comités de surveillance, des rouages de la Terreur ?
Annie Crépin. Une armée et une guerre d’exception ?
Paul Chopelin. La défanatisation de l’an II. Anticléricalisme et laïcisation radicale dans la nation en guerre.
Jean-Luc Chappey. La « Terreur », temps des pédagogues ?
Philippe Bourdin. Au théâtre sous la Terreur.
Dominique Godineau. Visages féminins de la Terreur.
Jean-Clément Martin. Dénombrer les victimes de la Terreur. La Vendée et au-delà.
Laurent Brassart. « L’autre Terreur » : portrait d’une France (presque) épargnée.
Michel Biard. La mort à la Convention. Des représentants dans l’oeil du cyclone (1793-1794).
Hervé Leuwers. Robespierre, la Terreur incarnée ? Aux origines d’une personnification de l’an II.
Anna Karla. Mémoire et Mémoires de la Terreur.
Laurent Bihl et Annie Duprat. La Veuve et ses amants. L’imaginaire de la guillotine aux XIXe et XXe siècles.
Notice sur le site de l’éditeur.
|
Publications des doctorants |