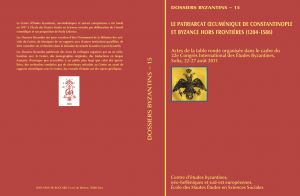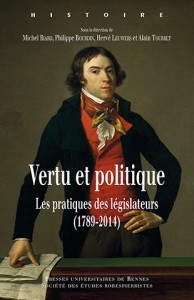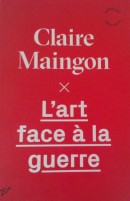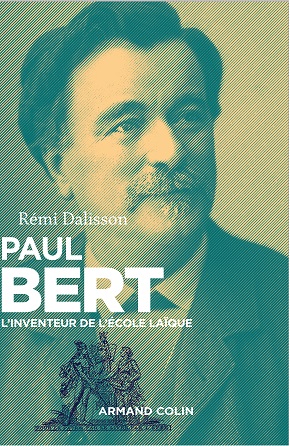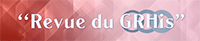|
|
Dan Ioan MURESAN, maître de conférences à l’Université de Rouen, et Marie-Hélène BLANCHET, chargée de recherche au CNRS, étaient les invités de l’émission Orthodoxie sur France Culture, pour parler des recherches des historiens contemporains sur le fonctionnement, le rayonnement et le rôle du Patriarcat œcuménique de Constantinople entre la prise de Constantinople par les Croisés (1204) et l’expulsion du Patriarcat de son siège à l’église de la Pammakaristos (1586).
Qu’est-ce que le GRHis ? Quels sont ses activités, ses effectifs ? La réponse en vidéo, par Michel Biard, directeur du GRHis :
Yannick Marec, Professeur des Universités en histoire moderne à l’université de Rouen et membre du GRHis, revient dans l’émission “Au Miroir de Clio” sur le livre qu’il a coordonné sur La Normandie du XIXe siècle ; entre Tradition et Modernité.
L’émission est disponible à l’écoute ici :
 |
L’étude de la sculpture à l’époque contemporaine (du XIXe siècle à nos jours) a désormais sa revue scientifique. Portée par les Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH), elle est annuelle. Centrée sur l’étude d’une temporalité associée à la naissance de la modernité, la revue Sculptures propose d’ouvrir le débat sur des thématiques larges (la performance, la guerre, l’exposition…). Volontairement diachronique, elle souhaite montrer l’existence de créations et de transformations, de permanences et de recyclages intellectuels, théoriques et pratiques dans le champ d’une discipline majeure des beaux-arts. La revue croise les regards autour d’enjeux historiques, épistémologiques, sociologiques, philosophiques, techniques et iconographiques. Chaque livraison comprend une partie thématique et une partie varia.
Ont contribué à ce numéro : Claire Barbillon, Annette Becker, Renaud Bouchet, Pierre Buraglio, Cécilie Champy-Vinas, Alexandra Charvier, Sébastien Clerbois, Marie Helene Desjardins, Itzhak Goldberg, Juliette Lavie, Francoise Magny, Claire Maingon, Laure de Margerie, Pascale Martinez, Aude Nicolas, Chloé Pirson, Marie-Pascale Prevost-Bault, Emmanuelle Raingeval.
|
La sculpture et la guerre, la sculpture dans la guerre, la sculpture en guerre. . .
LA SCULPTURE ET LA GUERRE
- La baïonnette et le burin : les monuments du camp de Châlons (1857-1869), par Aude Nicolas
- La Grande Guerre au musée Grévin, par Pascale Martinez
- La Grande Guerre vue par un sculpteur. Une histoire métallique de la guerre 1914-1918 de Pierre Roche, par Cécilie Champy-Vinas
- L’atelier des masques. Quand la sculpture se fait soin, par Emmanuelle Raingeval
- Sculptures, installations contemporaines et commémorations de la Grande Guerre : un deuil infini, par Annette Becker
- Denkmal et Mahnmal, par Itzhak Goldberg
VARIA
- Arman et la sculpture participative, 1960-1970, par Renaud Bouchet
- Jean-Paul Riopelle (1923-2002), sculpteur : le devenir des formes, par Alexandra Charvier
NOTES ET DOCUMENTS
- Pierre Buraglio – Les sculptures de l’Historial de la Grande Guerre : entre classicisme et renouveau de la statuaire, par Marie-Pascale Prevost-Bault
ACTUALITÉS
- Le Répertoire de sculpture française, une nouvelle ressource en ligne, par Laure de Margerie
- Inauguration d’un musée de sculptures à Nogent-sur-Seine. Le musée Camille Claudel, par Francoise Magny
- Homère chantant des poésies. Un relief d’Alfred Boucher retrouvé et restauré, par Marie-Helene Desjardins
COMPTES RENDUS
- Chloé Pirson, Berlinde de Bruyckere : corps d’âme (musée d’Art moderne de la ville de Gand)
- Claire Maingon, David Altmejd, Flux (musée d’Art moderne de la ville de Paris)
- Juliette Lavie, Niki de Saint Phalle (Paris, Grand Palais)
- Sébastien Clerbois, Sculpture Victorious. Art in an Age of Invention, 1837-1901 (Tate Britain)
- Claire Maingon, Le Relief au croisement des arts du XIXe siècle (Claire Barbillon)
- Calendrier des expositions
Actes de la table ronde organisée dans le cadre du 22e Congrès International des Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011, éd. M.-H. Blanchet, M.-H. Congourdeau et D. I. Mureşan, Paris, 2014 [Dossiers byzantins, 15].
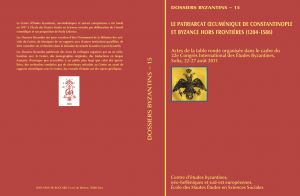 |
Ce volume rassemble 16 études autour d’un même thème : l’autorité et le rayonnement de l’Église grecque en Orient entre le XIIIe et le XVIe siècle, au-delà des étroites frontières de l’Empire byzantin d’abord, puis, après 1453, dans un Empire devenu ottoman. Ces recherches originales ont été présentées lors d’une table ronde du 22e Congrès International des Études byzantines de Sofia (2011) et s’organisent dans l’ouvrage selon quatre axes thématiques. Dans une première partie, les auteurs s’intéressent aux transformations internes de la représentation que le patriarcat œcuménique se faisait de son autorité spirituelle et politique durant la dernière période byzantine. Une deuxième partie s’attache ensuite à la matérialité de l’exercice du pouvoir, soit dans la pratique de la chancellerie patriarcale (notamment durant la crise palamite) soit dans le fonctionnement du synode permanent, relais essentiel à travers lequel le patriarche exerce son pouvoir en tant que chef de l’Église byzantine. Une troisième partie se penche au plus près sur les difficiles emboîtements de juridiction entre le patriarcat œcuménique, d’un côté, et certaines métropoles éloignées comme celle de Kiev, les nouveaux patriarcats balkaniques, l’archevêché d’Ohrid et enfin les autres patriarcats orientaux. Enfin, dans une quatrième partie, les auteurs s’intéressent aux diverses formes de résilience mises en œuvre au sein du patriarcat œcuménique à l’époque ottomane pour assurer la perpétuation idéologique, institutionnelle et patrimoniale de l’Église orthodoxe dans les conditions difficiles de la domination d’un pouvoir musulman. |
Table des matières
- Introduction / Dan Ioan Muresan
- Remerciements
Redéfinitions du pouvoir patriarcal
- Rassembler et rénover une Église en crise : la politique ecclésiale du patriarche Germain II (1223-1240) / Michel Stavrou
- Le patriarche Athanase Ier et les arsénites : une lettre patriarcale contre les schismatiques / Ionut-Alexandru Tudorie
- The Ecumenical Patriarch as Mediator. Patriarch and Emperor in the Palaiologan Period / Alexandru Stefan Anca
- Frontières géographiques et liturgiques dans la lettre d’Antoine IV au grand prince de Moscou / Petre Guran
L’institution ecclésiastique en acte(s)
- Das Patriarchatsregister als Spiegel der Religionspolitik : Registerfuhrung unter dem palamiten Isidoras I. (1347-1350) / Christian Gastgeber
- I «protocolli» delle riunioni sinodali (Regestes, n° 1549, 1567, 3424 [=2352 a]) / Luca Pieralli
- Calculating the Synod ? New Quantitative and Qualitative Approaches for the Analysis of the Patriarchate and the Synod of Constantinople in the 14th c. / Johannes Preiser-Kapeller
- Information Channels Leading to the Patriarchate of Constantinople in the 14th c. / Ekaterini Mitsiou
Extension et rétraction des espaces juridictionnels
- Le patriarche Kallistus Ier, les moines bulgares et le Myron / Marie-Hélène Congourdeau
- Le patriarcat œcuménique et les patriarcats balkaniques (Tarnovo, Peć). Enjeux ecclésiaux et impériaux au XIVe s. / Dan Ioan Muresan
- Emperor Manuel II and Patriarch Euthymios II on the Jurisdiction of the Church of Ohrid / Günter Prinzing
- Le titre officiel des métropolites russes au Moyen Âge / Konstantinos Vetochnikov
- Le patriarcat de Constantinople et le rejet de l’union de Florence par les patriarches orientaux en 1443. Réexamen du dossier documentaire / Marie-Hélène Blanchet
Eléments de continuité institutionnelle
- Les «frontières» d’un patriarcat œcuménique / Dimitris G. Apostolopoulos
- Institutions du patriarcat œcuménique concernant les fidèles intra muros et hors frontières / Machi Païzi-Apostolopoulou
- Les relations entre les monastères et le patriarcat de Constantinople à l’intérieur des frontières ottomanes au XVIe s. : quelques hypothèses / Youli Evangelou
Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Leuwers et Alain Tourret (dir.), Vertu et politique – Les pratiques des législateurs (1789-2014), Rennes, Presses Universitaires de Rennes -Société des études robespierristes, 2015, 440 p.
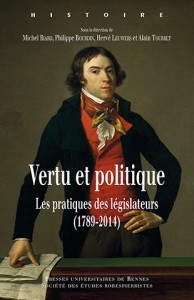 |
Depuis la Révolution française, c’est dans la vie parlementaire que s’est exprimée l’exigence de vertu publique. Comment concevoir et encadrer les actes d’un citoyen au service du Souverain ? Pour garantir sa vertu, faut-il limiter ses pouvoirs, le nombre ou la durée de ses mandats ? Jusqu’où la parole et le geste du député sont-ils libres, couverts par l’« inviolabilité » décrétée dès 1789 ? Quelques cas de députés corrompus peuvent-ils suffire à jeter le discrédit sur leurs collègues et à faire naître en France les premiers germes d’un antiparlementarisme ? |
Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’éditeur.
Table des matières
Préface d’Alain Tourret, député du Calvados
Introduction, Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Leuwers
Conférence inaugurale Michel Vovelle (professeur émérite d’Histoire, IHRF – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Le vice sous la Révolution française ».
Formuler la vertu comme exigence politique
- Marisa Linton (reader in History, Kingston University, Londres), « Les racines de la vertu politique et ses significations au XVIIIe siècle ».
- Philippe Bordes (professeur d’Histoire de l’Art moderne, Université Lyon 2), « La vertu chancelante : une relecture des exempla picturaux du XVIIIe siècle ».
- Céline Spector (professeure de Philosophie, SPH – Université Bordeaux Montaigne), « La vertu politique comme principe de la démocratie. Robespierre lecteur de Montesquieu».
- Stéphanie Roza (docteur en Philosophie, Ater à l’Université de Grenoble), « Vertu privée vs vertu publique, dilemme du républicanisme rousseauiste ».
- Annie Jourdan (professeure d’Histoire à l’Université d’Amsterdam), « Vertu et politique chez les pères fondateurs américains ».
La Révolution française et la vertu (1).
La vertu et la politique
- Malcolm Crook (professeur d’Histoire, Université de Keele), « Les hommes de la continuité ? La rééligibilité des législateurs en question (1791-1795) ».
- Michel Biard (professeur d’Histoire, GRHis – Normandie Université, Rouen), « Il est un temps où le silence est un acte de sagesse, il est aussi un temps où le silence est un acte de lâcheté ».
- Gaid Andro (docteure en Histoire, CERHIO – Université de Rennes 2), « L’appel nominal : de la technique de vote à l’impératif de vertu »
- Bernard Gainot (maître de conférences honoraire en Histoire, IHRF – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Le lobby colonial face à la représentation politique pendant la Révolution française (1789 – 1802) ».
- Dominique Godineau (professeure d’Histoire, CERHIO – Université de Rennes 2), « Surveiller la vertu politique ou tyranniser l’Assemblée ? Le rôle des tribunes publiques pendant la Révolution française ».
La Révolution française et la vertu (2).
La vertu publique malmenée ?
- Serge Aberdam (chercheur au département de sciences sociales de l’INRA), « Mesurer les votes populaires en 1793, 1795 et 1800. Pour savoir, comparer ou frauder ? ».
- Alexandre Guermazi (doctorant en Histoire, IRHIS – Université Lille 3), « Les législateurs face aux demandes de vertu des citoyens parisiens : du contrôle au rappel des mandataires du peuple (novembre 1792-juin 1793) ».
- Alain Cohen (docteur en Histoire), « Les Inspecteurs de la salle : un comité en charge de l’administration générale sous la Révolution française (1789-1795) ».
- Philippe Bourdin (Professeur d’Histoire, CHEC – Université Blaise-Pascal Clermont 2), « Fortunes et représentation au crépuscule de la Convention ».
- Richard Flamein (docteur en Histoire, GRHis – Normandie Université, Rouen), « “L’ambivalente vertu en matière de finances” : députés et formation des lobbies financiers en Révolution (1785-1800) ».
- Elisabeth Cross (doctorante en Histoire, Université de Harvard), « L’anatomie d’un scandale : l’Affaire de la Compagnie des Indes revisitée (1793-1794) ».
Corriger ou instrumentaliser le manque de vertu
(XIX-XXe siècle) ?
- Alain Bonnet (professeur d’Histoire de l’Art, Université Pierre Mendès-France, Grenoble), « La vertu sur un piédestal. Les grands hommes et le culte de la Révolution dans la statuaire publique».
- Cécile Guérin-Bargues (professeure de Droit public, CRJ Pothier – Université d’Orléans), « L’inviolabilité des révolutionnaires ou la naissance d’une curieuse tradition parlementaire ».
- Jean-Claude Caron (professeur d’Histoire, Chec – Université Blaise Pascal Clermont 2), « Vertus de la politique, vices du parlementarisme. Les critiques de la représentation élue dans la France du XIXe siècle ».
- François Fourn (docteur en Histoire) « La vertu sans la terreur : le choix de quatre théoriciens du socialisme français au milieu du xixe siècle ».
- Jean Garrigues (professeur d’Histoire, POLEN – Université d’Orléans), « La vertu parlementaire en question : l’exemple du scandale de Panama ».
- Frédéric Monier (professeur d’Histoire, Centre N. Elias – Université d’Avignon), «La vertu au premier rang » ? Socialistes et communistes français face à la corruption (1892-1941) ».
- Nathalie Dompnier (professeure en Sociologie politique, Triangle – Université Lumière Lyon II), « Une croisade contre l’individualisme et la décadence : les vertus du maréchal Pétain ».
- Nathalie Castagnez (maîtresse de conférences d’Histoire, POLEN – Université d’Orléans), « Les espoirs déçus de la Libération : épurer et rénover la République au Parlement (1944-1953) ».
- Fabien Conord (maître de conférences d’Histoire, CHEC – Université Blaise-Pascal Clermont 2), « Vertu et politique en France de la Libération à nos jours ».
En conclusion, une table ronde
- « Robespierre et la vertu » (Marc Belissa [maître de conférences HDR en Histoire, Université Paris X], Hervé Leuwers [professeur d’Histoire, Université de Lille 3], Claude Mazauric [professeur émérite d’Histoire, GRHis – Normandie Université], Marco Marin [chercheur en Histoire, Université de Trieste], Annie Geffroy [chercheuse, CNRS])
Postface de Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale
Claire Maingon, L’Art face à la Guerre, 2015, Presse Universitaires de Vincennes, 168p.
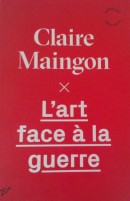 |
Prévert s’écrie « Quelle connerie la guerre ! » dans son célèbre poème Barbara. Mais la guerre, nourrie par la pulsion de mort qu’a théorisée Freud, est aussi ce « fait social total » analysé par Marcel Mauss, qui bouleverse et stimule tous les plans de la société, y compris la création artistique. Cet ouvrage vise à analyser les quatre réponses principales de l’art et des artistes à la guerre, à travers les temps : la représentation de la guerre en tant qu’événement historique, l’usage des arts dans la guerre à des fins de propagande ou de protection, l’art comme expression marquante du refus ou de la dénonciation de la guerre, et, enfin, la création d’une mémoire artistique de la guerre pour les périodes de paix. |
Plus de renseignements sont disponibles sur le site de l’éditeur.
Table des matières
Introduction
L’artiste pris dans la guerre
- Des artistes sur le champ de bataille
- Peinture d’histoire et peinture militaire
- Prémonitions de la guerre
- Images de la violence ? L’exemple de 14-18
- Le réalisme photographique
- L’image qui dérange : l’esthétique de la mort
- La guerre par procuration : création et médias
L’art au service de la guerre
- L’image-culte du chef de guerre
- L’héroïsme guerrier
- L’art moderne et la guerre : le futurisme (1909-1942)
- Le camouflage
- Des artistes utiles à la propagande
- Une architecture de guerre ?
Quand l’art dénonce la guerre
- Les désastres humains
- Des messages pour la paix
- Dénoncer le totalitarisme et le colonialisme
- Résister : A Paris sous l’occupation allemande
De la mémoire de la guerre
- Ruines
- Cicatrices
- Mémoire et fictions
- Monuments
- Montrer la guerre : du spectacle au musée
Conclusion
Bibliographie
Index
Conférence du 21 mai 2015 par Rémi Dalisson, dans le cadre de l’Université de Toutes les Cultures.
Pour en savoir plus sur les publications en lien avec cette conférence, cliquez ici.
La vidéo peut être regardée ici :
Yannick Marec (coord.), Jean-Pierre Daviet, Bernard Garnier, Jean Laspougeas et Jean Quellien, 2015, Editions Ouest France, 608p.
 |
L’image traditionnelle de la Normandie, celle des herbages, de la vache normande, du camembert, du cidre et du calvados, voir celle de l’élevage des chevaux de course, s’est largement construite au XIXe siècle. En réalité, les éléments de cette image convenue sont plutôt une traduction de la modernité normande. Si le XIXe siècle est, presque partout, le siècle des Révolutions, la Normandie est précocement touchée : révolution agricole, révolution des transports, révolution industrielle, au moins celle des mécaniques textiles.
Faut-il y voir l’influence de la proximité anglaise, c’est-à-dire de facteurs exogènes, ou l’émergence de facteurs endogènes ? Mais la Normandie est aussi une terre d’élection des sociétés savantes, du tourisme balnéaire et de l’impressionnisme, une terre connaissant une reconstruction et un essor du religieux avant l’anticléricalisme de la Troisième République,un pays qui a donné naissance ou abrité des penseurs et des acteurs politiques qui ont marqué le siècle et au-delà.
Au total, cette synthèse illustrée ne néglige ni la diversité des “pays” normands, ni la profonde identité provinciale. |
Par Rémi Dalisson, membre du GRHis et professeur des Universités en histoire contemporaine à l’Université-ESPE de Rouen.
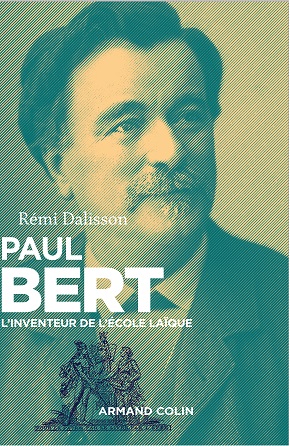 |
Qui n’a pas étudié dans un établissement scolaire Paul Bert ou habité rue Paul Bert ? Or, malgré cette omniprésence dans l’espace public, l’œuvre de ce républicain est largement oubliée de nos jours. Paul Bert fut pourtant l’un des plus grands scientifiques français du XIXe siècle et un des pères fondateurs de l’école laïque et républicaine. S’il a été un partisan de la colonisation, notamment en Indochine, on retiendra de lui le grand patriote, traumatisé par la défaite de 1870, compagnon de Gambetta, Ferry et Buisson qui a laissé une loi sur la généralisation des Écoles normales et rédigé un fameux manuel d’éducation civique. Rémi Dalisson réhabilite ici la mémoire de ce savant engagé en politique, de ce libre-penseur qui voulait émanciper les consciences par la raison et l’école. Paul Bert pousse aussi à la réflexion sur la mémoire, sur la citoyenneté et sur l’éthique républicaine, dans le contexte d’un retour de la morale laïque et civique, alors que se multiplient les crispations identitaires. |
Plus d’informations sur le site Internet d’Armand Colin…
|
Publications des doctorants |