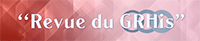|
|
Écrivains et journalistes face à la violence d’État (16e-20e siècle)
Michel BIARD (dir.)
 Mise à l’écart brutale des opposants, répression sauvage des révoltes, atrocités sans nom des crimes contre les civils, brutalités des armées, le déchaînement de la violence par les États est une triste constante de l’histoire. Face cette violence, les hommes de plume sont souvent parmi les premiers à prendre parti, notamment lorsque leurs écrits antérieurs les ont plutôt amenés vers des positions de tolérance, voire d’humanisme. N’en restent pas moins les faits et l’explication de ceux-ci présentée par les gouvernants. Au nom de la défense de la religion, au nom du salut public, au nom de la défense nationale, au nom de toutes les explications à leur disposition, ils s’empressent de justifier la violence par eux déchaînée et espèrent trouver des relais à leurs justifications chez les hommes de plume. Certains finissent par adhérer à cette thèse des « circonstances » qui explique tout et rend la violence d’État sinon juste, à tout le moins tolérable. D’autres, au contraire, participent de ce que Peter Weiss nommait « l’esthétique de la résistance », et utilisent leur plume pour dire ce qui paraît indicible, pour témoigner au nom de l’humanité brisée. Mise à l’écart brutale des opposants, répression sauvage des révoltes, atrocités sans nom des crimes contre les civils, brutalités des armées, le déchaînement de la violence par les États est une triste constante de l’histoire. Face cette violence, les hommes de plume sont souvent parmi les premiers à prendre parti, notamment lorsque leurs écrits antérieurs les ont plutôt amenés vers des positions de tolérance, voire d’humanisme. N’en restent pas moins les faits et l’explication de ceux-ci présentée par les gouvernants. Au nom de la défense de la religion, au nom du salut public, au nom de la défense nationale, au nom de toutes les explications à leur disposition, ils s’empressent de justifier la violence par eux déchaînée et espèrent trouver des relais à leurs justifications chez les hommes de plume. Certains finissent par adhérer à cette thèse des « circonstances » qui explique tout et rend la violence d’État sinon juste, à tout le moins tolérable. D’autres, au contraire, participent de ce que Peter Weiss nommait « l’esthétique de la résistance », et utilisent leur plume pour dire ce qui paraît indicible, pour témoigner au nom de l’humanité brisée.
Le présent numéro des Cahiers du GRHis entend croiser des portraits de ces hommes de plume face à la violence déchaînée par certains États. Cette réflexion à plusieurs voix, portant sur des thèmes allant de la première modernité au 20e siècle, nous permet de mieux appréhender l’une des facettes de l’identité de l’homme de plume, qu’il soit écrivain ou journaliste : un témoin face à la violence, comme ont pu l’être par leurs œuvres un Callot ou un Goya.
Table des matières
Michel Biard, Introduction
Pierre-Jean Souriac, Juger la guerre civile. Écrire l’histoire des troubles religieux dans la deuxième moitié du 16e siècle
Katia Beguin, La fuite royale de 1649 : une violence d’État oubliée
Alain Hugon, Les violences au cours de la révolte napolitaine (1647-1648) et des révoltes andalouses (1647-1652)
Bernard Gainot, La presse métropolitaine et la violence coloniale en novembre 1791
Michel Biard, Lemaire et le Courier de l’Égalité. Les évolutions d’un journaliste « Brissotin » face aux violences politiques (printemps-été 1793)
Odile Roynette, Écrivains et journalistes, témoins et acteurs de la violence de la guerre (Sedan, 1870)
Paul Pasteur, S’adapter ou résister ? Les journalistes et écrivains autrichiens et l’Anschluss
Jean-Claude Vimont, Les pamphlets d’épurés incarcérés après la Libération
Rouen, PURH, Cahiers du GRHIS, n° 20, 2009
24 x 16 cm – 176 p. – 16 €
ISBN : 978-2-87775-465-1 – ISSN : 1263-9737
Un itinéraire d’historien
Yannick MAREC
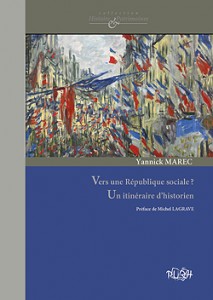 Aboutissement de plusieurs décennies de recherche, l’ouvrage envisage divers cheminements de la « République sociale ». Son sous-titre « Culture politique, patrimoine et protection sociale aux 19e et 20e siècles » donne l’orientation générale des études qui sont à l’origine de ce livre abondamment illustré. Aboutissement de plusieurs décennies de recherche, l’ouvrage envisage divers cheminements de la « République sociale ». Son sous-titre « Culture politique, patrimoine et protection sociale aux 19e et 20e siècles » donne l’orientation générale des études qui sont à l’origine de ce livre abondamment illustré.
Une attention particulière est d’abord portée à la diffusion de la quantification comme critère de modernité. Les rapports entre culture et politique sont envisagés à partir d’exemples tirés de l’édition et de la littérature, de la correspondance égyptologique de Paul Guieysse et de l’approche historiographique du constituant Jacques-Guillaume Thouret. Les enjeux de la protection sociale sont évoqués par le biais de l’étude de quelques acteurs individuels (Wilfred Monod, Jules Siegfried, Richard Waddington…) et collectifs (la franc-maçonnerie, les médecins normands). L’approche historique du patrimoine de la protection sociale, effectuée sous différents angles, permet de relier les traces du passé aux questions d’actualité.
Rouen, PURH, 2009
24 x 17 cm – 544 p. – 39 €
ISBN : 978-2-87775-476-7 – ISSN : 1959-321x
L’hôpital et ses alternatives du Moyen Âge à nos jours
Yannick MAREC (dir.)
 Durant des siècles, les hôpitaux ont été principalement des centres d’accueil et d’hébergement pour pèlerins et malades indigents. Cependant, progressivement, ils se sont affirmés comme des centres de soins, devenant même des points d’ancrage essentiels des nouvelles avancées thérapeutiques. L’histoire pluriséculaire des hôpitaux contribue également à leur donner une dimension patrimoniale qui les met au cœur des démarches identitaires propres à notre époque. En même temps, l’hospitalo-centrisme en matière de soins peut donner lieu à de fortes critiques qui ont suscité, depuis longtemps, l’apparition d’alternatives ou de complémentarités à l’hospitalisation. Durant des siècles, les hôpitaux ont été principalement des centres d’accueil et d’hébergement pour pèlerins et malades indigents. Cependant, progressivement, ils se sont affirmés comme des centres de soins, devenant même des points d’ancrage essentiels des nouvelles avancées thérapeutiques. L’histoire pluriséculaire des hôpitaux contribue également à leur donner une dimension patrimoniale qui les met au cœur des démarches identitaires propres à notre époque. En même temps, l’hospitalo-centrisme en matière de soins peut donner lieu à de fortes critiques qui ont suscité, depuis longtemps, l’apparition d’alternatives ou de complémentarités à l’hospitalisation.
Cet ouvrage, aux approches pluridisciplinaires, cherche à en donner des traductions diversifiées à partir des contributions présentées lors d’une rencontre organisée à Fécamp en janvier 2006. À l’occasion du transfert de l’hôpital de cette cité, qui fut le siège d’une abbaye renommée, ont ainsi été abordés les liens étroits qui existent depuis le Moyen Âge entre les hôpitaux, la médecine et la société environnante.
Rouen, PURH, 2007
24 x 17 cm – 456 p. – 35 €
ISBN : 978-2-87775-423-1
Frédérique LACHAUD et Lydwine SCORDIA (dir.)
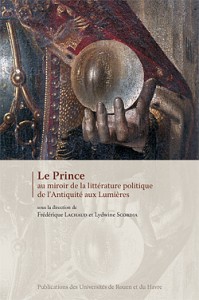 Les traités de bon gouvernement, autrement appelés « miroirs au prince » car ils sont censés renvoyer à leur destinataire l’image idéale du bon prince, s’inscrivent dans une tradition forte. Ils ne constituent pas pour autant un ensemble uniforme : Le Prince au miroir de la littérature politique souligne le renouvellement constant du genre depuis l’Antiquité, voire les césures qui ont pu marquer son évolution jusqu’au Siècle des lumières, tout comme l’inscription de chaque œuvre dans un contexte historique précis. Les dix-huit études réunies réfléchissent également nos interrogations sur les rapports entre pouvoir et écriture. Les traités de bon gouvernement, autrement appelés « miroirs au prince » car ils sont censés renvoyer à leur destinataire l’image idéale du bon prince, s’inscrivent dans une tradition forte. Ils ne constituent pas pour autant un ensemble uniforme : Le Prince au miroir de la littérature politique souligne le renouvellement constant du genre depuis l’Antiquité, voire les césures qui ont pu marquer son évolution jusqu’au Siècle des lumières, tout comme l’inscription de chaque œuvre dans un contexte historique précis. Les dix-huit études réunies réfléchissent également nos interrogations sur les rapports entre pouvoir et écriture.
Ont collaboré à cet ouvrage. Clara Auvray-Assayas, Marie Barral-Baron, Julie Barrau, Jean-Patrice Boudet, Dominique Boutet, Monique Cottret, Sophie Coussemacker, David Fiala, Jean-Philippe Genet, Matthew S. Kempshall, Frédérique Lachaud, Élisabeth Lalou, Gisela Naegle, Corinne Péneau, Lydwine Scordia, Michel Senellart, Rachel Stone, Françoise Thelamon,et Vincent Zarini.
Rouen, PURH, 2007
451 p. – 24 x 16 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87775-432-3
Ancêtres, lignages et communautés idéales (XVIe-XXe siècle)
Pierre RAGON (textes réunis par)
 Individus, lignages ou communautés humaines sont parfois tentés de se forger des ascendances fabuleuses, fausses mais crédibles, imaginaires mais efficaces, qui rehaussent leur dignité. L’histoire des identités nationales en offre de nombreux exemples et, en ce sens, elle a souvent retenu l’attention des historiens. Mais d’autres niveaux de l’appartenance identitaire demeurent moins explorés : en deçà, celui de l’appartenance locale ou ethnique ; au-delà, celui de la place que l’on se donne, à l’époque moderne, au sein d’une chrétienté qui se fragmente ou, un peu plus tard, de tel ou tel empire qui se disloque. Individus, lignages ou communautés humaines sont parfois tentés de se forger des ascendances fabuleuses, fausses mais crédibles, imaginaires mais efficaces, qui rehaussent leur dignité. L’histoire des identités nationales en offre de nombreux exemples et, en ce sens, elle a souvent retenu l’attention des historiens. Mais d’autres niveaux de l’appartenance identitaire demeurent moins explorés : en deçà, celui de l’appartenance locale ou ethnique ; au-delà, celui de la place que l’on se donne, à l’époque moderne, au sein d’une chrétienté qui se fragmente ou, un peu plus tard, de tel ou tel empire qui se disloque.
Dans cette enquête collective, d’où aucune sorte de configuration n’a été exclue, une dizaine de chercheurs modernistes et contemporanéistes se sont tout particulièrement arrêtés au parcours des individus et des groupes rejetés ou en situation de rupture : minorités religieuses, migrants, déracinés, minorités ethniques colonisées. À travers leurs itinéraires, on a saisi leurs identités sur le vif, au moment de leur nécessaire redéfinition, celui où cristallisent de nouvelles communautés.
Ont collaboré à cet ouvrage. Nadine Béligand, Lucia Bergamasco, Simon Bugler, Youssef El Alaoui, Pascale Girard, Yves Krumenacker, Patrick Lesbre, Bruno Maes, Pierre Ragon, Laurent Segalini.
Rouen, PURH, 2007
236 p. – 24 x 16 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87775-427-9
Piroska NAGY (dir.)
en collaboration avec Marie LIONNET et Péter SAHIN TÓTH
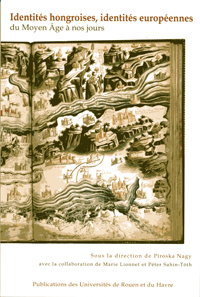 Comment l’historien peut-il cerner les processus de construction de l’identité collective, à un moment précis de l’histoire ? Quels sont les facteurs qui président à cette construction – et quels mécanismes décèle-t-on à travers les sources ? Retrouve-t-on les mêmes processus dans les différentes parties de l’Europe, à différents moments de l’histoire du dernier millénaire ? Ce volume est né de ces interrogations, partagées par des historiens français et hongrois autour des processus de construction des identités collectives dans l’histoire européenne du Moyen Âge à nos jours. Les travaux rassemblés dans ce volume sont le fruit de recherches menées avant tout sur la Hongrie, mais aussi sur l’Empire Habsbourg et l’Empire ottoman, sur l’Allemagne et l’Autriche ainsi que sur la France. Ces recherches ont permis d’appréhender le phénomène de construction identitaire sur divers plans et dans la longue durée. Les réflexions proposées ici permettent de croiser et de confronter ces approches et ces problématiques. Comment l’historien peut-il cerner les processus de construction de l’identité collective, à un moment précis de l’histoire ? Quels sont les facteurs qui président à cette construction – et quels mécanismes décèle-t-on à travers les sources ? Retrouve-t-on les mêmes processus dans les différentes parties de l’Europe, à différents moments de l’histoire du dernier millénaire ? Ce volume est né de ces interrogations, partagées par des historiens français et hongrois autour des processus de construction des identités collectives dans l’histoire européenne du Moyen Âge à nos jours. Les travaux rassemblés dans ce volume sont le fruit de recherches menées avant tout sur la Hongrie, mais aussi sur l’Empire Habsbourg et l’Empire ottoman, sur l’Allemagne et l’Autriche ainsi que sur la France. Ces recherches ont permis d’appréhender le phénomène de construction identitaire sur divers plans et dans la longue durée. Les réflexions proposées ici permettent de croiser et de confronter ces approches et ces problématiques.
Rouen, PURH, 2006
242 p. – 24 x 16 cm – 17 €
ISBN : 978-2-87775-419-4
Sabine FOURRIER et Gilles GRIVAUD (dir.)
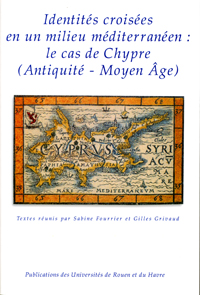 De par sa situation de carrefour naturel des voies maritimes en Méditerranée orientale, Chypre offre un excellent terrain d’observation pour étudier la réception et la diffusion de valeurs étrangères à une culture que l’insularité n’a jamais repliée sur elle-même. Loin de prétendre démêler l’écheveau formé par les relations complexes qu’y entretiennent les cultures autochtones et allochtones, cet ouvrage propose vingt études qui permettent de croiser les axes d’analyse et de comparer les résultats obtenus sur différents objets d’étude. Les réflexions sont le fruit des échanges entre jeunes chercheurs, historiens, archéologues, historiens d’art et d’architecture, linguistes, soucieux de confronter leurs méthodes pour mieux comprendre les divers phénomènes d’acculturation appréhendés sur la longue durée. De par sa situation de carrefour naturel des voies maritimes en Méditerranée orientale, Chypre offre un excellent terrain d’observation pour étudier la réception et la diffusion de valeurs étrangères à une culture que l’insularité n’a jamais repliée sur elle-même. Loin de prétendre démêler l’écheveau formé par les relations complexes qu’y entretiennent les cultures autochtones et allochtones, cet ouvrage propose vingt études qui permettent de croiser les axes d’analyse et de comparer les résultats obtenus sur différents objets d’étude. Les réflexions sont le fruit des échanges entre jeunes chercheurs, historiens, archéologues, historiens d’art et d’architecture, linguistes, soucieux de confronter leurs méthodes pour mieux comprendre les divers phénomènes d’acculturation appréhendés sur la longue durée.
Rouen, PURH, 2006
436 p. – 24 x 16 cm – 20 €
ISBN : 978-2-87775-407-1
Jacques-Olivier BOUDON et Françoise THELAMON (dir.)
 La ville est le lieu de naissance du christianisme ; elle l’a vu ensuite s’épanouir au point de s’identifier à cette religion, dans l’espace qu’il avait conquis. N’a-t-on pas coutume de mesurer les villes au nombre de leurs clochers ? Pourtant cette identification n’a pas été immédiate. Les chrétiens ont d’abord dû se cacher dans la ville avant de pouvoir s’en emparer. À l’inverse, la sécularisation observée depuis le XVIIIe siècle a d’abord concerné les villes (à l’image de Paris), premières touchées par la « déchristianisation », la politique de laïcisation engagée en France à partir de la Révolution visant à faire disparaître précisément toute trace d’identification au christianisme. C’est cette relation complexe des chrétiens à la ville que se proposent d’analyser les études recueillies dans ce volume afin de comprendre comment se construit l’identité du chrétien dans la ville. Pour cela sont examinés l’investissement du territoire urbain par les chrétiens, puis les pratiques cultuelles propres à la ville, enfin la place particulière de la paroisse. Complété par une approche historiographique, ce livre apporte ainsi une contribution de poids au débat sur la place du religieux dans la cité. La ville est le lieu de naissance du christianisme ; elle l’a vu ensuite s’épanouir au point de s’identifier à cette religion, dans l’espace qu’il avait conquis. N’a-t-on pas coutume de mesurer les villes au nombre de leurs clochers ? Pourtant cette identification n’a pas été immédiate. Les chrétiens ont d’abord dû se cacher dans la ville avant de pouvoir s’en emparer. À l’inverse, la sécularisation observée depuis le XVIIIe siècle a d’abord concerné les villes (à l’image de Paris), premières touchées par la « déchristianisation », la politique de laïcisation engagée en France à partir de la Révolution visant à faire disparaître précisément toute trace d’identification au christianisme. C’est cette relation complexe des chrétiens à la ville que se proposent d’analyser les études recueillies dans ce volume afin de comprendre comment se construit l’identité du chrétien dans la ville. Pour cela sont examinés l’investissement du territoire urbain par les chrétiens, puis les pratiques cultuelles propres à la ville, enfin la place particulière de la paroisse. Complété par une approche historiographique, ce livre apporte ainsi une contribution de poids au débat sur la place du religieux dans la cité.
Rouen, PURH, 2006
354 p. – 24 x 16 cm. – 20 €
ISBN : 978-2-87775-366-1
Michel BIARD (dir.)
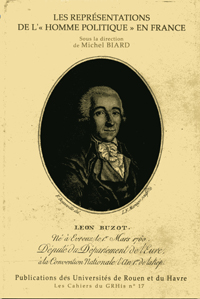 Dans ce numéro des Cahiers du GRHis est évoquée l’émergence, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, d’une notion appelée à un avenir durable : l’« homme politique ». En s’appuyant sur le principe, issu de 1789, de la légitimation du pouvoir par l’acte de voter-élire, des protagonistes de la politique développent désormais de véritables carrières, cependant que d’autres vivent la politique intensément mais sans en faire leur principale occupation. Portraits au noir qui transforment certains en « monstres » à écarter de la Cité, tel Carrier, portraits embellis qui participent de la stratégie de carrière pour des hommes soucieux de s’agréger à une « classe politique » en formation, portraits des anonymes qui s’engagent au quotidien dans la vie politique, portraits des « citoyennes sans citoyenneté », ce sont autant de représentations de l’« homme politique » qui sont ici proposées. Dans ce numéro des Cahiers du GRHis est évoquée l’émergence, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, d’une notion appelée à un avenir durable : l’« homme politique ». En s’appuyant sur le principe, issu de 1789, de la légitimation du pouvoir par l’acte de voter-élire, des protagonistes de la politique développent désormais de véritables carrières, cependant que d’autres vivent la politique intensément mais sans en faire leur principale occupation. Portraits au noir qui transforment certains en « monstres » à écarter de la Cité, tel Carrier, portraits embellis qui participent de la stratégie de carrière pour des hommes soucieux de s’agréger à une « classe politique » en formation, portraits des anonymes qui s’engagent au quotidien dans la vie politique, portraits des « citoyennes sans citoyenneté », ce sont autant de représentations de l’« homme politique » qui sont ici proposées.
Rouen, PURH, Cahiers du GRHIS, N° 17, 2006
96 p. – 24 x 16 cm –14 €
ISBN : 978-2-87775-420-0
Mélanges en l’honneur de Françoise Thelamon
Sylvie CROGIEZ-PÉTREQUIN (textes réunis par)
 Centrés autour des trois thèmes particulièrement représentatifs des recherches de Françoise Thelamon – christianisme, sociabilités, lecture des images – ces mélanges, fruit de la collaboration de quarante-quatre de ses collègues et élèves, portent sur l’ensemble des pratiques plus ou moins ritualisées et des relations entre les individus et leurs dieux au sein des différentes sociétés. Cette lecture des formes des structures sociales se fait autant à travers l’analyse du discours des historiens anciens et modernes, qu’à travers l’étude des représentations iconographiques et qu’au moyen de la mise en évidence de la signification du discours et des images dans les sociétés étudiées : l’interprétation de l’historien est ainsi toujours modifiée par l’éclairage donné au document. La longue période chronologique choisie, de l’Antiquité à nos jours, souligne l’intérêt pour toutes les périodes de l’histoire, de celle qu’on veut ici honorer. Centrés autour des trois thèmes particulièrement représentatifs des recherches de Françoise Thelamon – christianisme, sociabilités, lecture des images – ces mélanges, fruit de la collaboration de quarante-quatre de ses collègues et élèves, portent sur l’ensemble des pratiques plus ou moins ritualisées et des relations entre les individus et leurs dieux au sein des différentes sociétés. Cette lecture des formes des structures sociales se fait autant à travers l’analyse du discours des historiens anciens et modernes, qu’à travers l’étude des représentations iconographiques et qu’au moyen de la mise en évidence de la signification du discours et des images dans les sociétés étudiées : l’interprétation de l’historien est ainsi toujours modifiée par l’éclairage donné au document. La longue période chronologique choisie, de l’Antiquité à nos jours, souligne l’intérêt pour toutes les périodes de l’histoire, de celle qu’on veut ici honorer.
Rouen, PURH, 2005
686 p. – 24 x 16 cm – 30 €
ISBN 2-87775-393-X
|
Publications des doctorants |
 Mise à l’écart brutale des opposants, répression sauvage des révoltes, atrocités sans nom des crimes contre les civils, brutalités des armées, le déchaînement de la violence par les États est une triste constante de l’histoire. Face cette violence, les hommes de plume sont souvent parmi les premiers à prendre parti, notamment lorsque leurs écrits antérieurs les ont plutôt amenés vers des positions de tolérance, voire d’humanisme. N’en restent pas moins les faits et l’explication de ceux-ci présentée par les gouvernants. Au nom de la défense de la religion, au nom du salut public, au nom de la défense nationale, au nom de toutes les explications à leur disposition, ils s’empressent de justifier la violence par eux déchaînée et espèrent trouver des relais à leurs justifications chez les hommes de plume. Certains finissent par adhérer à cette thèse des « circonstances » qui explique tout et rend la violence d’État sinon juste, à tout le moins tolérable. D’autres, au contraire, participent de ce que Peter Weiss nommait « l’esthétique de la résistance », et utilisent leur plume pour dire ce qui paraît indicible, pour témoigner au nom de l’humanité brisée.
Mise à l’écart brutale des opposants, répression sauvage des révoltes, atrocités sans nom des crimes contre les civils, brutalités des armées, le déchaînement de la violence par les États est une triste constante de l’histoire. Face cette violence, les hommes de plume sont souvent parmi les premiers à prendre parti, notamment lorsque leurs écrits antérieurs les ont plutôt amenés vers des positions de tolérance, voire d’humanisme. N’en restent pas moins les faits et l’explication de ceux-ci présentée par les gouvernants. Au nom de la défense de la religion, au nom du salut public, au nom de la défense nationale, au nom de toutes les explications à leur disposition, ils s’empressent de justifier la violence par eux déchaînée et espèrent trouver des relais à leurs justifications chez les hommes de plume. Certains finissent par adhérer à cette thèse des « circonstances » qui explique tout et rend la violence d’État sinon juste, à tout le moins tolérable. D’autres, au contraire, participent de ce que Peter Weiss nommait « l’esthétique de la résistance », et utilisent leur plume pour dire ce qui paraît indicible, pour témoigner au nom de l’humanité brisée.

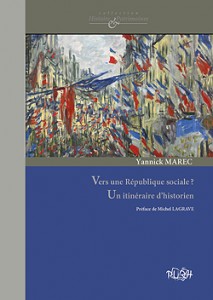 Aboutissement de plusieurs décennies de recherche, l’ouvrage envisage divers cheminements de la « République sociale ». Son sous-titre « Culture politique, patrimoine et protection sociale aux 19e et 20e siècles » donne l’orientation générale des études qui sont à l’origine de ce livre abondamment illustré.
Aboutissement de plusieurs décennies de recherche, l’ouvrage envisage divers cheminements de la « République sociale ». Son sous-titre « Culture politique, patrimoine et protection sociale aux 19e et 20e siècles » donne l’orientation générale des études qui sont à l’origine de ce livre abondamment illustré. Durant des siècles, les hôpitaux ont été principalement des centres d’accueil et d’hébergement pour pèlerins et malades indigents. Cependant, progressivement, ils se sont affirmés comme des centres de soins, devenant même des points d’ancrage essentiels des nouvelles avancées thérapeutiques. L’histoire pluriséculaire des hôpitaux contribue également à leur donner une dimension patrimoniale qui les met au cœur des démarches identitaires propres à notre époque. En même temps, l’hospitalo-centrisme en matière de soins peut donner lieu à de fortes critiques qui ont suscité, depuis longtemps, l’apparition d’alternatives ou de complémentarités à l’hospitalisation.
Durant des siècles, les hôpitaux ont été principalement des centres d’accueil et d’hébergement pour pèlerins et malades indigents. Cependant, progressivement, ils se sont affirmés comme des centres de soins, devenant même des points d’ancrage essentiels des nouvelles avancées thérapeutiques. L’histoire pluriséculaire des hôpitaux contribue également à leur donner une dimension patrimoniale qui les met au cœur des démarches identitaires propres à notre époque. En même temps, l’hospitalo-centrisme en matière de soins peut donner lieu à de fortes critiques qui ont suscité, depuis longtemps, l’apparition d’alternatives ou de complémentarités à l’hospitalisation.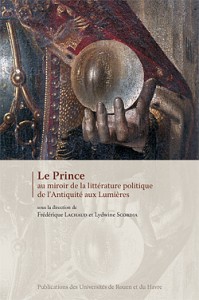 Les traités de bon gouvernement, autrement appelés « miroirs au prince » car ils sont censés renvoyer à leur destinataire l’image idéale du bon prince, s’inscrivent dans une tradition forte. Ils ne constituent pas pour autant un ensemble uniforme : Le Prince au miroir de la littérature politique souligne le renouvellement constant du genre depuis l’Antiquité, voire les césures qui ont pu marquer son évolution jusqu’au Siècle des lumières, tout comme l’inscription de chaque œuvre dans un contexte historique précis. Les dix-huit études réunies réfléchissent également nos interrogations sur les rapports entre pouvoir et écriture.
Les traités de bon gouvernement, autrement appelés « miroirs au prince » car ils sont censés renvoyer à leur destinataire l’image idéale du bon prince, s’inscrivent dans une tradition forte. Ils ne constituent pas pour autant un ensemble uniforme : Le Prince au miroir de la littérature politique souligne le renouvellement constant du genre depuis l’Antiquité, voire les césures qui ont pu marquer son évolution jusqu’au Siècle des lumières, tout comme l’inscription de chaque œuvre dans un contexte historique précis. Les dix-huit études réunies réfléchissent également nos interrogations sur les rapports entre pouvoir et écriture. Individus, lignages ou communautés humaines sont parfois tentés de se forger des ascendances fabuleuses, fausses mais crédibles, imaginaires mais efficaces, qui rehaussent leur dignité. L’histoire des identités nationales en offre de nombreux exemples et, en ce sens, elle a souvent retenu l’attention des historiens. Mais d’autres niveaux de l’appartenance identitaire demeurent moins explorés : en deçà, celui de l’appartenance locale ou ethnique ; au-delà, celui de la place que l’on se donne, à l’époque moderne, au sein d’une chrétienté qui se fragmente ou, un peu plus tard, de tel ou tel empire qui se disloque.
Individus, lignages ou communautés humaines sont parfois tentés de se forger des ascendances fabuleuses, fausses mais crédibles, imaginaires mais efficaces, qui rehaussent leur dignité. L’histoire des identités nationales en offre de nombreux exemples et, en ce sens, elle a souvent retenu l’attention des historiens. Mais d’autres niveaux de l’appartenance identitaire demeurent moins explorés : en deçà, celui de l’appartenance locale ou ethnique ; au-delà, celui de la place que l’on se donne, à l’époque moderne, au sein d’une chrétienté qui se fragmente ou, un peu plus tard, de tel ou tel empire qui se disloque.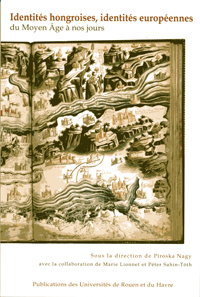 Comment l’historien peut-il cerner les processus de construction de l’identité collective, à un moment précis de l’histoire ? Quels sont les facteurs qui président à cette construction – et quels mécanismes décèle-t-on à travers les sources ? Retrouve-t-on les mêmes processus dans les différentes parties de l’Europe, à différents moments de l’histoire du dernier millénaire ? Ce volume est né de ces interrogations, partagées par des historiens français et hongrois autour des processus de construction des identités collectives dans l’histoire européenne du Moyen Âge à nos jours. Les travaux rassemblés dans ce volume sont le fruit de recherches menées avant tout sur la Hongrie, mais aussi sur l’Empire Habsbourg et l’Empire ottoman, sur l’Allemagne et l’Autriche ainsi que sur la France. Ces recherches ont permis d’appréhender le phénomène de construction identitaire sur divers plans et dans la longue durée. Les réflexions proposées ici permettent de croiser et de confronter ces approches et ces problématiques.
Comment l’historien peut-il cerner les processus de construction de l’identité collective, à un moment précis de l’histoire ? Quels sont les facteurs qui président à cette construction – et quels mécanismes décèle-t-on à travers les sources ? Retrouve-t-on les mêmes processus dans les différentes parties de l’Europe, à différents moments de l’histoire du dernier millénaire ? Ce volume est né de ces interrogations, partagées par des historiens français et hongrois autour des processus de construction des identités collectives dans l’histoire européenne du Moyen Âge à nos jours. Les travaux rassemblés dans ce volume sont le fruit de recherches menées avant tout sur la Hongrie, mais aussi sur l’Empire Habsbourg et l’Empire ottoman, sur l’Allemagne et l’Autriche ainsi que sur la France. Ces recherches ont permis d’appréhender le phénomène de construction identitaire sur divers plans et dans la longue durée. Les réflexions proposées ici permettent de croiser et de confronter ces approches et ces problématiques.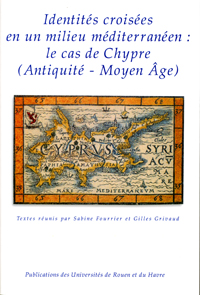 De par sa situation de carrefour naturel des voies maritimes en Méditerranée orientale, Chypre offre un excellent terrain d’observation pour étudier la réception et la diffusion de valeurs étrangères à une culture que l’insularité n’a jamais repliée sur elle-même. Loin de prétendre démêler l’écheveau formé par les relations complexes qu’y entretiennent les cultures autochtones et allochtones, cet ouvrage propose vingt études qui permettent de croiser les axes d’analyse et de comparer les résultats obtenus sur différents objets d’étude. Les réflexions sont le fruit des échanges entre jeunes chercheurs, historiens, archéologues, historiens d’art et d’architecture, linguistes, soucieux de confronter leurs méthodes pour mieux comprendre les divers phénomènes d’acculturation appréhendés sur la longue durée.
De par sa situation de carrefour naturel des voies maritimes en Méditerranée orientale, Chypre offre un excellent terrain d’observation pour étudier la réception et la diffusion de valeurs étrangères à une culture que l’insularité n’a jamais repliée sur elle-même. Loin de prétendre démêler l’écheveau formé par les relations complexes qu’y entretiennent les cultures autochtones et allochtones, cet ouvrage propose vingt études qui permettent de croiser les axes d’analyse et de comparer les résultats obtenus sur différents objets d’étude. Les réflexions sont le fruit des échanges entre jeunes chercheurs, historiens, archéologues, historiens d’art et d’architecture, linguistes, soucieux de confronter leurs méthodes pour mieux comprendre les divers phénomènes d’acculturation appréhendés sur la longue durée. La ville est le lieu de naissance du christianisme ; elle l’a vu ensuite s’épanouir au point de s’identifier à cette religion, dans l’espace qu’il avait conquis. N’a-t-on pas coutume de mesurer les villes au nombre de leurs clochers ? Pourtant cette identification n’a pas été immédiate. Les chrétiens ont d’abord dû se cacher dans la ville avant de pouvoir s’en emparer. À l’inverse, la sécularisation observée depuis le XVIIIe siècle a d’abord concerné les villes (à l’image de Paris), premières touchées par la « déchristianisation », la politique de laïcisation engagée en France à partir de la Révolution visant à faire disparaître précisément toute trace d’identification au christianisme. C’est cette relation complexe des chrétiens à la ville que se proposent d’analyser les études recueillies dans ce volume afin de comprendre comment se construit l’identité du chrétien dans la ville. Pour cela sont examinés l’investissement du territoire urbain par les chrétiens, puis les pratiques cultuelles propres à la ville, enfin la place particulière de la paroisse. Complété par une approche historiographique, ce livre apporte ainsi une contribution de poids au débat sur la place du religieux dans la cité.
La ville est le lieu de naissance du christianisme ; elle l’a vu ensuite s’épanouir au point de s’identifier à cette religion, dans l’espace qu’il avait conquis. N’a-t-on pas coutume de mesurer les villes au nombre de leurs clochers ? Pourtant cette identification n’a pas été immédiate. Les chrétiens ont d’abord dû se cacher dans la ville avant de pouvoir s’en emparer. À l’inverse, la sécularisation observée depuis le XVIIIe siècle a d’abord concerné les villes (à l’image de Paris), premières touchées par la « déchristianisation », la politique de laïcisation engagée en France à partir de la Révolution visant à faire disparaître précisément toute trace d’identification au christianisme. C’est cette relation complexe des chrétiens à la ville que se proposent d’analyser les études recueillies dans ce volume afin de comprendre comment se construit l’identité du chrétien dans la ville. Pour cela sont examinés l’investissement du territoire urbain par les chrétiens, puis les pratiques cultuelles propres à la ville, enfin la place particulière de la paroisse. Complété par une approche historiographique, ce livre apporte ainsi une contribution de poids au débat sur la place du religieux dans la cité.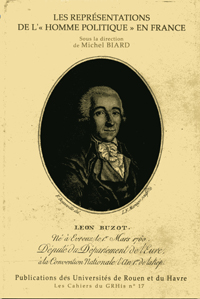 Dans ce numéro des Cahiers du GRHis est évoquée l’émergence, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, d’une notion appelée à un avenir durable : l’« homme politique ». En s’appuyant sur le principe, issu de 1789, de la légitimation du pouvoir par l’acte de voter-élire, des protagonistes de la politique développent désormais de véritables carrières, cependant que d’autres vivent la politique intensément mais sans en faire leur principale occupation. Portraits au noir qui transforment certains en « monstres » à écarter de la Cité, tel Carrier, portraits embellis qui participent de la stratégie de carrière pour des hommes soucieux de s’agréger à une « classe politique » en formation, portraits des anonymes qui s’engagent au quotidien dans la vie politique, portraits des « citoyennes sans citoyenneté », ce sont autant de représentations de l’« homme politique » qui sont ici proposées.
Dans ce numéro des Cahiers du GRHis est évoquée l’émergence, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, d’une notion appelée à un avenir durable : l’« homme politique ». En s’appuyant sur le principe, issu de 1789, de la légitimation du pouvoir par l’acte de voter-élire, des protagonistes de la politique développent désormais de véritables carrières, cependant que d’autres vivent la politique intensément mais sans en faire leur principale occupation. Portraits au noir qui transforment certains en « monstres » à écarter de la Cité, tel Carrier, portraits embellis qui participent de la stratégie de carrière pour des hommes soucieux de s’agréger à une « classe politique » en formation, portraits des anonymes qui s’engagent au quotidien dans la vie politique, portraits des « citoyennes sans citoyenneté », ce sont autant de représentations de l’« homme politique » qui sont ici proposées. Centrés autour des trois thèmes particulièrement représentatifs des recherches de Françoise Thelamon – christianisme, sociabilités, lecture des images – ces mélanges, fruit de la collaboration de quarante-quatre de ses collègues et élèves, portent sur l’ensemble des pratiques plus ou moins ritualisées et des relations entre les individus et leurs dieux au sein des différentes sociétés. Cette lecture des formes des structures sociales se fait autant à travers l’analyse du discours des historiens anciens et modernes, qu’à travers l’étude des représentations iconographiques et qu’au moyen de la mise en évidence de la signification du discours et des images dans les sociétés étudiées : l’interprétation de l’historien est ainsi toujours modifiée par l’éclairage donné au document. La longue période chronologique choisie, de l’Antiquité à nos jours, souligne l’intérêt pour toutes les périodes de l’histoire, de celle qu’on veut ici honorer.
Centrés autour des trois thèmes particulièrement représentatifs des recherches de Françoise Thelamon – christianisme, sociabilités, lecture des images – ces mélanges, fruit de la collaboration de quarante-quatre de ses collègues et élèves, portent sur l’ensemble des pratiques plus ou moins ritualisées et des relations entre les individus et leurs dieux au sein des différentes sociétés. Cette lecture des formes des structures sociales se fait autant à travers l’analyse du discours des historiens anciens et modernes, qu’à travers l’étude des représentations iconographiques et qu’au moyen de la mise en évidence de la signification du discours et des images dans les sociétés étudiées : l’interprétation de l’historien est ainsi toujours modifiée par l’éclairage donné au document. La longue période chronologique choisie, de l’Antiquité à nos jours, souligne l’intérêt pour toutes les périodes de l’histoire, de celle qu’on veut ici honorer.