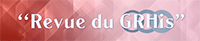|
|
 Projet Interreg 2010-2013 Projet Interreg 2010-2013
Coordinateur pour le GRHIS
Élisabeth Lalou et Alexis Grélois
Partenaires
France (Haute-Normandie)
LITIS : Laurent Heutte, Stéphane Nicolas, Pierrick Tranouez et Alexander Burnett
GRHIS : Élisabeth Lalou, Alexis Grélois et étudiants stagiaires
Bibliothèque municipale de Rouen : Vincent Viallefond, Maïté Vanmarque, en 2010 Christelle Quillet
Angleterre (Kent)
CCA – Archives de la cathédrale de Canterbury : Cressida Williams
CMEMS – Laboratoire d’histoire de l’université de Kent : Catherine Richardson, Alix Bovey
EDA – Laboratoire d’informatique de l’université de Kent : Mikael Fairhurst, Richard Guest Steve Kelly et Yiqing Yiang
Objet
Fabrication d’un feuilleteur et outil d’annotations pour les manuscrits. Travail aussi de recherche automatique de caractères (word spotting) et de formes (pattern spotting). Le GRHIS intervient pour ses compétences sur le manuscrit médiéval, la paléographie et l’enluminure.
Principales dates et réalisations
Avril 2011, 30 mars- 1er avril 2012, avril 2013 : démonstration de l’outil au Salon du livre ancien (Abbatiale Saint-Ouen à Rouen)
25-26 octobre 2012 à Rouen : Atelier Workshop Doc Explore
Septembre 2013 : exposition à la Bibliothèque municipale de Rouen et aux Archives de Canterbury
Sites
Consultez le site Doc Explore
Transmissions et usages politiques de l’histoire en Allemagne et Autriche, 1889-1934
Jean-Numa DUCANGE
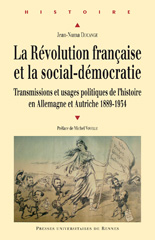 Les héritiers politiques de Marx des social-démocraties allemande et autrichienne entendent fixer leur lecture de la Révolution française en publiant à partir de 1889 ouvrages, articles et brochures. Ces écrits vont servir de fondement à une tradition d’interprétation de la « Grande Révolution » , enseignée et transmise au travers d’un impressionnant dispositif de formation et de diffusion. Étudiée ici grâce à l’exploitation de fonds d’archives peu connus, cette tradition qui tend à fixer une vulgate auprès d’un large milieu militant se heurte aux évolutions des social-démocraties et surgissement des révolutions en 1905 et 1917. Les héritiers politiques de Marx des social-démocraties allemande et autrichienne entendent fixer leur lecture de la Révolution française en publiant à partir de 1889 ouvrages, articles et brochures. Ces écrits vont servir de fondement à une tradition d’interprétation de la « Grande Révolution » , enseignée et transmise au travers d’un impressionnant dispositif de formation et de diffusion. Étudiée ici grâce à l’exploitation de fonds d’archives peu connus, cette tradition qui tend à fixer une vulgate auprès d’un large milieu militant se heurte aux évolutions des social-démocraties et surgissement des révolutions en 1905 et 1917.
Rennes, PUR (collection Histoire), 2012
24 x 15,5 cm. – 362 p. – 22 €
ISBN : 978-2-7535-1736-3
Une histoire comparée, XVIe-XIXe siècle
Guy LEMARCHAND
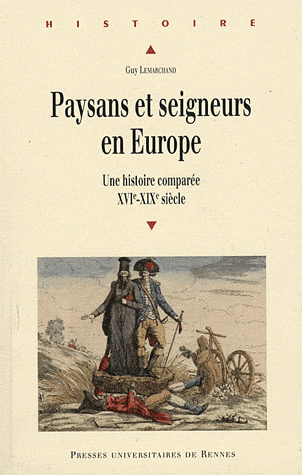 Centré sur les structures féodales rurales, ce livre vise à montrer à travers une comparaison internationale à l’échelle du Vieux Continent les ressemblances et les différences des formes de la seigneurie. Il fait intervenir dans le jeu paysans-seigneurs trois autres acteurs, l’un direct la noblesse, les deux autres externes : l’État et la ville. Du même coup, si l’ouvrage de Guy Lemarchand se veut essentiellement un livre d’histoire sociale, il ne peut se couper de l’énoncé de certaines grandes données économiques et démographiques dont le poids effectif doit être discuté. Centré sur les structures féodales rurales, ce livre vise à montrer à travers une comparaison internationale à l’échelle du Vieux Continent les ressemblances et les différences des formes de la seigneurie. Il fait intervenir dans le jeu paysans-seigneurs trois autres acteurs, l’un direct la noblesse, les deux autres externes : l’État et la ville. Du même coup, si l’ouvrage de Guy Lemarchand se veut essentiellement un livre d’histoire sociale, il ne peut se couper de l’énoncé de certaines grandes données économiques et démographiques dont le poids effectif doit être discuté.
Rennes, PUR (collection Histoire), 2011
24 x 15,5 cm. – 374 p. – 22 €
ISBN : 978-2-7535-1701-1
Anna BELLAVITIS et Nicole EDELMAN (dir.)
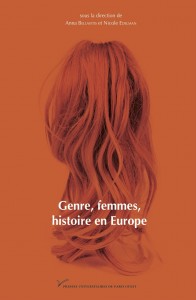
L’histoire des femmes née dans les années 1970, puis le genre, conçu comme un concept et un outil d’analyse quelques années plus tard, ont permis de renouveler l’écriture de l’histoire en reconnaissant le caractère sexué de l’organisation des sociétés humaines et en dévoilant l’inégalité entre les sexes comme produit des relations de pouvoir entre hommes et femmes. Ce livre met au jour la fécondité de cette approche. La diversité géographique – Espagne, Autriche, France et Italie –, chronologique – du XVIe au XXe siècles – ainsi que l’amplitude des questionnements à la fois culturels, religieux, sociaux et politiques nous font comprendre comment les hiérarchies entre les sexes, les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, les stratégies des uns et des autres s’élaborent et se transforment selon les enjeux du temps et des lieux. Ce livre nous donne ainsi à lire une autre Histoire.
Sont rassemblées ici les communications des enseignant(e-s) et des doctorant(e-s) présentées à l’université européenne d’été du Doctorat international en histoire des femmes et des identités de genre. Un projet européen auquel participent, aux côtés de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, l’université de Naples-L’Orientale, l’université autonome de Madrid, l’université de Vienne, l’université de Rouen et l’université de Dundee.
Table des matières
Introduction par Anna Bellavitis et Nicole Edelman
Présentation de l’histoire des femmes et du genre en Europe par Françoise Thébaud
I – Modalités de la construction du genre
Renata Ago, Le genre de la consommation, l’âge moderne
Pilar Pérez Canto, La société patriarcale dans le discours des Lumières
Annie Duprat, Marie-Antoinette, une icône française ?
Carmen de la Guardia Herrero, Pseudonymes, silences et identité d´écrivain. Histoire des femmes à travers leurs textes
II – Corps et sexualité
Domenico Rizzo, Corps, genre et sexualité. Traces matrimoniales à l’époque moderne
Miryam Deniel-Ternant, Les prostituées parisiennes et leur clientèle ecclésiastique
François Zanetti, Quand l’électricité soignait les maladies des femmes : corps et médecine au XVIIIe siècle
Marine Branland, Les représentations du corps féminin dans les gravures de la Grande Guerre en France – quelques estampes allemandes en contrepoint
III – Familles
Anna Bellavitis, Héritage et tutelle à l’époque moderne. Le cas de Venise
Margareth Lanzinger, Parenté et genre : des mariages par alliance
Pilar Toboso Sánchez, Le discours de l´Église sous la dictature de Franco: éduquer pour mieux discriminer
IV – Espace et migration
Edoardo Lilli, Les parcours urbains des blanchisseuses à Rome au XVIIIe siècle. Usage et perception de l’espace
Rocco Potenza, L’émigration clandestine italienne en France dans le deuxième après-guerre. Les expériences du passage de la frontière d’après le récit des émigrés
Andreina De Clementi, L’émigration féminine jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale
V – Femmes et politique
Dominique Godineau, Le genre de la citoyenneté, ou quelle identité politique pour les femmes pendant la révolution française ?
Monique Cottret, Mme de Staël et Marie-Antoinette : deux femmes en politique
Annette Becker, La spécificité du sort des femmes lors de l’occupation allemande du Nord de la France, 1914-1918
Gabriella Gribaudi, Le genre de la guerre. Mémoire et historiographie de la Seconde Guerre mondiale en Italie
Alessandra Gissi, « Un mythe incertain et inoxydable » : le 8 mars en Italie (1910-1958)
Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest, collection Genre et société, 2012
27 €
Bibliographie raisonnée (1800-2000)
Gilles GRIVAUD et Alexandre POPOVIC (dir.)
 La conversion à l’islam d’une partie des populations de l’Asie Mineure et des Balkans a marqué une rupture majeure dans l’histoire de la Méditerranée orientale. Au cours des XIXe et XXe siècles, ce phénomène a suscité des réactions d’autant plus contrastées qu’elles s’inséraient dans une culture politique marquée par l’affirmation d’États-nations fondant leurs racines dans les civilisations chrétiennes médiévales. Afin de permettre l’analyse des constructions identitaires et d’apprécier les vicissitudes des discours suscités par l’existence d’un islam enraciné dans des sociétés autrefois chrétiennes ou juives, quinze historiens ont collaboré pour établir une bibliographie raisonnée ; elle rend accessible plus de huit cent études composées, entre 1800 et 2000, par des auteurs originaires des Balkans et d’autres écoles historiques occidentales. La conversion à l’islam d’une partie des populations de l’Asie Mineure et des Balkans a marqué une rupture majeure dans l’histoire de la Méditerranée orientale. Au cours des XIXe et XXe siècles, ce phénomène a suscité des réactions d’autant plus contrastées qu’elles s’inséraient dans une culture politique marquée par l’affirmation d’États-nations fondant leurs racines dans les civilisations chrétiennes médiévales. Afin de permettre l’analyse des constructions identitaires et d’apprécier les vicissitudes des discours suscités par l’existence d’un islam enraciné dans des sociétés autrefois chrétiennes ou juives, quinze historiens ont collaboré pour établir une bibliographie raisonnée ; elle rend accessible plus de huit cent études composées, entre 1800 et 2000, par des auteurs originaires des Balkans et d’autres écoles historiques occidentales.
Table des matières
Introduction [Gilles Grivaud, Alexandre Popovic]
Inventaire
A. Empire ottoman
Introduction [Gilles Grivaud, Alexandre Popovic]
Notices A 1 – A 117 [Méropi Anastassiadou, Nathalie Clayer, Philippe Gelez, Rossitsa Gradeva, Gilles Grivaud, Slobodan Ilić, Bernard Lory, Georgios Nikolaou, Alexandre Popovic, İşik Tamdoğan]
B. Grèce et populations grécophones d’Asie Mineure
Introduction [Gilles Grivaud]
Notices B 1 – B 153 [Méropi Anastassiadou, Stavros Anestidis, Gilles Grivaud, Georgios Nikolaou, Manolis Péponakis]
C. Populations arménophones d’Asie Mineure
Introduction [Claire Mouradian]
Notices C 1 – C 5 [Claire Mouradian]
D. Bulgarie
Introduction [Rossitsa Gradeva]
Notices D 1 – D 86 [Rossitsa Gradeva, Gilles Grivaud, Bernard Lory]
E. Macédoine ex-yougoslave/FYROM
Introduction [Bernard Lory]
Notices E 1 – E 43 [Nathalie Clayer, Philippe Gelez, Rossitsa Gradeva, Gilles Grivaud, Bernard Lory, Alexandre Popovic, Dejan Stojiljković]
F. Serbie, Monténégro, Croatie
Introduction [Philippe Gelez]
Notices F 1 – F 33 [Philippe Gelez, Bernard Lory, Alexandre Popovic, Dejan Stojiljković]
G. Bosnie-Herzégovine
Introduction [Philippe Gelez]
Notices G 1 – G 202 [Philippe Gelez, Gilles Grivaud, Slobodan Ilić, Alexandre Popovic, Dejan Stojlijković]
H. Albanie et populations albanophones d’ex-Yougoslavie
Introduction [Nathalie Clayer]
Notices H 1 – H 84 [Nathalie Clayer, Gilles Grivaud, Alexandre Popovic]
I. Hongrie
Introduction [Gilles Grivaud, Alexandre Popovic]
Notices I 1 – I 3 [Philippe Gelez, Rossitsa Gradeva, Catherine Horel]
J. Populations juives et dönme-s
Introduction [Jacob M. Landau]
Notices J 1 – J 95 [Philippe Gelez, Gilles Grivaud, Slobodan Ilić, Jacob M. Landau, Alexandre Popovic]
Annexes
Glossaire
Repères chronologiques
Cartes
Liste des périodiques cités
Index des auteurs
Athènes, École française d’Athènes (Mondes Méditerranéens et Balkaniques 3), 2011
914 p.
Françoise THELAMON (dir.)
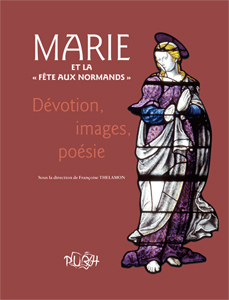 La Conception de Marie célébrée en Normandie depuis le Moyen Âge, la « Fête aux Normands », donna lieu aux XVe et XVIe siècles à un concours de poésie, le Puy de Palinods, et à une riche iconographie exaltant la beauté de Marie, signe de son Immaculée Conception. Les auteurs, historiens et spécialistes de la littérature et des arts, analysent textes et images témoins de ces pratiques sociales et religieuses. La Conception de Marie célébrée en Normandie depuis le Moyen Âge, la « Fête aux Normands », donna lieu aux XVe et XVIe siècles à un concours de poésie, le Puy de Palinods, et à une riche iconographie exaltant la beauté de Marie, signe de son Immaculée Conception. Les auteurs, historiens et spécialistes de la littérature et des arts, analysent textes et images témoins de ces pratiques sociales et religieuses.
> Présentation vidéo de l’ouvrage
Table des matières
Françoise Thelamon, Avant-propos
Ouverture
« Belle sans sy en sa conception »
Tota pulchra es
Françoise Thelamon, La beauté de Marie manifestation de son immaculée conception
Marielle Lamy, Le culte marial entre dévotion et doctrine : de la « Fête aux Normands » à l’Immaculée Conception
Aux sources de la dévotion et de la croyance
Vassa Kontouma-Conticello, La question de l’Immaculée Conception dans la tradition orientale et les célébrations byzantines de l’enfance de Marie aux VIIe-VIIIe siècles
Veronica Ortenbergwest-Harling, L’origine anglaise de la fête de la Conception de la Vierge
Dévotion, fête et poésie
Marie-Bénédicte Dary, Aux origines de la « Fête aux Normands » : La liturgie de la fête de la Conception de la Vierge Marie en France (XIIe-XIIIe siècles)
Françoise Le Saux, La Conception Nostre Dame de Wace : œuvre de propagande ?
Denis Hüe, La « Fête aux normands » et le Puy de Palinods de Rouen : la fête dans la ville
Gérard Gros, D’un Puy marial à l’autre : Amiens et Rouen. Variations sur l’allégorie du miroir
Images médiévales et modernes
Nicolas Trotin, La Trinité de sainte Anne, un avatar du dogme immaculiste à propos d’une planche gravée par Simon Vostre (1508)
Françoise Baron, L’Iconographie de l’Immaculée Conception dans la sculpture médiévale et moderne en Normandie
Laurence Riviale, L’Immaculée Conception dans les vitraux normands
Séverine Lepape, L’Arbre de Jessé normand et la question de l’Immaculée Conception
Controverses et débats
Christine Boyer, Un sermon sur la conception de Marie par Guillaume de Sauqueville
Marielle Lamy, Universitaires et religieux normands dans la controverse de la fin du XIVe siècle : les prolongements de l’affaire Monzon
Marc Vénard, Aux XVIe et XVIIe siècles : blocage doctrinal et floraison dévote
Nicolas Trotin, Les représentants normands de l’École française de spiritualité et l’Immaculée Conception : Jean Eudes, Louis-François d’Argentan et Henri-Marie Boudon
Dogme, dévotion, festivités à l’époque contemporaine
Nadine-Josette Chaline, 1854 : Proclamation du dogme de l’Immaculée Conception
Nadine-Josette Chaline, Images de Marie en Haute-Normandie au XIXe siècle
Jean-Dominique Durand, Marie à Lyon. De la Fête de la Lumière aux Fêtes des Lumières le 8 décembre
Conclusion
Regards croisés par Catherine Vincent et Jean-Pierre Chaline
Rouen, PURH, n° 23, 2011
25,5 x 19,5 cm – 354 p. – 37 €
ISBN : 978-2-87775-529-0
Autour de la transmission des biens, des savoirs et des pouvoirs (Europe, Nouveau Monde, XIIe-XIXe siècles)
Études réunies par Anna BELLAVITIS et Isabelle CHABOT
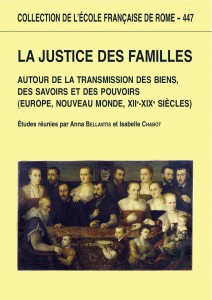
Comment les familles organisent-elles leur reproduction sociale ? Comment gèrent-elles les conflits qui peuvent surgir au sujet de la transmission des biens ? Comment les savoirs, les compétences, les métiers se transmettent-ils à l’intérieur des familles ? Quel rôle jouent les femmes dans la transmission des pouvoirs politiques ? Voici quelques unes des questions posées par ce volume qui réunit les résultats de trois ateliers du projet de recherche Familles, savoirs, reproduction sociale (époque médiévale et moderne) de l’École française de Rome, dirigé par Anna Bellavitis, Isabelle Chabot et Igor Mineo, avec le soutien de l’Université de Palerme et du Centre d’Histoire sociale et culturelle de l’Occident (XIIe-XVIIIe siècle) de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. L’ouvrage s’articule autour de deux aspects complémentaires de la reproduction sociale – l’héritage matériel (les patrimoines) et l’héritage immatériel (les savoirs et les pouvoirs). Les articles, qui couvrent une époque allant du Haut Moyen Âge au XIXe siècle, concernent une vaste aire géographique, qui comprend, en plus de la France et de l’Italie, les espaces scandinaves, germaniques et ibériques, avec deux incursions dans les colonies américaines.
Cet ouvrage est le fruit d’une réflexion collective menée dans le cadre du projet de recherche Familles, savoirs, reproduction sociale (époque médiévale et moderne), conçu et coordonné par Anna Bellavitis, Isabelle Chabot et Igor Mineo et inscrit dans le plan quadriennal 2004-2007 de l’École française de Rome, dans l’axe de recherche «Droit, pouvoirs, sociétés ». Entre 2006 et 2007, trois rencontres ont réuni à Rome, Palerme et Paris une trentaine d’histo- riens du Moyen Âge et de l’époque moderne autour de la thématique de la transmission.
> Introduction
Table des matières
Première partie – HÉRITAGES MATÉRIELS
Autour du mariage
Maria ÅGREN, For better for worse. Swedish marriage and property law in a comparative perspective
Linda GUZZETTI et Roberta FUNGHER, La dot à Venise et à Trévise au XIVe siècle
Robert DESCIMON, Patriarcat et discordes familiales : les conflits liés aux enjeux de l’alliance et de la transmission dans la robe parisienne aux XVIe et XVIIe siècles
Tiziana PLEBANI, Matrimoni segreti a Venezia tra XVII e XVIII secolo : il pericoloso ‘suismo’
Zélie NAVARRO-ANDRAUD, Le conflit en héritage ou l’argent source de tous les maux (Saint-Domingue, XVIIIe siècle)
Autour de la succession
Claire CHATELAIN, Les tensions successorales dans une famille de la robe parisienne au tournant des XVIe et XVIIe siècles
Delphine CANO, Transmission héréditaire et batailles juridiques autour du cacicazgo en Nouvelle-Espagne, XVIe-XVIIIe siècles
François-Joseph RUGGIU, Pour préserver la paix des familles… Les querelles successorales et leurs règlements au XVIIIe siècle
Olivier ZELLER, Le rôle normalisateur de la fratrie dans les conflits familiaux de la France du XVIIIe siècle
Tribunaux
Karin GOTTSCHALK, Guardianship and inheritance : city authorities, family disputes and the distribution of goods in 17th-century Leipzig
Christine DOUSSET, Au risque du veuvage : veuves et conflits familiaux dans les mémoires judiciaires du parlement de Toulouse à la fin du XVIIIe siècle
Sylvie PERRIER, Les familles toulousaines devant la justice civile du sénéchal au XVIIIe siècle
Angela GROPPI, Le Tribunal du Vicariat et les obligations alimentaires intrafamiliales dans la Rome des Papes (XVIIIe-XIXe siècles)
Francisco García GONZÁLEZ y Cosme Jesùs GÓMEZ CARRASCO, Tensión familiar y conflictividad social en la España meridional : el ejemplo de Albacete, 1700-1830
Deuxième partie – HÉRITAGES IMMATÉRIELS
Savoirs et métiers
Anna ESPOSITO, Tra saperi intellettuali e conoscenze tecniche : il caso di Roma nel tardo Medioevo
Marie BOUHAÏK-GIRONÈS, Pierre Gringore, fils de juriste et homme de théâtre : famille et transmission des savoir-faire dans les ‘métiers de la parole’ (France du Nord, XVe-XVIe siècle)
Caroline GIRON-PANEL, Entre art et technique : l’apprentis- sage de la musique dans les familles et en dehors des familles à Venise (XVIe-XVIIIe siècles)
Luciano PEZZOLO, Professione militare e famiglia in Italia tra tardo Medioevo e prima età moderna
Corine MAITTE, Transmettre l’art et les secrets du verre à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècles
Pouvoirs
Grethe JACOBSEN, Kingship and gender in the Nordic countries during the Middle Ages : female transmission of power in elective kingship systems
Anna MIRABELLA, La transmission du pouvoir royal dans Phèdre et Hippolyte (1677) de Jean Racine
Laura CASELLA, Nom, noblesse et patrimoine en danger : transmission matérielle et immatérielle dans la famille Savorgnan au XVIIIe siècle
Laurence CROQ, Hommes nouveaux, pionniers et héritiers : la transmission du pouvoir dans l’échevinage parisien de 1685 à 1789
Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome 447, 2011
505 p. – 65 €
ISBN : 978-2-7283-0908-5
Monde chrétien, Antiquité tardive – XVIIe siècle
Piroska NAGY, Michel-Yves PERRIN et Pierre RAGON (dir.)
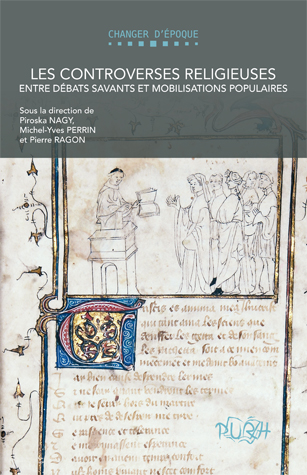 Omniprésente dans la vie des Églises chrétiennes, la controverse est pour elles un moyen, sinon le moyen par excellence, de se définir. Longtemps, l’histoire ecclésiastique lui a fait la meilleure part, avant de l’évacuer il y a quelques décennies, lorsque l’étude des dogmes est passée de mode pour laisser la place à une histoire plus sociale des institutions. Aujourd’hui, il paraît possible – et nécessaire – de revisiter à nouveaux frais l’histoire des controverses religieuses car celle des Églises a profondément changé. Renouvelée par l’anthropologie religieuse, l’histoire des pratiques collectives et celle des croyances partagées, elle n’est plus seulement celle des institutions, des clercs et de leurs disputes. Une nouvelle sensibilité historienne permet enfin de prendre conscience de l’importance des participations populaires à des luttes qui ne sont pas seulement des querelles savantes menées au sein des seuls cercles cultivés. De l’Antiquité tardive à l’époque moderne, le présent ouvrage ouvre des voies nouvelles. Omniprésente dans la vie des Églises chrétiennes, la controverse est pour elles un moyen, sinon le moyen par excellence, de se définir. Longtemps, l’histoire ecclésiastique lui a fait la meilleure part, avant de l’évacuer il y a quelques décennies, lorsque l’étude des dogmes est passée de mode pour laisser la place à une histoire plus sociale des institutions. Aujourd’hui, il paraît possible – et nécessaire – de revisiter à nouveaux frais l’histoire des controverses religieuses car celle des Églises a profondément changé. Renouvelée par l’anthropologie religieuse, l’histoire des pratiques collectives et celle des croyances partagées, elle n’est plus seulement celle des institutions, des clercs et de leurs disputes. Une nouvelle sensibilité historienne permet enfin de prendre conscience de l’importance des participations populaires à des luttes qui ne sont pas seulement des querelles savantes menées au sein des seuls cercles cultivés. De l’Antiquité tardive à l’époque moderne, le présent ouvrage ouvre des voies nouvelles.
Table des matières
Piroska Nagy, Michel-Yves Perrin et Pierre Ragon, Les controverses religieuses entre débats savants et mobilisations populaires (monde chrétien, Antiquité tardive – XVIIe siècle)
Michel-Yves Perrin, « The blast of the ecclesiastical trumpet » : prédication et controverse dans la crise pélagienne. Quelques observations
Frédéric Alpi, Sévère d’Antioche, prédicateur et polémiste : quali�cation et disquali�cation des adversaires dogmatiques dans les Homélies cathédrales
Uwe Brunn, Quand Dieu et les démons délivrent des vérités sur les cathares. Visions et exorcismes dans la propagande antihérétique
Jérémie Foa, « Plus de Dieu l’on dispute et moins l’on en fait croire ». Les conférences théologiques entre catholiques et réformés au début des guerres de Religion
Luc Daireaux, Les conférences théologiques entre catholiques et réformés en Normandie au XVIIe siècle
Anne Perennec-Sublime, La vision de l’adversaire dans la prédication militaire au XVIIe siècle dans l’espace germanique : tentative d’approche comparée des thèmes catholiques et protestants
Jean-Pascal Gay, Théologie morale et espace public dans la France du second XVIIe siècle : réflexions sur la littérarisation d’une polémique
Rouen, PURH, Changer d’époque, n° 24, 2011
24 x 15.5 cm – 152 p. – 18 €
ISBN : 978-2-87775-512-2 – ISSN : 1263-9737
Rémi Dalisson
 Hippolyte Carnot n’a ni la gloire de son père, « l’organisateur de la victoire » de l’An II, ni le renom de son frère, l’inventeur de la thermodynamique, ni le destin tragique de son fils, président de la République assassiné en 1894. Il reste méconnu alors que sa vie couvre presque tout un siècle (1801-1888) et que son oeuvre et son influence sont considérables. À travers révolutions, coups d’État, monarchies, empires ou républiques, guerres et procès, ce ministre de l’Instruction publique de 1848, ami de Victor Hugo et de Jules Ferry, est en effet un bâtisseur et un inspirateur. Il participe à tous les combats pour les libertés publiques et privées, jette les bases de la formation des professeurs et de l’école gratuite et obligatoire, y compris maternelle, crée l’ancêtre de l’ENA et défend les causes les plus avancées (scolarisation des filles, suffrage universel, lutte contre l’esclavage et abolition de la peine de mort). Philosophe et journaliste, mémorialiste et ministre, franc-maçon et croyant, exilé politique et député, sénateur et membre de l’Académie, il incarne le XIXe siècle. La redécouverte d’une grande figure de notre panthéon républicain. Hippolyte Carnot n’a ni la gloire de son père, « l’organisateur de la victoire » de l’An II, ni le renom de son frère, l’inventeur de la thermodynamique, ni le destin tragique de son fils, président de la République assassiné en 1894. Il reste méconnu alors que sa vie couvre presque tout un siècle (1801-1888) et que son oeuvre et son influence sont considérables. À travers révolutions, coups d’État, monarchies, empires ou républiques, guerres et procès, ce ministre de l’Instruction publique de 1848, ami de Victor Hugo et de Jules Ferry, est en effet un bâtisseur et un inspirateur. Il participe à tous les combats pour les libertés publiques et privées, jette les bases de la formation des professeurs et de l’école gratuite et obligatoire, y compris maternelle, crée l’ancêtre de l’ENA et défend les causes les plus avancées (scolarisation des filles, suffrage universel, lutte contre l’esclavage et abolition de la peine de mort). Philosophe et journaliste, mémorialiste et ministre, franc-maçon et croyant, exilé politique et député, sénateur et membre de l’Académie, il incarne le XIXe siècle. La redécouverte d’une grande figure de notre panthéon républicain.
Paris, CNRS Éditions Alpha, 2011
23 x 15 cm. – 434 p. – 29,00 €
ISBN : 978-2-271-07199-6
Philippe GOUJARD et Claude LANGLOIS (textes réunis par)

Rouen, PUR, Cahiers du GRHIS, n° 3, 1996
24 x 16 cm. – 99 p. – Épuisé
ISBN : 2877752003
|
Publications des doctorants |
 Projet Interreg 2010-2013
Projet Interreg 2010-2013

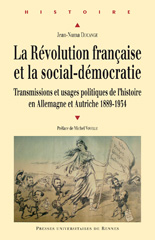 Les héritiers politiques de Marx des social-démocraties allemande et autrichienne entendent fixer leur lecture de la Révolution française en publiant à partir de 1889 ouvrages, articles et brochures. Ces écrits vont servir de fondement à une tradition d’interprétation de la « Grande Révolution » , enseignée et transmise au travers d’un impressionnant dispositif de formation et de diffusion. Étudiée ici grâce à l’exploitation de fonds d’archives peu connus, cette tradition qui tend à fixer une vulgate auprès d’un large milieu militant se heurte aux évolutions des social-démocraties et surgissement des révolutions en 1905 et 1917.
Les héritiers politiques de Marx des social-démocraties allemande et autrichienne entendent fixer leur lecture de la Révolution française en publiant à partir de 1889 ouvrages, articles et brochures. Ces écrits vont servir de fondement à une tradition d’interprétation de la « Grande Révolution » , enseignée et transmise au travers d’un impressionnant dispositif de formation et de diffusion. Étudiée ici grâce à l’exploitation de fonds d’archives peu connus, cette tradition qui tend à fixer une vulgate auprès d’un large milieu militant se heurte aux évolutions des social-démocraties et surgissement des révolutions en 1905 et 1917.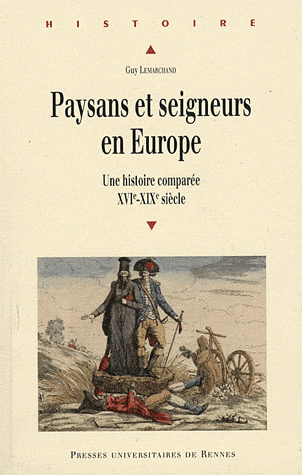 Centré sur les structures féodales rurales, ce livre vise à montrer à travers une comparaison internationale à l’échelle du Vieux Continent les ressemblances et les différences des formes de la seigneurie. Il fait intervenir dans le jeu paysans-seigneurs trois autres acteurs, l’un direct la noblesse, les deux autres externes : l’État et la ville. Du même coup, si l’ouvrage de Guy Lemarchand se veut essentiellement un livre d’histoire sociale, il ne peut se couper de l’énoncé de certaines grandes données économiques et démographiques dont le poids effectif doit être discuté.
Centré sur les structures féodales rurales, ce livre vise à montrer à travers une comparaison internationale à l’échelle du Vieux Continent les ressemblances et les différences des formes de la seigneurie. Il fait intervenir dans le jeu paysans-seigneurs trois autres acteurs, l’un direct la noblesse, les deux autres externes : l’État et la ville. Du même coup, si l’ouvrage de Guy Lemarchand se veut essentiellement un livre d’histoire sociale, il ne peut se couper de l’énoncé de certaines grandes données économiques et démographiques dont le poids effectif doit être discuté.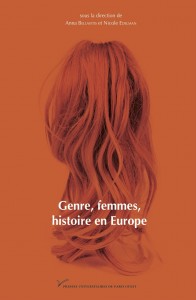
 La conversion à l’islam d’une partie des populations de l’Asie Mineure et des Balkans a marqué une rupture majeure dans l’histoire de la Méditerranée orientale. Au cours des XIXe et XXe siècles, ce phénomène a suscité des réactions d’autant plus contrastées qu’elles s’inséraient dans une culture politique marquée par l’affirmation d’États-nations fondant leurs racines dans les civilisations chrétiennes médiévales. Afin de permettre l’analyse des constructions identitaires et d’apprécier les vicissitudes des discours suscités par l’existence d’un islam enraciné dans des sociétés autrefois chrétiennes ou juives, quinze historiens ont collaboré pour établir une bibliographie raisonnée ; elle rend accessible plus de huit cent études composées, entre 1800 et 2000, par des auteurs originaires des Balkans et d’autres écoles historiques occidentales.
La conversion à l’islam d’une partie des populations de l’Asie Mineure et des Balkans a marqué une rupture majeure dans l’histoire de la Méditerranée orientale. Au cours des XIXe et XXe siècles, ce phénomène a suscité des réactions d’autant plus contrastées qu’elles s’inséraient dans une culture politique marquée par l’affirmation d’États-nations fondant leurs racines dans les civilisations chrétiennes médiévales. Afin de permettre l’analyse des constructions identitaires et d’apprécier les vicissitudes des discours suscités par l’existence d’un islam enraciné dans des sociétés autrefois chrétiennes ou juives, quinze historiens ont collaboré pour établir une bibliographie raisonnée ; elle rend accessible plus de huit cent études composées, entre 1800 et 2000, par des auteurs originaires des Balkans et d’autres écoles historiques occidentales.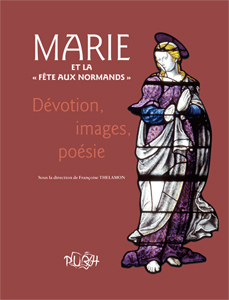 La Conception de Marie célébrée en Normandie depuis le Moyen Âge, la « Fête aux Normands », donna lieu aux XVe et XVIe siècles à un concours de poésie, le Puy de Palinods, et à une riche iconographie exaltant la beauté de Marie, signe de son Immaculée Conception. Les auteurs, historiens et spécialistes de la littérature et des arts, analysent textes et images témoins de ces pratiques sociales et religieuses.
La Conception de Marie célébrée en Normandie depuis le Moyen Âge, la « Fête aux Normands », donna lieu aux XVe et XVIe siècles à un concours de poésie, le Puy de Palinods, et à une riche iconographie exaltant la beauté de Marie, signe de son Immaculée Conception. Les auteurs, historiens et spécialistes de la littérature et des arts, analysent textes et images témoins de ces pratiques sociales et religieuses.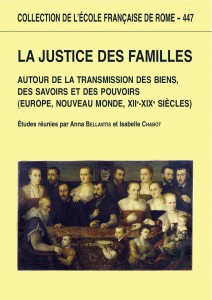
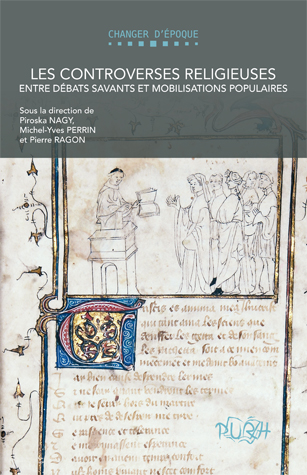 Omniprésente dans la vie des Églises chrétiennes, la controverse est pour elles un moyen, sinon le moyen par excellence, de se définir. Longtemps, l’histoire ecclésiastique lui a fait la meilleure part, avant de l’évacuer il y a quelques décennies, lorsque l’étude des dogmes est passée de mode pour laisser la place à une histoire plus sociale des institutions. Aujourd’hui, il paraît possible – et nécessaire – de revisiter à nouveaux frais l’histoire des controverses religieuses car celle des Églises a profondément changé. Renouvelée par l’anthropologie religieuse, l’histoire des pratiques collectives et celle des croyances partagées, elle n’est plus seulement celle des institutions, des clercs et de leurs disputes. Une nouvelle sensibilité historienne permet enfin de prendre conscience de l’importance des participations populaires à des luttes qui ne sont pas seulement des querelles savantes menées au sein des seuls cercles cultivés. De l’Antiquité tardive à l’époque moderne, le présent ouvrage ouvre des voies nouvelles.
Omniprésente dans la vie des Églises chrétiennes, la controverse est pour elles un moyen, sinon le moyen par excellence, de se définir. Longtemps, l’histoire ecclésiastique lui a fait la meilleure part, avant de l’évacuer il y a quelques décennies, lorsque l’étude des dogmes est passée de mode pour laisser la place à une histoire plus sociale des institutions. Aujourd’hui, il paraît possible – et nécessaire – de revisiter à nouveaux frais l’histoire des controverses religieuses car celle des Églises a profondément changé. Renouvelée par l’anthropologie religieuse, l’histoire des pratiques collectives et celle des croyances partagées, elle n’est plus seulement celle des institutions, des clercs et de leurs disputes. Une nouvelle sensibilité historienne permet enfin de prendre conscience de l’importance des participations populaires à des luttes qui ne sont pas seulement des querelles savantes menées au sein des seuls cercles cultivés. De l’Antiquité tardive à l’époque moderne, le présent ouvrage ouvre des voies nouvelles. Hippolyte Carnot n’a ni la gloire de son père, « l’organisateur de la victoire » de l’An II, ni le renom de son frère, l’inventeur de la thermodynamique, ni le destin tragique de son fils, président de la République assassiné en 1894. Il reste méconnu alors que sa vie couvre presque tout un siècle (1801-1888) et que son oeuvre et son influence sont considérables. À travers révolutions, coups d’État, monarchies, empires ou républiques, guerres et procès, ce ministre de l’Instruction publique de 1848, ami de Victor Hugo et de Jules Ferry, est en effet un bâtisseur et un inspirateur. Il participe à tous les combats pour les libertés publiques et privées, jette les bases de la formation des professeurs et de l’école gratuite et obligatoire, y compris maternelle, crée l’ancêtre de l’ENA et défend les causes les plus avancées (scolarisation des filles, suffrage universel, lutte contre l’esclavage et abolition de la peine de mort). Philosophe et journaliste, mémorialiste et ministre, franc-maçon et croyant, exilé politique et député, sénateur et membre de l’Académie, il incarne le XIXe siècle. La redécouverte d’une grande figure de notre panthéon républicain.
Hippolyte Carnot n’a ni la gloire de son père, « l’organisateur de la victoire » de l’An II, ni le renom de son frère, l’inventeur de la thermodynamique, ni le destin tragique de son fils, président de la République assassiné en 1894. Il reste méconnu alors que sa vie couvre presque tout un siècle (1801-1888) et que son oeuvre et son influence sont considérables. À travers révolutions, coups d’État, monarchies, empires ou républiques, guerres et procès, ce ministre de l’Instruction publique de 1848, ami de Victor Hugo et de Jules Ferry, est en effet un bâtisseur et un inspirateur. Il participe à tous les combats pour les libertés publiques et privées, jette les bases de la formation des professeurs et de l’école gratuite et obligatoire, y compris maternelle, crée l’ancêtre de l’ENA et défend les causes les plus avancées (scolarisation des filles, suffrage universel, lutte contre l’esclavage et abolition de la peine de mort). Philosophe et journaliste, mémorialiste et ministre, franc-maçon et croyant, exilé politique et député, sénateur et membre de l’Académie, il incarne le XIXe siècle. La redécouverte d’une grande figure de notre panthéon républicain.