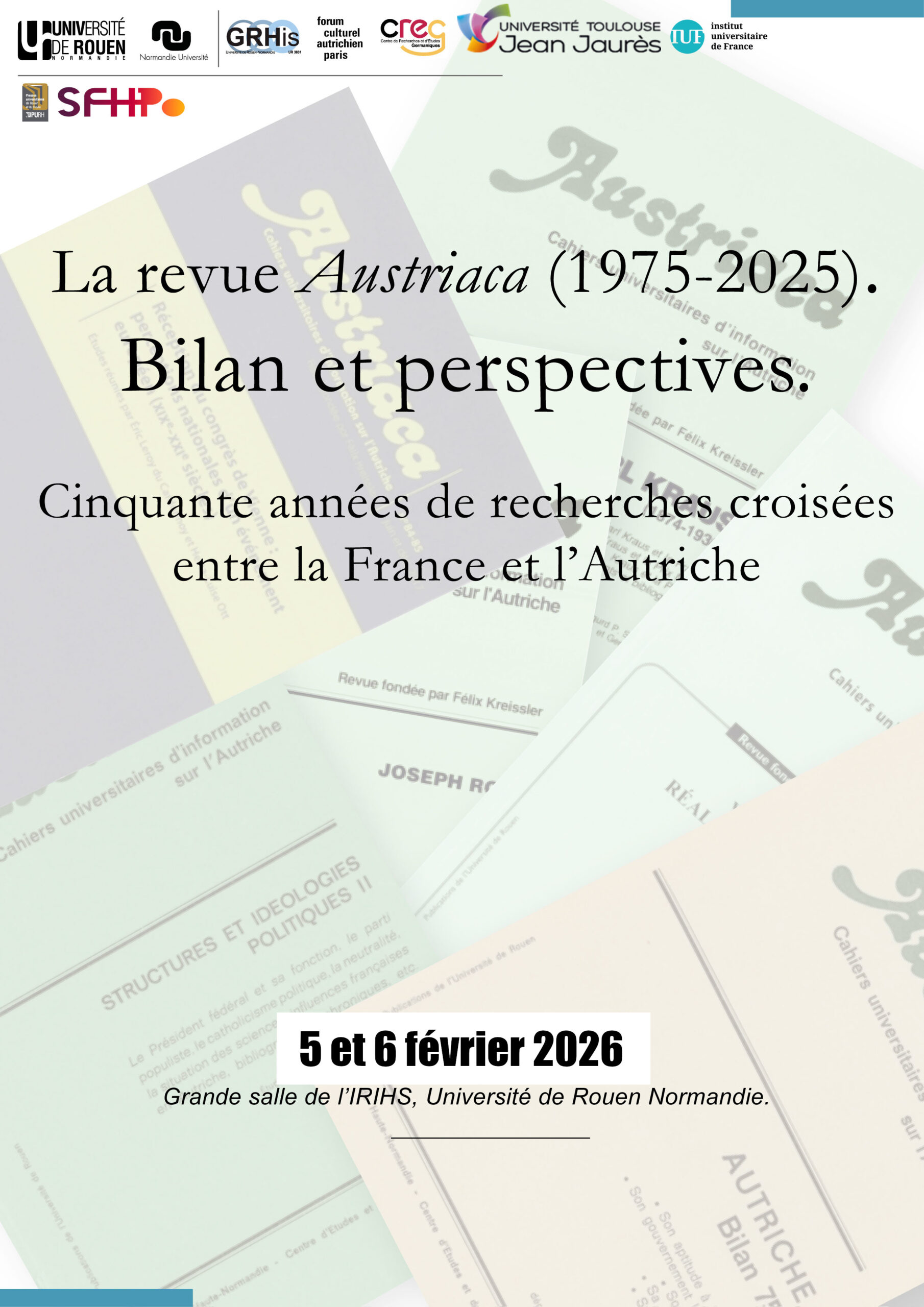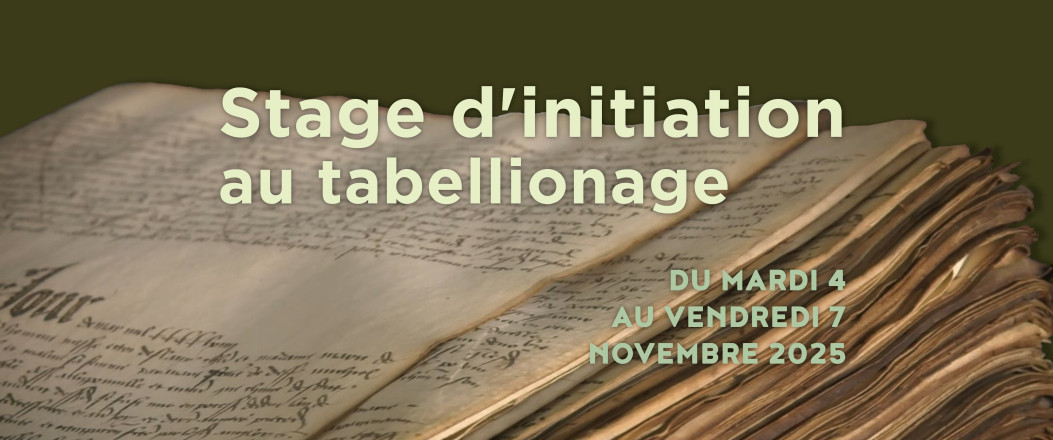Axes
La recherche au GRHis est structurée en six axes :
Axe 1 – Histoire des arts, représentations, cultures matérielles (coord. Frédéric Cousinié)
Derniers billets :
-
Appel à candidatures de l’Université d’été « Recherches sur l’art du dix-septième siècle »
La seconde édition de l’Université d’été est destinée à offrir un lieu et un temps privilégiés de rencontres entre professionnels et jeunes chercheurs (doctorants et M2 travaillant sur l’image en histoire de l’art, histoire, littérature, philosophie, arts du spectacle et musicologie) accueillant les recherches interdisciplinaires les plus stimulantes consacrées à l’art européen et extra-européen du…
-
Axe 1 – Histoire des arts, représentations, cultures matérielles
[ex-Axe « Patrimoine et Modernité] Direction : Frédéric Cousinié, Professeur d’histoire et théorie de l’art et de l’architecture Membres : Pierre-André Castanet, Anne-Marie Cheny, Mélodie Cotard, Frédéric Cousinié, Pascal Dupuy, Alexis Grélois, Marie Groult, Anthony Kits, Elisabeth Lalou, Bénédicte Percheron, Noémie Picard, Aurélien Poidevin, Florence Potosniak, Mathis Prevost, Chloé Richard-Desoubeaux, Lydwine Scordia, Sylvain Skora, Ismérie Triquet. L’axe, transdisciplinaire,…
-
Université d’été. Recherches sur l’art du XVIIe siècle : « Faire image » au XVIIe siècle
Jeudi 10 et vendredi 11 juillet, à l’INHA (galerie Colbert, salle Giorgio Vasari).
Axe 2 – Territoires, économies, sociétés (coord. Yves Bouvier et Enora Le Quéré)
Derniers billets :
-
Séminaires Axe 2
Programme des séances 2025/2026 du séminaire de l’axe 2
-
Axe 2 – Territoires, économies, sociétés
Coordonné par Yves Bouvier et Enora Le Quéré. – Présentation de l’axe L’axe 2 est centré sur l’histoire des territoires, dans leurs dimensions essentiellement économiques et sociales. Ces aspects sont développés dans une perspective trans-chronologique et trans-disicplinaire, allant de l’Antiquité gréco-romaine à l’Histoire contemporaine, en faisant également la part belle à l’archéologie, selon deux grandes…
Axe 3 – Guerres, frontières, impérialismes (coord. Pierre Cosme et Dan Muresan)
Derniers billets :
-
Pré-publication des actes intitulé Louis de Mas Latrie, historien de Chypre et de la Grèce franques
Le volume d’actes intitulé Louis de Mas Latrie, historien de Chypre et de la Grèce franques, dirigé par Philippe Trélat (GRHis/CEC) et Ludivine Voisin (GRHis/EFA) est désormais disponible en pré-publication dans la collection HAL de l’École française d’Athènes : https://hal.science/EFA/hal-05390350v1 Il regroupe l’ensemble des communications présentées lors du colloque consacré à Louis de Mas Latrie les…
-
Appel à communication- Colloque Giuseppe Gerola
Appel à communication pour le colloque sur « Giuseppe Gerola (1877-1938), historien de la Crète vénitienne et de la Grèce franque », prévu les 29 & 30 octobre 2026 à Padoue. Les propositions sont à envoyer pour le 10 janvier 2026 au plus tard.
-
Séminaires axe 3 1er semestre 2025-2026
Liste des séminaires de l’axe 3 pour le 1er semestre de l’année 2025-2026.
-
Axe 3 – Guerres, frontières, impérialismes (coord. Pierre Cosme et Dan Muresan)
À la rentrée 2025, l’axe 3 du GRHis « Guerres, frontières, impérialismes »compte cinq enseignants-chercheurs titulaires, dont deux récemment recrutés en histoire contemporaine.
Axe 4 – Révolutions XVIIe-XXIe. Révolutions anglaises, Révolution française, révolutions contemporaines (coord. Vincent Denis et Jean-Numa Ducange)
Derniers billets :
-
La revue Austriaca (1975-2025). Bilan et perspectives.
Les 5 et 6 février 2026, grande salle de l’Irihs (campus de Mont-Saint-Aignan)
-
Séminaire de l’axe 4 pour l’année 2025-2026 : L’État et la Révolution
Le séminaire commun de l’axe 4 en 2025-2026 portera sur l’Etat et la Révolution (XVIIe-XXe siècle).
-
Axe 4 – Révolutions XVIIe-XXIe. Révolutions anglaises, Révolution française, révolutions contemporaines
Les chercheurs réunis autour de l’axe « Révolutions » (Axe 4) entendent interroger dans la longue durée l’histoire des processus révolutionnaires, les conditions de possibilité qui ont permis leur émergence, les transformations politiques, sociales, culturelles et religieuses qui en découlent.
Axe 5 – Genre, familles, générations (coord. Anna Bellavitis et Clémentine Vidal-Naquet)
Derniers billets :
-
Séminaire de l’Axe 5 2025-2026
Le séminaire de l’Axe 5 en 2025-2026 portera sur l’histoire du travail, dans une perspective de genre, de l’antiquité à l’époque contemporaine. Intervenant.e.s : Nadine Bernard ; Alexis Grélois, Pascal Dupuy, Anna Bellavitis, Clémentine Vidal-Naquet Programme du premier semestre 2025-26 : mercredi 8h30-10h30
-
Axe 5 – Genre, familles, générations
L’Axe 5 est centré sur l’histoire des femmes et du genre, ainsi que sur l’histoire de la famille, et des relations entre les générations. Ces aspects sont développés à partir d’une approche d’histoire sociale et dans une perspective trans-période allant de l’antiquité grecque au temps présent et s’articulent autour de deux grandes thématiques.
Axe transversal 6 – Humanités Numériques (coord. Boris Bove et Nicolas Monteix)
Derniers billets :
-
Séminaire transversal de l’axe 6 (2025-2026)
L’axe 6 « Humanités numériques », parce qu’il est transversal, n’a pas de séminaire propre. Pour contribuer à la formation initiale et continue des membres du GRHis qui aimeraient voir comment on peut mettent en oeuvre les humanités numériques au service d’un questionnement historique, nous signalons les séminaires qui s’appuient significativement sur l’effet de levier heuristique qu’autorisent…
-
Axe transversal 6 – Humanités Numériques
Coordination: Boris Bove, Nicolas Monteix et François Delisle Présentation Cet axe, inauguré en 2022, se propose de promouvoir les humanités numériques auprès des enseignants-chercheurs et des étudiants du GRHis en signalant les séances de séminaires mettant en œuvre des outils numériques au service d’un questionnement historique, en organisant des retours d’expériences des membres du laboratoire…
-
L’IA au service de la recherche historique : vocabulaire, historique, projets
23 juin 2025, IRHIS, salle 2. JE de l’axe 1 (humanités numériques) du GRHIS, organisée par Boris Bove.
Chacun de ces groupes de recherche organise des journées d’étude, colloques, séminaires, conférences et autres rencontres scientifiques. Si certains des projets donnent lieu à des recherches ne faisant pas appel à l’ensemble des membres du laboratoire, d’autres visent, au contraire, à une interdisciplinarité et à une rencontre entre les quatre périodes académiques en Histoire.
Projets
Projets de recherche en cours
Projets passés
Thèses
Faire une thèse au GRHis
Si vous souhaitez faire une thèse en Histoire, Histoire de l’art ou Musicologie au sein du GRHis, la première étape est de définir un sujet sur lequel travailler en prenant contact (par courrier ou courriel) avec un/e des directeurs/rices de recherche susceptibles d’encadrer vos travaux. Il/elle saura vous conseiller sur la pertinence et la faisabilité du sujet auquel vous avez pensé, ou bien vous faire des propositions si vous n’avez pas une idée précise de sujet. Les membres du GRHis habilités à diriger des recherches sont :
- Anna Bellavitis (Histoire moderne)
- Nadine Bernard (Histoire grecque)
- Didier Boisseuil (Histoire médiévale)
- Boris Bove (Histoire médiévale)
- Yves Bouvier (Histoire contemporaine)
- Déborah Cohen (Histoire moderne)
- Pierre Cosme (Histoire ancienne)
- Frédéric Cousinié (Histoire et Théorie de l’Art et de l’Architecture)
- Vincent Denis (Histoire moderne)
- Jean-Numa Ducange (Histoire contemporaine, “histoire politique et sociale des XIXe et XXe siècles en Europe”)
- Stéphane Haffemayer (Histoire moderne)
- Enora Le Quéré (Histoire grecque)
- Clémentine Vidal-Naquet (Histoire contemporaine)
N’hésitez pas à visiter leurs pages personnelles et celles consacrées aux activités du GRHis pour en savoir plus sur leurs thèmes de recherche, et prendre contact avec eux le cas échéant. Vous pouvez aussi consulter la page « Docteurs du GRHis » pour avoir une idée des sujets étudiés.
Plus de renseignements (dossier d’inscription, charte de thèse, réinscription annuelle…) sont disponibles en suivant ce lien (Direction de la Recherche et de la Valorisation). Les représentantes des doctorant.e.s de l’ED Normandie Humanités pour le site de Rouen ont également fait un guide très utile à destination des doctorants qui débutent leur thèse, disponible en cliquant sur l’image ci-dessous :
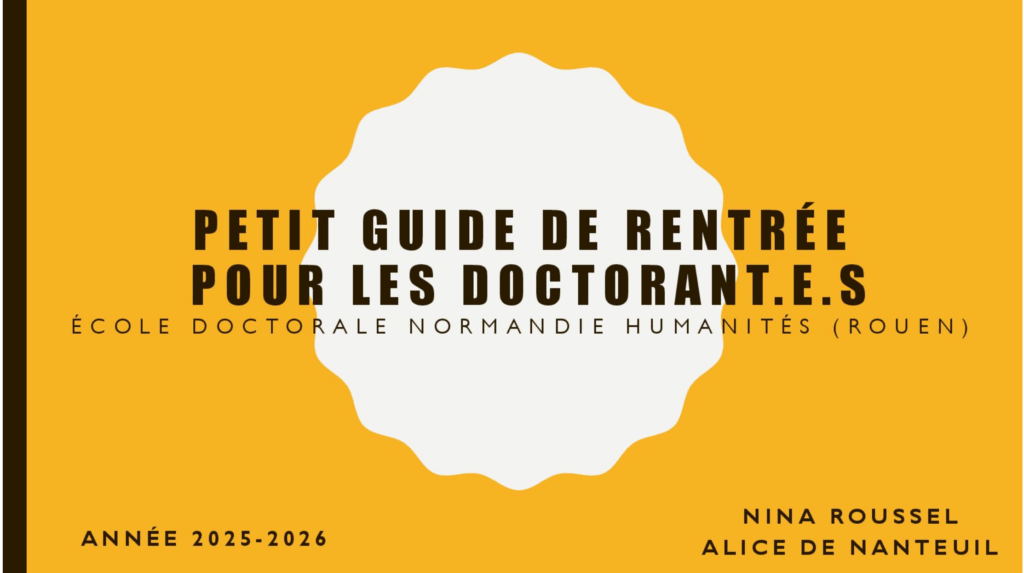
Thèses en cours
- Séparations de biens et séparations de corps en Normandie (1750 – 1792)
Céline Gaulthier (direction Déborah Cohen) - Μettre la main à la paste ». De la répartition spatiale à la division sexuée du travail : l’emploi rémunéré des femmes à Paris (XIIIe-XVIe siècle)
Anaelle Pourteau (direction Boris Bove) - Anatomie de l’esprit de clocher. Les communautés paroissiales en milieu urbain à Rouen (1440-1520)
Alissia Berne (direction Boris Bove) - Festivités, réjouissances et protestantisme (1520-1685),
Matéo Faget (direction Déborah Cohen) - La réinvention de Sparte à l’époque hellénistique : mythes et réalités d’un nouveau destin géopolitique et culturel méditerranéen,
Mael Lebas (direction Enora Le Quéré) - Les enfants du peuple à Paris au XVIIIe siècle,
Lorenzo Orlo (direction Vincent Denis et Massimo Cattaneo) - Importer l’impressionnisme en Lorraine,
Dorine Traon (direction Claire Maingon) - Pouvoir, influence et visibilité d’une aristocrate romaine, Octavia Minor (69 – 11 AEC),
Valérie Bauville (direction Pierre Cosme) - L’argent de la guerre : Pierre Surreau trésorier de la Normandie anglaise (1422-1435),
Jérémie Veysseyre (direction Boris Bove) - Les bains-gymnases d’Asie Mineure,
Laetitia Lucas (direction Enora Le Quéré) - Parenté et pouvoir seigneurial au féminin en Normandie (XVIe-XVIIIe siècles),
Léa Chacon (direction Anna Bellavitis et Elie Haddad) - La maréchaussée en Rouergue ( 1720-1791 ) : acteurs, pratiques, interactions sociales,
Mathieu Raynal (direction Vincent Denis) - Drapeaux et bannières populaires en France de la révolution Française à la Première Guerre mondiale,
Isaline Audebert (direction Jean-Numa Ducange et Enguerrand Lascols) - La chanson et la musique de tradition orale en Normandie, des sources anciennes aux collectes ethnographiques des XXe et XXIe siècles,
Chloë Richard-Desoubeaux (direction Stéphane Haffemayer et Eva Guillorel) - La social-démοcratie « tchéco-slave » de sa genèse à sa rupture avec le ΚSC (des alentours de 1860 à 1921) : du marxisme internationaliste au socialisme « national-démocrate ». Une histoire dans la tourmente des conflits nationalitaires de la double monarchie austro-hongroise ?,
Alexandre Riou (direction Jean-Numa Ducange et Etienne Boisserie) - Métaphores animalières et construction sémantique dans les miroirs aux princes latins du ΧΙΙΙe siècle,
Mathis Prevost (direction Lydwine Scordia) - L’industrialisation permanente : échelles, adaptations, cultures et territoires de l’industrie à Pont-Audemer aux XXe et XXIe siècles,
Thomas Pernot (direction Yves Bouvier et Françoise Lucchini) - La crise économique internationale de 1973 et ses répercussions sur les secteurs pétrolier et minier au Gabon (1973-1979),
Gemina Dessou (direction Yves Bouvier et Françoise Lucchini) - Princesses de Morée aux 13ème et 14ème siècles,
Pauline Menou (direction Anna Bellavitis et Lydwine Scordia) - Les lieux du cinéma en Normandie au XXème siècle : pratiques sociales, culture matérielle et volontés locales,
Alexis Yachine (direction Yves Bouvier) - Le centre d’éducation par le travail de Tatihou (Manche) expérimentations et transformations de la prise en charge des « jeunes inadaptés », de la sortie de la Seconde Guerre mondiale aux années 1980,
Léna Grimbert (direction Yves Bouvier) - ... Est tout ce qu’elle dit savoir, Agentivité des femmes face à la justice dans la dernière moitié du ΧVΙΙΙe siècle à Rouen,
Catherine Hans (direction Anna Bellavitis) - Les activités normandes en Afrique de l’ouest, de Jean Ango à la Compagnie des Indes Occidentales (début du ΧVΙe siècle – 1664),
Matthieu Provençalle (direction Stéphane Haffemayer) - Rouen vu de ses remparts. Fonctions et incidences des fortifications sur la ville (ΧVe-milieu ΧVΙe siecles),
Camille Cilona (direction Boris Bove et Jean-Marie Laurence) - Les commémorations de la grand guerre à Rouen entre culte civique et johaniques (1919-1944),
Aymeric Loga (direction Rémi Dalisson) - Frumentarii et speculatores : des sous-officiers de l’armée romaine,
Quentin Firoul (direction Pierre Cosme) - S’armer sous la IIIème République : Histoire sociale des armes à feu : citoyens, consommateurs et collectionneurs. (1870 – 1940),
Arthur Soudet (direction Yves Bouvier) - Faire communauté par les pratiques religieuses à Paris (XIIIe – XVIe siècle),
Adrien Ferré (direction Boris Bove) - Ambition impériale et réalité coloniale. De la Grande Idée à la construction nationale en Macédoine : les projets des libéraux grecs du début XXe siècle (1904-1936),
Lukas Tsiptsios (direction Jean-Numa Ducange et Anastassios Anastassiadis) - D. B. Rjazanov, E. Peluso, A. Τasca: réception et diffusion de la pensée de Κarl Μarx et Friedrich Engels dans l’exil communiste (1926-1933)
- Les adresses à des divinités par des corps de troupe de l’armée romaine sous le Haut-Empire,
Marine Leroy (direction Pierre Cosme) - Le Bosphore Rouge. La surveillance de la gauche pendant l’occupation alliée de Constantinople (1918-1923),
Vincent Benedetto (diection Jean-Numa Ducange et Alexandre Toumarkine) - Le genre du témoignage : femmes et hommes comme témoins dans les sources de la justice civile vénitienne (deuxième moitié du XVe-début du XVIIe siècle),
Audrey Gôme (direction Anna Bellavitis) - Babeuf après Babeuf : circulation internationale des idées babouvistes de Buounarroti à Riazanov (de la publication de L’Histoire de la Conspiration pour l’égalité, dite de Babeuf à la constitution du fonds Babeuf à Moscou),
Jean Dieuleveux (direction Jean-Numa Ducange et Anne de Mathan) - Les femmes de Terre-Neuvas a Fécamp,
Mathilde Bouttereux (direction Anna Bellavitis et Jean-Numa Ducange) - Les relations entre les socialistes francais et autrichiens, de la fin du XIXe siècle au début des années 1930,
Pierre-Henri Lagedamon (direction Jean-Numa Ducange). - Ηistoire des sections françaises de l’assοciation internationale des Travailleurs (1864-1872),
Julien Grimaud (direction Jean-Numa Ducange) - La perception de la figure de Muhammad par les milieux intellectuels français du ΧΙΧe siècle,
Philippe Sannier (direction Frédéric Cousinié et Samir Saul) - Le fait de consanguinité dans le couple européen, a travers les sources de la Pénitencière Apostolique, sous le pontificat de Léon X (1515-1529), dans les diocèses de Dublin (IRE) et Rouen (FR),
Charlotte Godard (direction Anna Bellavitis) - Le contrôle de l’épée par la toge. Trahison et péril césariste, la suspicion contre les officiers supérieurs 1789-1815,
Anthony Ferreira de Abreu (direction Michel Biard) - Histoire des cadeaux et hommages au maréchal Pétain, chef de l’Etat français : un héritage mémoriel délicat,
Florence Potosniak (direction Rémi Dalisson) - L’après-bataille de César à Trajan,
Julien Spahn (direction Pierre Cosme) - Le cinéma et l’identité nationale: le rôle du cinéma dans la construction de l’identité azerbaidjanaise,
Ibrahim Ibrahimov (direction Ludivine Bantigny) - Le concept du continuum chez Giacinto Scelsi et chez Iannis Χenakis (titre provisoire),
Sharon Kanach (direction Pierre-Albert Castanet) - Le Tréport aux XVII et XVIIIe siècles,
Dany Laurent (direction Michèle Virol) - L’accordéon : France, Italie. Cent vingt ans de parenté musicale,
Dino Tonini (direction Pierre-Albert Castanet)
Thèses soutenues au GRHis
2025
Cédric DEMARE
- Capitalisme et Révolution. La bourgeoisie d’affaires normande à la conquête du pouvoir (1789-1815)
- Sous la direction de Michel Biard
Juliette KOTOWICZ
- Les portes et fenêtres des habitations citadines de 1510 à 1790 : lieux de vie ou de passage ? Une comparaison Rouen-Μontpellier
- Sous la direction d’Anna Bellavitis et Serge Bruney
Côme BARBARAY
- La république assiégée, entre réalités militaires et rhétorique politique
- Sous la direction de Michel Biard
Noémie PICARD
- L’école de Rouen : la normandité de l’avant-garde ? Marchands, réseaux, diffusion
- Sous la direction de Frédéric Cousinié
Virginie COGNE
- Renseigner et convaincre : les défis de la communication condéenne à l’apogée de la fronde princière (mars-octobre 1652)
- Sous la direction de Stéphane Haffemayer et Pascal Bastien
Yohan MARC
- Femmes accusées et victimes : affaires sexuelles, avortements, infanticides, empoisonnements, violences et féminicides devant les cours d’assises de la Seine-Ιnférieure et de l’Eure au XIXe Siècle
- Sous la direction de Jean-Numa Ducange
2024
Florent HERICHER
- Ρhilippe Le Bas (1794-1860). un Républicain de naissance
- Sous la direction de Michel Biard
Rémi AZEMAR
- Novembre-décembre 1995 : Histoire sociale et politique d’un mouvement pluriel
- Sous la direction de Ludivine Bantigny
Julien CHUZEVILLE
- Les courants socialistes et communistes en France sous la IIIe République, du local au transnational, de la monographie à la prosopographie.
- Sous la direction de Jean-Numa Ducange
2023
Lucien GRILLET
- Engagements et révolutions en Écosse. Culture et pratiques politiques du Covenant (vers 1560 – vers 1690).
- Sous la direction de Stéphane Haffemayer
2022
Mélodie COTARD
- De la caricature à l’imaginaire pittoresque. L’image dans la presse illustrée rouennaise et havraise au ΧΙΧe siècle (1830-1914).
- Sous la direction de Yannick Marec
Clotilde BOITARD
- La nature au fοyer : animaux apprivοisés au ΧVΙΙΙeme et début du ΧΙΧeme siècle
- Sous la direction de Michel Biard
Marie GROULT
- « Εt vοus avοns esleu d’estre au nοmbre de ladite Cοmpagnie ». Les ordres de chevalerie au sein des cours françaises au ΧΙVe siècle et l’éditiοn de leurs statuts.
- Sous la direction de Elisabeth Lalou
Arthur DUTRA CARVALHO REIS
- De l’improvisation collective au « solo imprévu » : une étude inclusive et interculturelle de l’expérience musicale.
- Sous la direction de Pierre-Albert Castanet
2021
Charles-Alban HORVAIS
- Les armées romaines en Afrique à l’époque républicaine (256-46 av. J.-C.).
- Sous la direction de Pierre Cosme
Alexandra AMIOT
- Éduquer et former les populations laborieuses au cours de l’époque moderne. Étude du cas rouennais
- Sous la direction d’Anna Bellavitis
Louise BONVALET
- La sorcellerie masculine à Venise à l’époque moderne (1630-1797). Entre hérésie et surnaturel.
- Sous la direction d’Anna Bellavitis et Frederico Barbierato (Université de Vérone)
Angèle STALDER
- Pratiques informationnelles avec et autour de document technique chez les conducteurs de travaux : approche informationnelle et approche communicationnelle
- Sous la direction d’Eric Delamotte
2020
Marie MALHERBE
- Le jeu de la pourpre et du bâtard : Les enfants illégitimes de patriciens face à l’aristocratie vénitienne à travers cinq procès en justice civile au dernier siècle de la République (1694-1780).
- Sous la direction d’Anna Bellavitis et Luciano Pezzolo (Université Ca’Foscari)
Ghislain CHASME
- L’architecture de l’information, un paradigme pour les dispositifs de formation à distance : le cas du dispositif M@gistère.
- Sous la direction d’Eric Delamotte
Paul MANEUVRIER-HERVIEU
- La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle. Production, commerce et crises.
- Sous la direction de Jean-Marc Moriceau (Université de Caen-Normandie) et Michel Biard
Véronique MATHIS
- Louis Lafitte (1770-1828) : un peintre d’histoire de la Révolution à la Restauration.
- Sous la direction de Michel Biard
Guillaume TABET
- De Marie-Antoinette aux Merry Antoinettes, le détournement contemporain d’une figure historique aux Etats-Unis.
- Sous la direction de Ludivine Bantigny
Dany LAKE-GIGUÈRE
- Administrer les forêts du roi au Moyen Age. Le negotium forestarum en Normandie capétienne (1204-1328).
- Sous la direction de Philippe Genequand et de Elisabeth Lalou
2019
Warren WANNER
- Jean Lecanuet maire de Rouen : un homme d’Etat en son territoire (1953-1993)
- Sous la direction d’Olivier Feiertag
Antoine SANTAMARIA
- Psychédélisme et musique pop. De l’utopie vers la théorie (1965-1973)
- Sous la direction de Pierre-Albert Castanet
Lucie GUYARD
- Itinérance féminine et institutions : le vagabondage féminin dans la généralité de Rouen au XVIIIe siècle
- Sous la direction d’Anna Bellavitis
Julie CAMPION-LAVIGNE
- L’empereur Antonin Caracalla
- Sous la direction de Pierre Cosme
Mathieu BIDAUX
- De la presse à la monnaie (1857-1945) : La Fabrication des billets de la Banque de France, construction et entretien de la confiance
- Sous la direction d’Olivier Feiertag
Tristan LE JONCOUR
- La République française entre péril intérieur et insécurité extérieure. Tradition révolutionnaire-conservatrice vs modernité réactionnaire-progressiste, 1789-1794 / 1939-1944
- Sous la direction de Michel Biard
Pierre MILEO
- Les syndicats de fonctionnaires en Seine maritime et le mouvement social de 1945 à 1981
- Sous la direction d’Olivier Feiertag
Matteo POMPERMAIER
- ‘Le vin et l’argent’ : osterie, bastioni et marché du crédit à Venise au XVIIIe siècle
- Sous la direction d’Anna Bellavitis
2018
Matthieu COLMAR
- Gaullisme et gaullistes en Haute-Normandie (1969-1992)
- Sous la direction de Olivier Feiertag
Corina STALINA
- Rôles des centres de documentation et d’information dans la construction d’une culture de l’information dans le système d’enseignement scolaire roumain.
- Sous la direction de Eric Delamotte et de Mircea Regneala
Baptiste ETIENNE
- Rouen en 1650 : carrefour des conflits
- Sous la direction de Michèle VIROL et Alain HUGON
Bruno MARCHAL
- L’application de l’enseignement du français langue étrangère et de la diffusion d’informations au travers de plateformes de réseaux sociaux – Le cas de Facebook
- Sous la direction de Eric Delamotte
Lise LEVIEUX
- Le rôle des communautés religieuses dans la fabrique urbaine de Rouen (Xe-XVe siècle)
- Sous la direction de Elisabeth Lalou
Camille BÉRA
- Le Black Metal : un genre musical entre transgression et transcendance
- Sous la direction de Pierre-Albert Castanet
Guillaume BUREAUX
- Union et désunion de la noblesse en parade. Le rôle des Pas d’armes dans l’entretien des rivalités chevaleresques entre cours princières occidentales aux XVe et XVIe siècles (Anjou, Bourgogne, France, Empire)
- Sous la direction d’Élisabeth Lalou et codirection de Lydwine Scordia
Hadrien VIRABEN
- Le savant et le profane : Documenter l’impressionnisme en France, 1900-1939
- Sous la direction de Frédéric Cousinié et codirection de Ségolène Le Men
Claude BUSUTIL
- Une architecture sous influence – Malte et les architectes et ingénieurs militaires pendant le règne de Louis XIV (1643-1715). Les choix politiques de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem
- Sous la direction de Michèle Virol
Laura TATOUEIX
- L’avortement en France à l’époque moderne. Entre normes et pratiques (mi-XVIe s. – 1791).
- Sous la direction de Sylvie Steinberg et Anna Bellavitis
Arevik PARSAMYAN
- Les temples antiques en Arménie avant la christianisation (IIIe siècle avant J.-C. – IVe siècle après J.-C.)
- Sous la direction de MM. Pierre Cosme et Patrick Donabedian
Yuta TAKEDA
- La républicanisation de la Banque de France de 1870 à 1897.
- Sous la direction de Olivier Feiertag
Pietro MILLI
- Giacomo Manzoni : sa poétique et son œuvre.
- Sous la direction de Pierre-Albert Castanet et de Laurent Feneyrou.
Plus d’informations…
La thèse, divisée en trois parties, constitue une introduction à l’univers musical de Giacomo Manzoni (Milan, 1932). La première partie aborde huit dimensions de l’œuvre du compositeur dans une perspective analytique (matériau, temps, dynamique, timbre, forme, figures sonores, espace et texte). Dans la deuxième partie, où figure une étude de Per Massimiliano Robespierre (1974) et de Doktor Faustus (1988), sont présentés les principaux axes de sa poétique : l’engagement et l’innovation. La dernière partie conceptualise la notion de matiérisme en tant que fondement de sa praxis compositionnelle. À ce propos, Atomtod (1964), sa troisième œuvre pour le théâtre musical, a été analysée. Des documents inédits, dont des esquisses de ses œuvres et une correspondance, ont été commentés tout au long de la thèse. Les annexes incluent un catalogue chronologique et thématique des œuvres du compositeur, une édition critique bilingue des textes mis en musique, la traduction de son dernier livre (Parole per musica) et une discographie.
Edouard BARATON
- La Romanie orientale : l’empire de Constantinople et ses avatars au Levant à l’époque des Croisades.
- Sous la direction de Gilles Grivaud
Solène SAZIO
- Hippolyte Bellangé (1800-1866), reconnaissance et oubli d’un artiste aux origines de la légende napoléonienne.
- Sous la direction de Yannick Marec
Thi Kim Lan NGUYEN
- Les documents iconographiques de presse dans les manuels de Français Langue Etrangère au Vietnam. Analyse d’une médiation translittéracique méconnue.
- Sous la direction de Eric Delamotte
2017
Rejane SILIGHINI
- Représentations de Jeanne d’Arc dans le patrimoine rouennais à travers le fond Vallery-Radot.
- Sous la direction de Yannick Marec
Maxime EMION
- Des soldats de l’armée romaine tardive : les protectores (IIIe-VIe s. ap. J.-C.).
- Sous la direction de Pierre Cosme
Stéphane RIOLAND
- Les utopies urbaines de Jules Adeline (1845 – 1909) ou l’Uchronie comme outils de réhabilitation de la ville.
- Sous la direction de Yannick Marec
Bruno NARDEUX
- Une « forêt » au Moyen Âge : le Pays de Lyons en Normandie (vers 1100 – vers 1450)
- Sous la direction de Elisabeth Lalou
Amaury BOULANGER
- Pierre Quesnay (1895-1937) un expert financier de la Normandie au monde
- Sous la direction de Olivier Feiertag
2016
Tatiana JOUENNE
- Le théâtre à Rouen au moyen-âge (XVe et XVIe siècles).
- Sous la direction de Elisabeth Lalou
Plus d’informations…
Cette étude concerne le théâtre des mystères à Rouen au Moyen-Âge. Véritables événements urbains et religieux, les mystères, aux XVe et XVIe siècles, rythment la vie rouennaise, et posent la question des modalités d’organisation mais aussi des lieux de leur représentation. L’objectif de cette étude n’est pas de faire une énumération de tous les spectacles joués à Rouen, mais, à partir de l’étude des sources, de rechercher quelles représentations sont réellement attestées, et de replacer l’événement dans la ville et la société.
Bénédicte TRÉMOLIÈRES
- Éléments pour une histoire matérielle de l’impressionnisme : Les Cathédrales de Claude Monet.
- Sous la direction de Frédéric Cousinié
Antony KITTS Prix 2017 du Comité d’histoire de la sécurité sociale [ Lien ]
- « Bons » ou « mauvais » pauvres ? Du mendiant vagabond au pauvre secouru en Normandie orientale au XIXe siècle (1796-1914).
- Sous la direction de Yannick Marec
- 3 vol. (874 f.) ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
La thèse porte sur la question du traitement de la pauvreté, de la mendicité et du vagabondage en Normandie orientale au XIXe siècle, région particulièrement affectée par ces phénomènes. Parmi les logiques et les processus de marginalisation de ces pauvres normands, la plus évidente trouve son origine dans l’évolution socio-économique d’un siècle traversé par plusieurs graves crises. D’autres éléments d’explications sont à chercher du côté de l’urbanisation, des migrations, de la criminalité et des vulnérabilités sociales et sanitaires. Cette réflexion nous a également conduit à nous interroger sur les moyens qu’une société met en œuvre pour combattre cette pauvreté et cette mendicité. Un système d’assistance publique, fondé sur les établissements hospitaliers et les bureaux de bienfaisance et secondé par une multitude d’œuvres charitables privées, s’est en effet mis en place progressivement pour soulager les « bons » pauvres, avant de s’affirmer véritablement sous la IIIe République. Parallèlement, les « mauvais » pauvres, incarnés, essentiellement dans les figures du mendiant et du vagabond, sont soumis à un sévère contrôle policier et judiciaire, dont le paroxysme sera atteint durant le dernier tiers du siècle avec la loi sur la Relégation de 1885.
2015
Paul FERREIRA
- Le CIN de 1980 à 2009. Histoire territoriale d’une place financière régionale.
- Sous la direction de Olivier Feiertag
Nacer BOUKROU
- L’immigration en France : entre intégration, assimilation et exclusion
- Sous la direction de Yannick Marec
- 1 vol. (602 p.) : ill. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
La France a toujours été une terre d’immigration. Toutefois, après la fin de la Seconde guerre mondiale, elle a reçu des vagues migratoires successives et diversifiées dans un cadre économique et démographique. Depuis, les principes et les pratiques sociales vis-à-vis des populations étrangères ont beaucoup évolué. Cette évolution décèle le changement ou les mutations socioéconomiques et/ou politiques ou l’on retrouve des notions telles que : intégration, assimilation, et exclusion largement utilisées dans les recherches en sciences sociales. L’usage de ces notions décrivant l’aspect socioculturel des phénomènes de migration montre à quel point les politiques migratoires et sociales ont tenté d’apporter une réponse à chaque mutation sociale, économique ou politique. Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes interrogés sur le modèle français d’intégration largement critiqué par certaines approches spécialisées dans le domaine institutionnel. Nous avons étudié l’évolution des principes et des pratiques sociales en faveur de l’intégration des immigrés dans la société française de 1945 à nos jours. Cette recherche se focalise sur l’étude des réalités migratoires dans la région rouennaise tout en portant un regard, plus général, sur le contexte socio-historique du phénomène d’immigration en France.
Emmanuelle BOBÉE
- La musique et les textures sonores comme éléments du récit filmique dans l’œuvre de David Lynch, d’Eraserhead (1977) à Inland Empire (2006)
- Sous la direction de Pierre-Albert Castanet, en codirection avec Gilles Mouëllic.
Plus d’informations…
Cette étude vise à explorer l’univers et l’esthétique du réalisateur américain David Lynch (1946-…) à travers la dimension musicale et sonore, en s’appuyant sur un vaste corpus constitué des dix longs métrages qu’il a réalisés entre 1977 et 2006. Depuis Eraserhead, véritable matrice sonore de l’œuvre à venir, le cinéaste a toujours accordé une place prépondérante à la musique et au sound design, n’ayant de cesse de parvenir à une réelle osmose entre les composantes visuelle et sonore du récit filmique. Fortement impliqué dans la création sonore, l’élaboration des musiques originales et le choix des musiques préexistantes, il a également su nouer des collaborations fructueuses et récurrentes, notamment avec l’ingénieur du son Alan Splet et le compositeur Angelo Badalamenti, ainsi que des partenariats occasionnels avec divers artistes contemporains. Au fil des années, Lynch a développé une approche singulière, à la fois foncièrement auteuriste et ouverte aux interventions extérieures, au hasard et à l’imprévu, qui s’accompagne de méthodes de travail originales fondées sur l’expérimentation, l’intuition et le « processus d’action-réaction ». Son cinéma utilise toutes les potentialités du registre de l’audible et de la combinaison audiovisuelle pour interagir avec le spectateur, suscitant tantôt l’adhésion au monde fictionnel – notamment par des mécanismes de subjectivisation –, tantôt la désorientation et la distanciation par une mise en évidence de la représentation filmique. Ce constant déploiement de forces contraires contribue à nourrir le sentiment d’inquiétante étrangeté qui émane des récits lynchéens, renforcé ou induit par certains procédés tels que l’utilisation de chansons préexistantes puisées dans le répertoire pop des années 1960, le recours au play-back et l’intégration de scènes chantées ou chorégraphiées, ou encore la mise en place de stratégies musico-narratives inspirées par les mécanismes du rêve ou par le principe de répétition du même.
Romain GRANCHER
- Les usages de la mer. Droit, travail et ressources dans un monde de la pêche (Dieppe, années 1720 – années 1820)
- Sous la direction de Michel Biard
- 1 vol. (516 p.) : ill. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
Cette thèse entend analyser le fonctionnement du monde de la pêche à Dieppe au XVIIIe siècle à la charnière de trois champs de recherche : l’histoire du travail, l’histoire environnementale et l’histoire du droit. Elle débute par une présentation du terrain, des enjeux et des sources de l’enquête. Il en ressort que ce monde du travail doit être envisagé comme un « commun » organisé par les acteurs de la communauté en vue de l’appropriation des ressources de la mer. À cet égard, la juridiction du siège d’amirauté est amenée à jouer un rôle crucial puisqu’elle se voit investie par les pêcheurs de fonctions très spécifiques, de l’ordre de la régulation, de la certification ou de la légitimation. Croisées avec des mémoires ou des sources comptables, les archives des procédures civiles portées devant ce tribunal de la mer permettent de proposer, dans une deuxième partie, une approche située du monde de la pêche, sous l’angle des pratiques, des règles et des institutions reconnues par les acteurs de la communauté de métier. C’est l’occasion de revenir sur les modalités concrètes de l’appropriation du poisson, en examinant les transactions internes aux collectifs de matelots, de maîtres et d’armateurs associés sous le régime de l’armement à la part. Opérant un décentrement, la troisième partie aborde la problématique du gouvernement des ressources dans le temps de deux conjonctures de réglementation, d’abord dans les années 1720-1730, puis sous la Restauration. À travers l’analyse de controverses, de conflits d’usage, d’intérêt ou d’expertise, il s’agit ici de comprendre comment des lois de portée générale viennent s’articuler à la situation particulière d’une communauté locale. En somme, ce travail cherche à restituer les processus par lesquels se fabriquent et s’imposent des normes à l’échelle d’un monde du travail d’Ancien Régime caractérisé par des systèmes normatifs non seulement hétérogènes, mais concurrents.
Isabelle ANTUNES
- Les administrations de district, un rouage majeur de la vie politique au temps de la révolution (1790-1795). L’exemple de la Normandie.
- Sous la direction de Michel Biard
- 2 vol. (555p., 555 p.) ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
Une importante réforme administrative a débuté pendant la Révolution française. Le district a ainsi été mis en place en 1790, échelon entre le département et les municipalités. L’étude porte sur les administrations de district des départements de Normandie (Calvados, Eure, Seine-Inférieure, Orne, Manche). D’abord simple rouage entre les différentes administrations, il se révèle beaucoup plus important en tant que pouvoir intermédiaire et élément clef du fil conducteur des pouvoirs. Quelles ont été les relations de cette administration territoriale avec les autres districts, les organes supérieurs, les échelons « inférieurs », les citoyens, les divers commissaires envoyés en mission ? Quelles influences les événements révolutionnaires ont-ils pu avoir sur les relations déjà ambiguës des districts, sur leur mode de fonctionnement, comme sur leur attitude politique ? En 1795, la nouvelle Constitution fait disparaître cette administration territoriale.
Antoine RENSONNET
- Le parti socialiste en Haute-Normandie : des structures épinayennes à l’organisation fabiusienne (1971-2004)/
The Socialist Party in Upper Normandy: From the structures of Epinay to the fabiusian organisation (1971-2004)
Electoral evolution and partisan development - Sous la direction d’Olivier Feiertag.
Plus d’informations…
Depuis son congrès refondateur d’Epinay en 1971, l’histoire du Parti socialiste est, en Haute-Normandie, marquée par deux claires spécificités. D’abord, cet acteur, qui n’avait jamais été puissant dans un territoire urbain et industriel pourtant assez favorable à la gauche mais où le Parti communiste l’a longtemps dominée, s’est progressivement imposé comme la force politique centrale de la région. Ensuite, Laurent Fabius, élu du Grand-Quevilly depuis 1977 et Premier ministre de 1984 à 1986, s’est rapidement affirmé comme le principal leader du parti et a présidé à sa mutation.
Ce travail se propose alors d’examiner les phases d’un développement électoral considérable, opéré sous contrainte nationale mais possédant des dimensions locales affirmées, d’une part, et l’évolution de l’organisation partisane, d’autre part, ainsi que d’interroger le lien entre les deux. De façon connexe, les bouleversements des équilibres politiques régionaux induits par la croissance du PS et la culture, de pouvoir notamment, de l’organisation socialiste demandent à être étudiées.
Emerge finalement un objet aux multiples facettes, dont le succès doit beaucoup aux structures sociologiques de la région mais qui ne possède cependant guère d’attaches avec les mouvements sociaux. Centré sur l’agglomération rouennaise et donnant néanmoins une certaine réalité politique à la Haute-Normandie, il se révèle également partiellement professionnalisé, du moins au niveau de ses cadres dirigeants, façonné par le legs épinayen et s’épanouit, tant en s’opposant frontalement à la droite qu’en promouvant une logique gestionnaire faiblement idéologisée, dans la domination des grandes collectivités locales.
In english
Since its refounding congress of Epinay in 1971, the Socialist Party in Upper Normandy has seen its history marked by two clear characteristics. First, this actor gradually imposed itself as the central political force in the region. It should be noted that previously, despite the fact that this urban and industrial territory was favourable to the Left, the Socialist Party had never been powerful there whereas the Communist Party was longtime dominant. Second, Laurent Fabius, an elected official from Grand-Quevilly since 1977 and Prime Minister from 1984 to 1986, asserted himself as the principal leader of the party and presided over its mutation.
This study proposes therefore to examine, on the one hand, the different phases of a considerable electoral development brought about within a national framework but having definite local dimensions and, on the other hand, the evolution, of the partisan organisation meanwhile examining the link between the two. Likewise, the upheavals of the regional political balance induced by the growth of the Socialist Party and the culture of the Socialist organisation, notably the culture of power, beg to be studied.
Finally, there emerges a multi-facetted object which owes much of its success to the sociological structures of the region, but has hardly any connection to various social movements. Centred on the Greater Rouen area but giving nevertheless a certain political reality to the region of Upper Normandy, this object shows itself equally to be partly professionalised, at least on the level of party leaders, and shaped by the legacy of Epinay. Through the domination of the large local governments, it has prospered by opposing the Right head-on while at the same time promoting an administrative logic that is only slightly ideological.
Charlotte GINOT-SLACIK
- Figures de l’Espagne dans la musique de Luigi dallapiccola, Bruno Maderna et Luigi Nono.
- Sous la direction de Pierre-Albert Castanet.
Floriane GALEAZZI
- La France et la réforme du système monétaire international (1961-1987). Le rôle des experts du Working Party n°3 de l’OCDE.
- Sous la direction d’Olivier Feiertag.
Aude PAINCHAULT
- Les châteaux normands dans l’oeuvre d’Orderic Vital et leurs traces archéologiques.
- Sous la direction d’A.-M. Flambard Héricher.
- 3 vol. (476, 640 p.) : ill, tabl., cartes ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
Malgré de considérables avancées, les progrès de la recherche pluridisciplinaire en castellologie se heurtent encore à certains a priori notamment pour l’utilisation des sources narratives. La comparaison des descriptions de fortifications, dans l’œuvre d’Orderic Vital, avec leur pendant archéologique, pour une période et un espace restreints à la Normandie entre 1118 et 1141, a pour objectif de réaffirmer l’intérêt de recourir à de telles sources. La création d’une base de données alimentée par les 80 sites fortifiés mentionnés par Orderic Vital constitue la charpente de ce travail. Elle prend en compte, sous forme de notices détaillées en deux volumes, l’histoire des sites et leur description archéologique. L’explication s’appuie sur un plan cadastral et dès que cela est possible sur un relevé topographique ou la présentation des résultats de fouilles antérieures à cette étude. Le volume de synthèse s’attache à la comparaison proprement dite entre le vocabulaire, les descriptions narratives et les observations de terrain. Après un bref aperçu méthodologique, le développement s’organise autour d’une analyse géopolitique des sites mentionnés, de l’étude du vocabulaire et des descriptions du chroniqueur, pour enfin s’attacher à la typologie des formes castrales mentionnées, l’aménagement du territoire autour de celles-ci et leur correspondance avec le texte. Le chroniqueur ne mentionne que les sites fortifiés impliqués dans un conflit ou qu’il connaît plus personnellement, il décrit simplement le site ou intègre parfois la ville qui lui est associée. Il utilise vingt et un mots différents pour qualifier le caractère fortifié des quatre-vingt lieux qu’il décrit. Certains vocables sont utilisés dans un sens large, d’autres concernent des composants spécifiques au château. L’étude archéologique révèle la grande diversité de formes architecturales, principalement des enceintes de terre ou maçonnées et dans une moindre mesure des mottes. La correspondance entre le texte et les vestiges est établie à plusieurs niveaux, château, ville ou territoire, sans pour autant prendre un caractère systématique : certains mots sont employés pour désigner des ensembles strictement composés des mêmes éléments, les descriptions très détaillées trouvent correspondance avec le terrain et révèlent la qualité de descripteur du chroniqueur.
Gilles DESHAYES
- Le cellier médiéval en Normandie orientale. Contribution à l’étude des utilisations, implantations et architectures des celliers dans la Normandie du second Moyen Age, en particulier dans les sites monastiques.
- Sous la direction d’A.-M. Flambard Héricher.
- 5 vol. (1037, 825, 183 p.) : cartes, plans, nombreux dépl., ill. en noir et en coul. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
Au cours du second Moyen Age, de nombreux celliers ont été construits, agrandis ou transformés en Normandie orientale. Le cellier est un espace économique polyvalent, fréquenté régulièrement, destiné à stocker, conserver et protéger des biens matériels (surtout des fûts de vin). Introduite par une analyse de la sémantique médiévale du cellier et de la cave, la recherche a été axée sur leurs utilisations, implantations et architectures, au travers de la documentation écrite, iconographique et archéologique. Les relevés et études monographiques ont surtout renseigné des résidences seigneuriales, plus particulièrement les abbayes. À l’échelle d’une région les angles d’approche du sujet fournissent une vision d’ensemble des celliers maçonnés, souvent voûtés, et au sein des activités qui leur sont associées, des chantiers de construction aux utilisations du quotidien. La diversité des sites et des paysages engendre celles des usages des celliers, de leur dimensions et de leurs modes de gestion (vignobles, résidences, quartiers urbains). Pratiques, contenus et contenants ont pu évoluer au cours de la période, témoins de la lente et partielle disparition des celliers peu encaissés au profit de caves profondes et parfois souterraines. L’usage et le paysage dictent l’implantation opportuniste ou contrainte du cellier, proche d’espaces associés. Les plans, élévations, voûtes, ouvertures, matériaux et techniques de construction caractérisent les vestiges et constituent des éléments de datation. Pendant deux siècles, les celliers quadrangulaires furent secondés par les « caves à cellules », abondantes dans la moitié sud-est de la région et dans une grande variété de sites ruraux.
2014
Hélène RANNOU
- Permanence du syndicalisme révolutionnaire au Havre de 1892 jusqu’en 1978.
- Sous la direction de Y. Marec.
- 1 vol. (944 p.) : ill. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
À travers l’histoire du syndicalisme havrais, c’est une page originale du mouvement ouvrier qui s’écrit, celle qui met l’accent sur sa richesse, ses contradictions, ses réalisations concrètes, ses conflits de travail, ses luttes internes et ses différentes références théoriques. Dès la fin du XIXème siècle, l’irruption des ouvriers au Havre sur la scène portuaire, industrielle, urbaine, sociale et enfin politique, grâce à l’accès des hommes au suffrage universel, bouleverse les équilibres en place localement. La multiplication des actions revendicatives sur le plan économique, portée par l’implantation d’une Bourse du Travail, l’envol du syndicalisme et de mouvements subversifs organisés, donne in fine le change. Et, assez rapidement, il est possible de constater l’implantation d’un mouvement revendicatif autonome et de pratiques révolutionnaires dont l’action directe est l’une des composantes. Du respect de la Charte d’Amiens aux théories de Fernand Pelloutier, de l’antimilitarisme au néomalthusianisme, de la grève générale à la grève perlée, les dirigeants syndicalistes révolutionnaires entreprennent de construire, sans attendre « le Grand Soir », une contre-société qui s’oppose à l’État et au patronat. Cette culture syndicale havraise marquée par des formes de lutte particulières se pare d’une constance qui balaie finalement les décennies et ce, en dépit même du poids du Parti communiste français au Havre après la Seconde Guerre mondiale.
Jean-Baptiste VINCENT (Prix de la fondation Flaubert 2015)
- Les abbayes cisterciennes de Normandie (XIIe-XIVe siècle). Conception, organisation, évolution.
- Sous la direction d’Anne-Marie Flambard Héricher
- 3 vol. (937, 582 p.) : ill., cartes, tabl. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
Le territoire normand offre un total de 24 abbayes cisterciennes aux vestiges architecturaux contrastés. A l’échelle européenne, l’épopée cistercienne est bien documentée avec des problématiques diverses comprenant l’architecture, le milieu d’implantation, et l’économie de ces établissements des XIIe-XIIIe siècles, mais la vaste région normande était en reste. C’est pourquoi une investigation de terrain a été menée, à la fois sérielle et globale, en appliquant toutes les démarches prospectives (topographie, prospection pédestre, prospection géophysique), les études du bâti et l’analyse des sources archivistiques afin d’envisager des restitutions chronologiques. L’utilisation de nouvelles techniques appliquées à l’archéologie permet de cartographier ces monastères mais aussi d’envisager une étude multifactorielle des monastères : la gestion du milieu pour édifier un monastère, l’adaptation du milieu hydrologique pour assainir un territoire tout en apportant les besoins en eau nécessaires à une vie communautaire, enfin la compréhension de l’organisation spatiale et architecturale des abbayes à l‘intérieur de l’enceinte monastique, ceci en considérant les différences possibles entre savigniens et cisterciens, hommes et femmes, selon une évolution chronologique. Ainsi, après un travail monographique en deux volumes des 24 monastères, une synthèse générale restitue l’histoire de l’implantation cistercienne en Normandie, puis analyse les aménagements nécessaires réalisés en amont de l’édification d’un monastère, avant d’aborder les aspects architecturaux.
Bénédicte PERCHERON
- Les sciences naturelles à Rouen au XIXème siècle : muséologie, réseaux et vulgarisation scientifiques.
- Sous la direction de Y. Marec.
- 3 vol. (691, 191 f.) : ill. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
L’étude des sciences naturelles à Rouen au XIXe siècle, dans son acception la plus large, permet de révéler des pratiques sociales, culturelles, économiques, politiques ou encore, des idéologies scientifiques et philosophiques. De l’émergence du premier jardin botanique de Rouen à l’ouverture du Parc zoologique de Clères, en passant par la création des muséums d’histoire naturelle de Rouen et d’Elbeuf, cette thèse offre un panorama de l’histoire de cette discipline à travers le prisme de la muséographie, de la vulgarisation et des réseaux scientifiques. Elle interroge et confronte la cohabitation entre la recherche et la vulgarisation scientifique, toutes deux à l’origine de l’essor de la discipline durant ce siècle. Ces rapports sont examinés par l’entremise de l’étude des trois grandes phases qui ont présidé à son épanouissement. Elle revient d’abord sur les origines et l’enracinement de l’histoire naturelle à Rouen, en s’attardant sur les premières collections privées, puis publiques spécialisées. Le phénomène d’institutionnalisation des sciences naturelles est lui étudié à travers l’histoire du Muséum d’histoire naturelle de Rouen et la création des jardins publics de la ville. Enfin la dernière partie s’attache aux outils de diffusion de cette discipline, en revenant sur l’histoire de son enseignement et des sociétés savantes locales. Elle se propose de s’intéresser aux conséquences de cette diffusion en observant l’utilisation et la diffusion des théories scientifiques durant la Troisième République et les créations muséographiques de ces années. Enfin, l’étude s’achève sur la notion d’exhibition du vivant perçue comme un phénomène de distraction et de vulgarisation.
Stéphanie DERVIN
- Typochronologie de la céramique bas-normande de la fin du XIIè siècle au milieu du XIVè siècle
- Sous la direction d’Anne-Marie Flambard Héricher
- 2 vol. (533 p., non paginé [ca 100] f.) : ill., cartes, tabl. ; 30 cm + 1 CD-ROM
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
Ce doctorat intitulé typochronologie de la céramique bas-normande de la fin du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle a pour principal objectif d’élaborer un outil de comparaison pour les archéologues travaillant sur la céramique médiévale de Basse-Normandie et des régions limitrophes. Au vu du nombre de sites fouillés entrant dans cette fourchette chronologique, le choix des ensembles à utiliser, dans cette enquête, demandait une certaine exhaustivité. Les céramiques découvertes au château de Caen en 2005, du château de Falaise en 2008, et la nouvelle étude du lot de Sées découvert en 1994 ont permis l’acquisition de nouvelles données. Les résultats obtenus ont été confrontés aux différents lots anciens et permettent de proposer un catalogue des formes identifiées ainsi qu’un catalogue synthétique des groupes techniques obtenus par observation macroscopique des pâtes. La hiérarchisation dans le temps de ces informations souffre d’un manque de données et ne peut être réalisée qu’à partir d’une zone géographique restreinte : la plaine de Caen. L’étude archéométrique, basée sur l’analyse chimique des céramiques, conduit à proposer des aires de production identifiées ou probables à ces formes et ces pâtes. L’identification des productions est une étape nécessaire à la compréhension de l’organisation des aires d’ateliers dans la région. Les évolutions observées entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle illustrent les transformations qui ont lieu dans la société avant la guerre de Cent Ans. L’analyse périodisée et spatialisées des données amène à une cartographie des aires de diffusion de ces productions et nous révèle un pan de l’économie régionale.
2013
Christophe COLLIOU
- Métallurgie ancienne au Pays de Bray, approche diachronique de la réduction du minerai de fer
- Sous la direction d’Anne-Marie Flambard Héricher
- 2 vol. (527, 151 p.) : cartes, tabl., ill., couv. ill. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Franck BEAUVALET
- L’enseignement primaire et les œuvres post et périscolaires dans le département de l’Eure sous la IIIe République
- Sous la direction de Yannick Marec
- 3 vol. (763 f.) : ill. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC.
Plus d’informations…
L’enseignement du primaire est l’une des priorités des républicains dès leur arrivée au pouvoir en 1879. Finalisant un mouvement en faveur de l’instruction qui s’est construit tout au long du siècle, ils adoptent les lois fondamentales entre 1879 et 1889. Constitués, entre autres, du triptyque, gratuité, obligation, laïcité et des lois Goblet, ces textes marquent le début d’une ère nouvelle. Progrès scolaire est alors synonyme de vie meilleure. Afin de mener à bien leur dessein, les républicains ont bénéficié du soutien de la Ligue de l’Enseignement. À partir de l’exemple eurois, cette thèse cherche à mettre en lumière la façon dont l’ordre primaire s’est construit dans ce département sous la IIIe République. L’approche retenue croise le regard des hommes politiques, de l’autorité académique, des instituteurs, des associations et de la presse. Le constat sur la situation de l’enseignement primaire à la fin du Second Empire dressé, nous avons voulu voir comment les textes fondateurs ont été appliqués et quelles résonances ils ont eu sur les réseaux élémentaire, maternelle et post-élémentaire. Puis à partir des thèmes tels que la formation à l’école normale, les programmes enseignés, le certificat d’études primaires, les relations entre les instituteurs et leur hiérarchie ou bien encore la structuration du corps enseignant, nous avons dessiné ce que pouvait être la réalité du métier d’enseignant. Enfin, le champ d’études a été élargi aux œuvres péri et postscolaires, aux célébrations scolaires et aux sociétés d’instruction et d’éducation populaire afin d’en mesurer le rôle et les apports. Ceci nous a permis de définir le nouvel ordre primaire eurois, d’en faire émerger les avancées mais aussi les limites.
Vincent DUCHAUSSOY
- Activités, organisation et mode de gouvernance à la Banque de France 1936-1973
- (Cifre) – Sous la direction d’Olivier Feiertag
DE MAUPEOU Félicie
- L’artiste scénographe de son œuvre. Pour une relecture des Mymphéas de Monet à l’Orangerie des Tuilleries
- Sous la direction de Frédéric Cousinié (co-dir. Ségolène Le Men)
- 2 vol. (323, 128 f.) : ill. en noir et en coul. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC
2012
Thu Hanh HOANG THI
- Cultures informationnelles et pratiques documentaires des enseignants de langues étrangères dans l’université vietnamienne: le cas de l’université de Hué
- Sous la direction d’Éric Delamotte (co-dir. Van Minh Trinh)
Gaïd ANDRO
- Une génération au service de l’État : histoire institutionnelle et étude prosopographique des procureurs généraux syndics de la Révolution française (1780-1830)
- Sous la direction de Michel Biard, Professeur des Universités, université de Rouen
- 3 vol. (720, 232 p.) : cartes, tabl. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC
Michel BALDENWECK
- De la résistance au rétablissement de la légalité républicaine en Normandie : histoire de la Seine Inférieure (1943-1946) de l’occupation à la Libération
- Sous la direction d’Olivier Feiertag, Professeur des Universités, université de Rouen
- 3 vol. (785 p., non paginé) : cartes ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC
Plus d’informations…
Nous analysons le retour à la Légalité Républicaine et les processus d’organisation et de décisions de la résistance et leurs effets en Seine Inférieure, de 1943 à 1946. L’étude de l’évolution des nouveaux équilibres politiques dans le département depuis 1936 en fait partie ainsi qu’une description et une analyse des nouvelles organisations administratives et économiques : les Préfets régionaux et leurs Intendants, la police d’État, les services spécialisés de répression contre la résistance. Nous avons analysé les principaux groupes de pouvoir : l’Église catholique, les francs-maçons, la communauté juive, les organisations économiques, les partis politiques, les syndicats… C’est aussi une analyse de la continuité de l’État dans le contexte de guerre, d’occupation, de la collaboration et de la Libération et lors de l’épuration. Une attention particulière a été portée à la Résistance : sa formation, ses composantes, son activité et ses effectifs, son action à la sortie de la Guerre, la constitution et le fonctionnement du Comité départemental de la Libération national (CDLN) et des comités locaux (CLLN). Nous avons analysé la sortie de la Guerre et les différents problèmes posés à la Seine Inférieure et plus généralement à la Normandie. La tâche des autorités fut immédiatement de faire face, une fois le calme rétabli, au ravitaillement, au déblayage, au déminage maritime et terrestre, à la reconstruction, au retour des déportés et des requis du STO, à la gestion des prisonniers de guerre allemands, au redémarrage de l’activité industrielle et commerciale, à la réouverture notamment des ports et des liaisons ferroviaires et fluviales. Une attention a été portée à l’épuration politique et administrative, à celle des entreprises et aux conclusions de la commission des profits illicites, aux internements, aux Cours de justice et aux Chambres civiques qui furent créées en 1944.
Nicolas LEROUX
- L’anthropisation médiévale des rives de la Seine entre Rouen et le Havre et ses conséquences économiques
- Sous la direction d’Anne-Marie Flambard Héricher, Professeur des Universités, université de Rouen
- 10 vol. (1556, 339 p.) : cartes, graph., ill. ; 30 cm
- Où consulter cette thèse ? Accès à la notice SUDOC
Plus d’informations…
Étymologiquement, l’anthropisation est l’effet de l’action humaine sur les milieux naturels. On voit l’ambiguïté de cette définition : l’homme serait-il exclu d’un milieu qui ne serait naturel qu’en son absence ? Cependant, pour donner un sens opérationnel à la notion d’anthropisation, il faut remarquer que ce concept s’est imposé à partir du moment où un bilan s’est avéré nécessaire, l’aspect négatif des actions humaines apparaît en filigrane, puis en surimpression sur leur aspect positif, envisagé jusque là exclusivement en toute bonne conscience civilisatrice. Alors, circonscrite, l’anthropisation est la conséquence des actions humaines conduisant à un appauvrissement, une dégradation, voire une destruction des écosystèmes parfois à la création d’autres plus ou moins artificiels. L’impact humain sur l’environnement conduit à quelques remarques économiques sur la basse vallée de la Seine du VIIe au XVIe siècle. Lutter contre les divagations du fleuve, exploiter les matières premières, les ressources souterraines de cette vallée, profiter des richesses de la Seine et essayer d’établir des passages permettant les échanges entre les deux rives opposées tentent de répondre à l’intérêt que l’Homme a porté au milieu naturel entre les invasions normandes et le début du XVIe siècle. Plusieurs groupes humains s’intéressèrent à cette artère séquanienne ; les grands seigneurs (barons, comtes et rois) et les ecclésiastiques voulaient laisser leur empreinte dans cette grande vallée fluviale entre Rouen et le Havre. L’Histoire, celle que l’on écrit avec un grand H, laisse des traces dans la terre, nous propulsant quelquefois plusieurs siècles en arrière. L’Histoire ne peut s’effacer, parce qu’elle appartient à notre héritage et conditionnant notre présent et tout le futur, insaisissable.
2011
David LAMAZE
- Misia Godebska un point commun entre Debussy et Ravel
- Sous la direction de Pierre Albert Castanet
Maher BEN YOUSSEF
- L’Occident à travers le discours nationaliste tunisien vu par la presse française (1934-1956)
- Sous la direction de Yannick Marec, Professeur des Universités, université de Rouen
- 1 vol. (375 f.) : couv. ill. ; 30 cm
Richard FLAMEIN
- Mobilités sociales et matrice des identités bourgeoises d’Ancien Régime par l’univers matériel : la « résistible ascension » des Le Couteulx (1600-1824)
- Sous la direction de Michel Biard, Professeur des Universités, université de Rouen
- 3 vol. (929 f.-4 dépl.) : cartes, tabl., ill. ; 30 cm
Plus d’informations…
« La société d’ordres d’Ancien Régime ne connaît guère les mobilités sociales », « le capitalisme dynastique français souffre de la rigidité de ses structures », « le marchand du XVIIIe siècle n’aspire qu’à quitter son état par l’anoblissement de sa lignée », voilà quelques lieux communs mis à mal par la présente thèse. L’approche retenue en fait la particularité : délaissant les catégories posées comme a priori, elle offre une matrice du mode de production empirique des identités bourgeoises d’Ancien Régime sur le substrat d’une analyse méticuleuse de ses univers matériels. Elle propose, en définitive, un tableau le plus complet possible des mobilités sociales bourgeoises entre 1600 et 1824. Pour ce faire, la démarche dissocie clairement stratégies et facteurs de fluidité. Les premières constituent les paradigmes bourgeois de l’identité : entreprise et capital, propriété et territoires, famille et transmissions. Leur inertie n’est qu’apparente et soulève la question de la vitalité des formes de la reproduction sociale à l’époque moderne : force est d’admettre le caractère négocié et toujours renouvelé des composantes d’une position sociale. Passant d’une conception collective du changement social dominante au XVIIe siècle, à une approche fluide et personnalisée des mobilités ensuite, la thèse s’attache à montrer les formes de la recomposition des identités sociales au XVIIIe siècle. Autant qu’une société des apparences, c’est une société du mouvement qui se donne à voir : posant à nouveaux frais la question des relations entre mobilités et formation des identités sociales, la thèse met en lumière la signification sociale des déchirements et des recompositions internes aux groupes, la redéfinition des appartenances, les négociations avec les barrières invisibles entre les catégories.
Rencontres scientifiques
Prochains événements
-
La revue Austriaca (1975-2025). Bilan et perspectives.
-
Stage d’initiation au tabellionage normand médiéval et moderne
-
Séminaire de l’axe 4 pour l’année 2025-2026 : L’État et la Révolution
Le séminaire commun de l’axe 4 en 2025-2026 portera sur l’Etat et la Révolution (XVIIe-XXe siècle).
Evénements passés
-
Histoire(s) de la précarité énergétique
Colloque les 6 et 7 janvier 2026, à la Maison de l’Université de Rouen Normandie (campus de Mont-Saint-Aignan)
-
Camille Enlart & Albert Gabriel. Historiens de l’art & archéologues de la Grèce franque
Le jeudi 23 et vendredi 24 octobre 2025, à la Fondation Marc de Montalbert (Rhodes).
-
Recherches actuelles sur l’histoire de l’ordre cistercien en France
Le Collège des Bernardins, qui a retrouvé sa fonction d’enseignement depuis 2008, accueille pour la troisième fois une demi-journée d’étude,…
-
Illicit Trafficking in the Mediterranean: a Critical Evaluation of Sources (1870s-1960s)
Jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2025 Ayanalıgeçit Avrupa Pasajı, Istanbul (Turquie)
-
Autour de la Seine : champs, historiographie, perspectives #3. La Seine et les activités économiques
Le 2 octobre 2025, de 9h00 à 18h00 (à l’université Le Havre Normandie, Faculté des Affaires internationales, salle Olympe de…
Valorisation
Prix et distinction
Marie Groult, docteure et membre associée du GRHis, a reçu l’accessit de la Grande Loge de France, dans le cadre du prix de thèse 2025 du Suprême Conseil de France. Son sujet de recherche était « Εt vοus avοns esleu d’estre au nοmbre de ladite Cοmpagnie ». Les ordres de chevalerie au sein des cours françaises au ΧΙVe siècle et l’éditiοn de leurs statuts (sous la direction de Elisabeth Lalou).
Julien Chuzeville a obtenu le prix L. O. Frossard 2024 pour sa thèse sur Les Courants socialistes et communistes en France sous la IIIe République dans laquelle il étudie en particulier la période primordiale de l’unité socialiste, celle du Parti socialiste SFIO de 1905 à 1914 – dont sont issus par la suite tous les partis et groupes socialistes et communistes en France.
Marie Malherbe, docteure du GRHis (dir. Anna Bellavitis) et membre associée, a obtenu le Prix de thèse en cotutelle 2022 de l’UFI (Université Franco-Italienne) qui lui a été remis le 28 février 2023.
Mathieu Bidaux, docteur du GRHis, a obtenu le Prix Babut 2022 de la Société française de numismatique pour son ouvrage issu de sa thèse soutenue à l’Université de Rouen La fabrication des billets en France. Construire la confiance monétaire (1800-1914) parue aux Presses de Sciences po.
Charles-Alban Horvais, docteur du GRHis, a obtenu le prix d’histoire militaire 2022 du Service Historique de la Défense pour sa thèse Les armées romaines en Afrique à l’époque républicaine (256-46 av. J.-C.), soutenue publiquement le 9 décembre 2021 à l’Université Rouen Normandie.
Yannick Marec, membre du GRHis et professeur émérite des universités en histoire contemporaine, a été promu et nominé au grade de Chevalier de l’Ordre nationale du Mérite le 20 juin 2022.
Le prix de thèse AFHE-BNP Paribas, décerné par l’Association Française d’Histoire Économique, a été décerné à Paul Maneuvrier-Hervieu pour sa thèse La Normandie dans l’économie Atlantique au 18e siècle. Production, commerce et crises, sous la direction de Jean Marc Moriceau et Michel Biard, soutenue à Université de Normandie, le 27 novembre 2020.
Le prix d’histoire militaire 2019 du conseil scientifique de la recherche historique de la défense a été attribué à Côme Barbaray, doctorant du GRHis, pour son mémoire de Master intitulé La « République assiégée » (1793-1794) (sous la direction de Michel Biard).
Le Prix de la fondation Flaubert de la thèse en Sciences Humaines et Sociales a été décerné le 11 octobre 2018 à M. Bruno Nardeux, docteur du GRHis, pour sa thèse Une “forêt” royale au Moyen Âge : le pays de Lyons en Normandie (1100-1500), encadrée par Elisabeth Lalou.
Le prix spécial Ary Scheffer a été attribué à Stéphane Rioland le 13 mars 2018 pour sa thèse Les utopies urbaines de l’architecte Jules Adeline (1845-1909), ou l’uchronie comme outil de «réhabilitation» de la ville, encadrée par Yannick Marec.
Madame Josiane Bauhain a obtenu le 17 mars 2018 le prix Albert Mathiez, décerné par la Société des études robespierristes, pour son mémoire de Master 2 soutenu à l’Université de Rouen Normandie (GRHis) sous le titre Théâtre et politique dans le journal Le Père Duchesne de Jacques René Hébert (1790-1794). Elle est désormais, depuis septembre 2017, inscrite en doctorat sous la direction de Michel Biard, qui avait également encadré ses recherches en Master.
Antony Kitts, docteur et associé du GRHis, a reçu le prix 2017 du Comité d’histoire de la sécurité sociale
Michel Biard, Professeur des Universités en Histoire du monde moderne et de la Révolution française, a reçu, le 9 mars 2017, la croix de chevalier de la Légion d’Honneur [lien]
Le Prix de la fondation Flaubert de la thèse en Sciences Humaines et Sociales a été décerné le 9 février 2017 à M. Romain Grancher, agrégé d’Histoire, docteur et membre associé du GRHis, pour sa thèse Les usages de la mer. Droit, travail et ressources dans un monde de la pêche (Dieppe, XVIIIe – début XIXe siècle), soutenue le 7 décembre 2015 (consultable à la Bibliothèque Universitaire de l’Université de Rouen).
Le Prix de la fondation Flaubert de la thèse en Sciences Humaines et Sociales a été décerné le 27 mars 2015 à M. Jean-Baptiste Vincent pour sa thèse Les abbayes cisterciennes de Normandie (XIIe-XIVe siècle). Conception, organisation, évolution (consultable à la Bibliothèque Universitaire de l’Université de Rouen). Une émission portant sur ses recherches peut être écoutée ici.
Le Prix Albert Mathiez 2013 a été décerné à Madame Gaid Andro, pour sa thèse, soutenue en 2012 à l’Université de Rouen sous la direction de Michel Biard : Une génération au service de l’État : histoire institutionnelle et étude prosopographique des procureurs généraux syndics de la Révolution française (1780-1830), 3 volumes. Elle sera publiée aux Editions de la Société des études robespierristes, en 2015, dans la Collection Prix Mathiez.
Le Grand prix des Muses 2013 a été décerné à Rémy Campos et Aurélien Poidevin pour leur ouvrage La scène lyrique autour de 1900 paru à L’Œil d’or en 2012.
Le prix Gossier de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen a été décerné le 15 décembre 2012 à Olivier Diard pour le tome I de son Répertoire des manuscrits liturgiques consacré aux sources fondamentales des offices de Jumièges publié aux PURH en 2011.
Le prix Dumanoir de l’Académie des Sciences, Belles-Lettre et Arts de Rouen a été remis le 15 décembre 2012 à Franck Thénard-Duvivier pour son ouvrage Images sculptées au seuil des cathédrales. Les portails de Rouen, Lyon et Avignon (XIIIe-XIVe siècles) publié auxPURH en 2012.
Le prix du Comité d’histoire de la Sécurité sociale 2010 a été décerné à Sophie Victorien pour sa thèse de doctorat Jeunesses malheureuses, jeunesses dangereuses. L’éducation spécialisée en Seine-Maritime depuis 1945, sous la direction de Yannick Marec, université de Rouen, 2010 (ouvrage cité par l’Académie des Sciences, des Belles-lettres et des Arts de Rouen en décembre 2011).
Le prix Mnémosyne 2010 qui récompense chaque année le meilleur Master soutenu dans une université francophone en histoire des femmes et du genre a été décerné à Anaïs Dufour pour son mémoire intitulé Le “ pouvoir des dames ”. Femmes et pratiques seigneuriales en Normandie (1580-1620), sous la direction de Sylvie Steinberg et Anna Bellavitis, université de Rouen, 2010.
Le prix jeunes chercheurs 2010 du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) a été décerné à Sharifa Amharar pour son mémoire de Master intitulé Le renseignement sous le règne de Saladin, préparé au département d’histoire de l’université de Rouen, sous la direction de Gilles Grivaud et Elisabeth Lalou.
Médias
-
À la table de Pompéi | Scope | Arte
Scope, l’émission scientifique sur la chaîne Twitch d’ARTE, depuis Pompéi pour explorer la gastronomie de…
-
Rosa Luxemburg face à l’Histoire (avec Jean-Numa Ducange)
Autour de « Rosa Luxemburg. Radicale et libre » (Éditions Calype).
-
Conférence de Michel Biard à Arras, en mai 2023, sur le thème de « la queue de Robespierre »
Dans les jours qui suivent les 9 et 10 thermidor, la mort de Robespierre et…